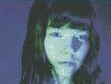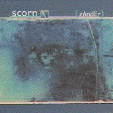BB Doc
Rage de raison
Les alternos ne sont jamais aussi mauvais que quand ils deviennent sérieux. Et à l’écoute de cet album, on se souvient,
sourire en coin, de l’excellent premier album « Jazz », délirant et gouailleur à souhait. Les arrangements sont certes ici plus
soigneux, qu’on les croirait pompés sur n’importe quel opus trash-soft bien balancé, avec ici et là quelques pointes ska,
ragga, mais sans le clin d’oeil escompté. Quelques morceaux sont à sauver du naufrage, car Piero Sapu, homme généreux,
reste néanmoins pétri de talent et de rage émouvante. Dommage. (C)
Better Than Ezra
Friction, baby
Noisy-pop sympathique quoique dosée en experts-comptables. Joli chant. Jolie guitare. Prise de risques minimum. Plaira
aux amateurs de Smashing Pumpkins. (RT)
Björk
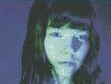
Telegram
Amusée et honorée de voir ses compositions devenir le jouet de remixers divers, Björk signe avec ce troisième album un
blanc seing à l’inspiration des plus libérées. Même si les opérations de co-branding artistique menées sur « Telegram » sont
de qualité inégale, l’expérience reste très intéressante puisqu’elle met en valeur les multiples facettes de l’insaisissable et
scintillante Mlle B. : tantôt espiègle et enfantine, tantôt bucolique, puis séduisante, puis agaçante...voire irritante !
Eclectiques, Björk et ses compères circonstanciés tirent sur toutes les ficelles musicales (ou presque) en passant d’un dub «
bien-comme-il-faut-en-1997 » à un mix jungle-harpe, en ne laissant surtout pas de côté les diarhées de philharmonie kitsch,
immédiatement suivies d’une plongée en apnée dans un ambient des grands fonds. La cerise sur le gâteau reste quand même
le sublime « Headphones ». Minimaliste à souhait, indépendant à volonté, il véhicule le délice de la simplicité et dégage le
charme de l’inassouvi. (PT)
Bloodhound Gang
One fierce beer coaster Doux mélange de hip-hop, de punk-métal et de disco lobotomisée, Bloodhound Gang se spécialise
dans le texte poilant, tendance collégien boutonneux. Des titres comme « Kiss me where it smells funny » (« Embrasse-moi
là où ça sent drôle ») ou encore « I wish I was queer so I could get chicks » (« Je voudrais être pédé pour me faire des
gonzesses ») donnent le ton. La musique, speedée et ludique, s’accorde parfaitement au propos. Et le livret, en guise d’ «
explicit lyrics », prévient : « si ça vous choque, vous êtes pas cool ». Voilà. (RT)
Bowie

Earthling
Et Candide découvrit la techno. Bowie s’est choisi un mode d’expression, résolument contemporain, avant même de savoir
ce qu’il avait à dire et à chanter : ça se sent. On ne s’improvise pas Prodigy, Ministry ou Nine Inch Nails, fût-ce en leur
pompant allègrement riffs de guitare et palette de sons. Même Bowie. Le vénéré vétéran s’aventure sur un terrain qu’il ne
connaît manifestement pas ; là ou d’autres « anciens », tels Depeche Mode, offrent un bel exemple de conversion réussie au
radicalisme dans la continuité, le beau David en dandy-sainte-nitouche fait piètre figure, et ne se hisse à la hauteur de ses
pairs (et néanmoins benjamins...) qu’accidentellement : le geignard et parfois audacieux « Battle for Britain », le crétin mais
libre « Dead man walking », et ponctuellement le single « Little wonder » relèvent la barre, au beau milieu d’une soupe
hésitant constamment entre clonage et resucées de Bowie soi-même. Reste qu’on pourra s’appuyer les derniers clips du
papy sur MTV ou MCM : objectivement parmi les plus puissants du moment. Bowie simple icône ? (RT)
Buckshot Lefonque
Music evolution
Supposons que le hip-hop échappe une seconde au simple bidoullage pour s’armer de véritables musiciens jazz, et ça
donnerait... Buckshot Lefonque. Plaisir de la contrebasse, charme irrésistible d’une guitare soul, pleins et déliés du
saxophone... les instrumentaux se taillent la part du lion. James Brown, parrain presqu’officiel des huit zigotos, aimerait
sûrement. Le chant est à la hauteur (un rien strict parfois), plus efficace sur les morceaux rap que sur les choses new-jack,
par définition un peu platouille. Frais et construit, l’album aurait presque l’étoffe d’un classique (... du jazz ?). Et à écouter
coûte que coûte : « jungle grove » - ou la techno selon John Zorn, voire Monsieur Coltrane. (RT)
Castafiore Bazooka
Au cabaret des illusions perdues
Dans la lignée des Elles, voici d’autres dames, inspirées elles aussi, rigolotes et grinçantes, sauf qu’à la différence des
premières, la cheftaine des Castafiore n’en est pas à son premier coup d’essai. Elisabeth Wiener, chanteuse solo,
musicienne et actrice déjantée, sorte de Sapho qui n’aurait pas virée snob, a traîné ses guêtres sur pas mal de sentiers
variétoche-underground (on se souvient de sa prestation sur le cultissime « Attentat à la pudeur » d’Higelin ). Mère
maquerelle attentionnée, elle promène ses pouliches à la voix cristalline et à l’accordéon caressant sur autant de rivages
polyphoniques, tout à tour musette, gospel, traditionnels, arabisant, gouailleurs ou tout ce qu’on voudra. L’album, enregistré
comme un live, mais à la maison, est indescriptible, multiple et inspiré, morceau d’humanité jeté en travers de nos vies par
des femmes bien. (C)
Daft Punk

Homework La techno anachronique du techno-groupe le plus médiatisé de France et de Navarre procède de recettes éculées,
et pas comme on a pu le lire et l’entendre un peu partout sur des expérimentations avant-gardistes (voir sur ce chapitre Some
More Crime ou Prodigy). Mais c’est bien fait, et ce simple constat suffit à justifier, à raison, l’enthousiasme des foules. La
méthode : un grain résolument analogique et une tendance à tirer les morceaux, forts en basse et gonflés au jingle tueur, soit
vers la disco (« Da funk », tube à juste titre, et surtout le désossé « Teachers »), soit vers l’industriel (le joyeux « Oh yeah »,
ou l’excellent « Rollin’ & scratching », vieux morceau paru sur une compilation, qui assit la réputation du groupe il y a au
moins trois ans déjà, fort en stridences habituellement peu prisées en cyberland). Il y eut un précédent notoire dans le genre,
faut-il le rappeler : D.A.F. (on remarquera la proximité du nom...). C’était il y a dix-quinze ans je crois, et on pouvait
parler, alors, d’avant-garde. (RT)
Depeche Mode
Ultra
Contrairement à ce que pourrait suggérer le titre, Depeche Mode n’a pas cherché la radicalisation avec ce énième album. Et
c’est tant mieux : on sait à quels clichés imbéciles conduit en général ce genre de démarche chez un vieux groupe - car
Depeche Mode est un vieux groupe, en exercice depuis 1981, ce qui fait que je l’écoutais déjà quand j’avais quatorze ans.
Dans la lignée du précédent « Songs of faith and devotion » qui avait vu, chez ces fervents de la new wave tendance
électronique (dont ils sont, à mon sens, les ultimes représentants crédibles), l’introduction des guitares, « Ultra » est un très
bel album - pas une révolution -, magnifiquement servi par le chant princier, mélodieux et cependant distant du ténébreux
Dave Gahan. Les percussions industrieuses (le groupe reste à ma connaissance le seul exemple de réussite artistique en
matière de musique industrielle grand public) se font plus discrètes, retirées, tandis que Martin Gore, le compositeur, s’offre
pour la première fois deux incursions blues, d’ailleurs joliment inspirées. Après bien des déboires (conflits, départ, drogue,
etc.), Depeche Mode persiste contre vents et marées dans son rôle de spécimen fin de race ostensiblement... racé. « Useless
», « It’s no good » ou encore (et surtout !) « Insight » et « The bottom line », le démontrent à l’envi. (RT)
Rrtrouvez le site web de Depeche Mode.
Elysian Fields

Bleed your cedar
Comparé à son lointain mais prestigieux cousin Mazzy Star, Elysian Fields a le bon goût de ne pas courber l'échine. C'est
qu'au psychédélisme brumeux du duo californien, le groupe de Jennifer Charles oppose, sous un apparent conformisme, une
atmosphère aussi perverse que sophistiquée. On s'imaginait faire rapidement le tour de cet album, on se retrouve à tournoyer
sans fin dans des mélodies sombres et voluptueuses, enchaîné à une voix qui sussure des mots sensuels et dangereux.
Manipulatrice, Jennifer Charles raconte d’une voix tranquille des histoires de femmes séquestrées et abusées (« Jack in the
box »). Un mot des arrangements : vaguement jazzy, ils évoquent parfois Spain - mais qu'on ne s'y trompe pas : sous le luxe
de façade se dissimule la plus belle des gangrènes. (SF)
Einstürzende Neubauten
Ende Neu
Trop léché, manquant d’audace et de rupture de style, le nouveau Neubauten ne fera pas date dans la carrière des vétérans
de l’indus expérimental. Bargeld applique ici les faciles recettes qu’il réservait jusqu’ici aux seuls Bad Seeds. Le recours
aux bandes un instant délaissées et l’absence de Mark Chung à la basse pèsent cruellement. Restent les instants de grâce : le
gospel mécaniste de « NNNAAAMMM », la folle cavalcade de « Was ist ist » ou la mélancolie outrée , hypnotique, de
«The garden » et « Der Schacht von Babel », écho au mythique « Stuhl in der Hoelle ». Intimistes, poétiques jusqu’au
maniérisme parfois, les Neubauten témoignent pourtant d’une vraie démarche esthétique : chaque titre est le fruit d’une
histoire et d’une technique particulières, longuement détaillées dans le livret. Images , clips et samples en pagaille retraçant
le cheminement du groupe étayent la section CD Rom, avec un bonheur que seules troubleront les incompatibilités Mac/PC.
(RT)
Fleur
Le jardin de la contemplation
Fleur, comme son nom ne l’indique surtout pas, ça ressemble à du très lent et très mauvais Stooges remixé par les Swans en
surimpression avec des chutes de studio de Zeni Geva. Le tout polarisé à 20 Hz et 22 Khz. C’est écrasant. C’est bandant.
C’est tout ce que je voulais dire. (RT)
Gothic B.C.F.E.A.
Cinq titres de death metal. Doivent être écoutés en tant que tels, je suppose. (RT)
Gravity Kills
Techno-trash aéré, aux rythmiques électro puissantes et aux guitares effilés, dans le sillage direct des premiers Nine Inch
Nails, ou de façon moins flagrante, de Peace, Love and Pitbulls. C’est judicieusement composé, plus pervers qu’agressif,
avec un soupçon de blues, un chant sarcastique... la question étant, en cette ère de clonages : y a-t-il de la place pour trois ?
(RT)
Guv'ner
The hunt
Nettement plus charpenté que son prédécesseur, « The hunt » n’a plus grand chose à voir avec l’esthétique cheap de Kitten,
dont Julia Cafritz, ex-Pussy Galore, s’est échappée une seconde fois pour produire, justement (avec l’indéboulonnable Don
Fleming) : Guv’ner. On évolue plutôt dans la pop naïve et délurée, entre Smiths passablement secoués, Sidi Bou Said et
Breeders période soft. Certaine nonchalance dans le chant évoque les premiers Sonic Youth, ou le martien Beck. Après le
très inconstant, très déconstruit, vaguement no wave « Hard for measy for you », « The hunt » sonne pourtant quelque peu
conventionnel. Guv’ner est un bon groupe pop : on en attendait plus. (RT)
Habacok Tibatom
Copie franchouillarde (presque) conforme (ou très inspirée) de Sonic Youth et de la noise en général, que l’on aurait
acoquinée avec quelques pincées de pop mancunienne, gentiment décadente, la formule proposée par ce jeune trio
fonctionne parfaitement. Se jouant avec inspiration des larsens, saturations, ruptures de rythmes et décalages vocaux qui ont
fait le succès des aînés, les six morceaux proposés ici découpent agréablement les esgourdes, entre un long gémissement en
demi-teinte et une rage trépidante. Le groupe a envie de vivre, cela se sent et c’est bien. (C)
Contact/CD : 04.67.01.73.94
Henri Rollins
Come it and burn
Le Schwarzie de la côte est toujours là. Vivant. Inébranlable. Bourré jusqu’à la lie d’une force qu’il ne peut contenir et qu’il
nous livre, intacte, planquée dans la tessiture de ses morceaux urbains, inspirés, à la violence déchargée dans la chaux vive.
Rollins est ce forcené du travail, insatiable, éditeur, producteur, romancier, visiteur de taules, homme de rue, poète
déglingué, instigateur de mouvements, agitateur en diable, qui se jette à corps perdu dans le rock’n roll le plus pur comme
dans un dernier appel, débarrassé des étiquettes, des genres, des lieux, des références. Il a pondu « Come it and burn »
comme on creuse une carrière, comme on respire, sans se retourner, passant faire la bise à Ian Dury, Iggy Pop ou Pantera, un
morceau chassant l’autre, vite, très vite, brutalement, pour continuer à avancer. (C)
The Kelley Deal 6000
Come-back réussi pour Kelley Deal, avec cet album solo tout en fraîcheur. La dame revient pourtant de loin, en l’occurrence
d’une longue cure de désintoxe. Bien sûr, la lourde hérédité des Breeders pèse sur presque tous les morceaux, l’ombre
lointaine des Pixies également, la charismatique jumelle Kim veillant donc symboliquement au grain au milieu de toutes ces
références. Cependant, l’album n’est pas une copie conforme de « Pod » ou de « Last Splash ». On y retrouve des ambiances
à la Throwing Muses, des jolies parties mélodiques à la Belly et des moments d’énergie pure façon Hole. Joli coup. (C)
Korn
Life is peachy
Fracassant et talentueux, le trash polymorphe et novateur de Korn prend toute sa mesure dans ce deuxième album osé et
assumé, qui laissera KO l’ensemble de ses éventuels concurrents. On assiste baba à l’extrapolation du déluge suggéré dans
l’album éponyme, narré sur un des tons les plus personnels qui soient dans l’univers passablement redondant de la musique
dite « métal ». La pochette, dans le genre portrait de Dorian Gray, donne le ton : violent par essence, romantique et grinçant
par vocation. Les incursions noisy, new wave, rap et dub (voire scat-dub pour le très-névrotique « Twist ») témoignent plus
d’une furie créatrice que d’une volonté de « mélanger les genres », comme c’est trop souvent le cas, chez d’autres. La
section CD-Rom contient quant à elle un clip du titre « Good god ». (RT)
Kreidler

Weekend
Originaire de Düsseldorf, ce quatuor, qui se défend de toute affiliation au mouvement Krautrock a su tirer profit de
l’héritage musical de ses prédécesseurs (de Can à Kraftwerk) pour créer son propre style. Un album entièrement
instrumental dont le titre « Weekend » reflète très justement l’ambiance qui s’en dégage. Une impression de calme , de repos
après une semaine agitée. Cette musique marie harmonieusement boucles, samples , nappes synthétiques et ouvre une brèche
mélodieuse et raffinée dans le paysage expérimental allemand.
Laïka

Sounds of the satellites Laïka (la chienne de l’espace) est au trip-hop ce que le raggamuffin est au dub. Un reggae
ethno-cosmique un brin systématique, passablement chargé en percussions, et susurré avec une timidité militante. On
préférait le précédent « Silver apples of the moon », plus émouvant et moins « fabriqué ». (RT)
Lost Highway BO
Cette bande-originale est superbe. A l’instar de Wim Wenders, que l’on pourrait accuser d’un peu trop copiner-démago
avec Nick Cave et de rameuter sur ses BO tout ce qui est dans la « tendance », Lynch, secondé par Trent Reznor, producteur
de cet album, a donné naissance à une compilation étourdissante. On alterne ici des moments classiques de musique de films
« à la Lynch » avec des titres de la crème techno-trash et noisy (Nine Inch Nails, bien sûr, Marylin Manson, Rammstein,
proche d’un Laibach inspiré, Smashing Pumpkins...), sans oublier Bowie et Lou Reed, toujours parfaits. Ce melting-pot
bizarroïde et inspiré donne lieu à une multitude d’ambiances, entre douceur et violence, pureté et perversion, calme et
saturation. Alleluia. (C)
Ludwig von 88
Prophètes et nains de jardins
J’admire les Ludwig pour leur témérité à nous refaire, consciencieusement, avec rage, fougue et bonne humeur, le même
album depuis bientôt 15 ans. La recette est d’une simplicité déconcertante : on sort ses références kitsch les plus honteuses
et on s’amuse avec, guidé par deux-trois accord punkisants, un sens de l’humour si lourd que même Stellla n’en voudrait pas
et des inter-morceaux tirés de films, documentaires et actualités divers (délicieusement surannés si possible).
Reconnaissons au moins un mérite au groupe : ni les succès, ni les années, ne leur ont fait tourner la tête, encore moins
changer de style. Après avoir remis au goût du jour les tubes passés (voir le précédent album), les Ludwig ont décidé cette
fois-ci de « s’attaquer » (l’ensemble étant plutôt bienveillant) à des personnalités euh... connues... dans le désordre Haroun
Tazieff, Ceaucescu, Charly Oleg, Pocahontas, Beethoven, Jodie Foster et j’en passe. Bon. Et après ? Après, rien. La
conclusion est toujours la même : les Ludwig sont là, indécrottables, inénarrables, parfois lassants, souvent émouvants,
gentiment révoltés. Des monuments du rock alterno français que rien ne semble ébranler. (C)
Machine Head
The more things change...
Difficile après le prodigieux « Burn my eyes » de transformer l’essai : l’ex-trash-band le plus prometteur du moment semble
avoir voulu rejoindre le troupeau avec ce deuxième album nettement plus commun quoique léché. Si le son grave et crissant
est toujours là, il ne suffit pas à masquer un certain manque d’inspiration, la vacuité de mélodies grossièrement moins
fouillées, ni la déplorable unification rythmique de morceaux plus volontiers estampillables, moins décalés que par le
passé. On se réjouissait à l’idée d’architectures paradoxales, mouvantes... on en est pour nos frais. Le chant s’en ressent,
volontaire et suiviste. Impossible, en dépit de sérieux restes, de ne pas voir en ce deuxième album une brutale baisse de
régime. (RT)
Martin Bates

Imagination feels like poison
L’ex-chanteur d’Eyeless in Gaza poursuit sa carrière de song-writer. L’émotion est mise à nu, la musique est minimaliste et
raffinée. C’est bien ce qu’attendaient les inconditionnels de Martin Bates. Des ambiances feutrées, une instrumentation
dépouillée et acoustique et toujours ce climat mystique, presque religieux qui confère à cette musique son caractère si
particulier. Ce nouvel album reste dans la continuité des oeuvres de l’artiste, mais le plaisir de retrouver les mélodies
envoûtantes et la voix sublime de Martin, nous empêche de lui reprocher son manque d’innovation. Un véritable moment
d’introspection, une musique intemporelle qui nous transporte dans le paysage intérieur de ses émotions.
Miossec

Baiser
Après son premier « Boire », hymne brillant et désoeuvré aux amours finissantes et, comme l’indiquait le titre, aux
beuveries (genre pas trop drôles), Miossec électrise sa prose -ce qui donne, donc, de l’électro-acoustique - et restreint son
champ de bataille : les amours finissantes auront seules ou presque les honneurs de « Baiser ». D’un point de vue
mélodique, seul « Juste après qu’il ait plu » se hisse à hauteur d’un « Non, non, non » ou de « Recouvrance », points nodaux
du précédent album. C’est aussi l’un des plus beaux textes (« Je t’aime bien, mais je ne t’aime plus... », glaçant), parce
qu’un des plus simples, avec « La guerre », « Tant d’hommes (et quelques femmes au fond de moi) » et « Ca sent le brûlé »,
qui témoignent d’une belle acuité, trop d’autres textes s’enfonçant malheureusement, avec force gros mots et aphorismes
approximatifs, dans l’anecdote facile ou l’autoflagellation complaisante, avec lesquelles « Boire » flirtait déjà sans, comme
ici, s’y perdre. Le parti pris d’irrégularité rythmique phrase musicale/versification (concrètement les phrases sont trop
longues) souligne trop souvent les défauts d’une prose un rien redondante. Miossec a choisi les dangers d’un art sur le fil,
sale et littéraire, empruntant à Brassens comme à Dylan, à Brel comme aux Stooges. Il semble en avoir les moyens. On dit
que le deuxième album est un cap, celui-ci n’est pas raté mais... difficile. Apôtre débraillé mais constant de la mauvaise
passe, le groupe devrait nous remettre ça, en mieux, sur le prochain... « Bouffer », sans doute, pour clore le cycle des 3 B ?
Retrouvez des infos et partitions de Miossec sur le web
(RT)
Motorpsycho
Angels and daemons at play Entre coldwave et noisy pop, Sonic Youth, Cocteau Twins et My Bloody Valentine, cet album
prenant et parfois rétro accuse deux constantes : un amour immodéré, dévot, des guitares et une émotion tendue, pudique, que
le chant amène comme un cadeau de bienvenue. A tel point que les quelques originalités de forme (l’emploi, par exemple,
d’une scie musicale) en paraissent accessoires. (RT)
Mr Parker 's band
Blues-pop FM mielleux et passablement soporifique, par le leader indéniablement dépassé de Certain General. (RT)
Nra leaded
Du punk, et du plus speed qui soit ! Incisif et précis. Matière à pogo, quoi... (RT)
P.J. Harvey & John Parish
Dance hall at louse point
Ceux qui pensaient voir cette chère Polly Jean assagie depuis son remarquable « To bring you my love » en seront pour leur
frais : cette nouvelle livraison, brûlante et gesticulante à souhait, se donne à boire comme un vrai tord-boyaux. Et ce n’est
pas la présence de John Parish, complice de longue date, qui rend le breuvage plus doux. Au contraire. Volontiers
dissonante, prenant souvent le bon sens mélodique à contre-pied, cette musique-là retrouve l’aridité des premiers jours. Un
faux retour à la case départ qui a de quoi réjouir. (SF)
Portobello bones & amigos
Un treize titres (dont six reprises) de l’un des plus beaux animaux noisy de chez nous, accompagné de ses copains : Burning
Heads (qui jouent pour l’occasion du pur Burning Heads), les Lyonnais Condense, Hint, Ouled el Raï, Cornu, Tantrum,
Babe, F. Norguet, Fragile, Near Death Experinece, Julie Bonnie (superbe sur « Pour vous retrouver un de ces jours », entre
Cranes et Swans raides bourrés) Beamtrap et Sawt el Atlas. Et une grave impression de déjà vu, de facilité bien française.
Fallait-il reprendre du Unsane, du Distorted Pony, quand le groupe s’en inspire déjà très largement dans ses compositions
persos ? Je ne crois pas. Seul tire vraiment son épingle du jeu Ouled el Raï, parfaitement incongru dans cet univers pas
vraiment orientaliste de saturations, dissonances longues et percussions hachées. « No vote » (avec Near Death Experience
et Ouled El Raï), « Pour vous retrouver un de ces jours » et le clopinant « State of shock », reprise de The Ex et Tom Cora,
sortent seuls des rails ici trop rigides d’un groupe qu’on espère revoir au plus tôt au mieux de son inspiration. (RT)
Prime time victim show
Ce sont des gens de groupes hardcore/indus français connus qui ont décidé, disent-il, de rendre hommage à leurs cousins
américains les Revolting Cocks. Et c’est vrai, l’imitation est saisissante. (RT)
Prodigy

Breathe
Dernier amuse-gueule electro-dance du groupe - dans la droite ligne du précédent « Firestarter » : puissant, nerveux, rythmé
et inventif - avant l’album... très attendu pour dans quelques mois. Sans concessions, Prodigy se pose en chef de file
présentable d’une famille electro-industrielle jusqu’ici cantonnée à l’underground le plus obscur (Sielwolf, Spahn Ranch,
Some More Crime...). On applaudit sans arrière-pensée, en dépit d’une version live du cyanuresque « Poison »
particulièrement bâclée (chant et mixage... c’est-à-dire absence de mixage). Et un titre surprenant, dans l’esprit Massive
Attack : « The trick », qui réjouira les amateurs d’extases plus cool. (RT)
Allez faire un tour sur le site officiel de Prodigy.
Renegade soundwave
Rsw 87-95
Renegade Soundwave, à n’en pas douter, est du même bois que les Consolidated, Meat beat manifesto et autres Disposable
Heroes... : d’un bois noueux. On y reconnaît sans peine le militantisme hargneux et provocateur de ceux qui lèvent le poing
bien haut et crient très fort qu’ils n’aiment pas la viande, la guerre, la vivisection ou le machismo. Cependant, accompli le
légitime « Chapeaux bas ! » dû aux ancêtres, force est de reconnaître que l’intérêt d’un tel album n’est qu’historique...
disons commémoratif. Hormis quelques bâtons de dynamite qui n’ont rien perdus de leur explosibilité, l’ensemble sent
plutôt le pétard mouillé. (PT)
Scorn
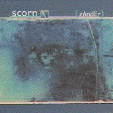
Zander
Après le remarquablement gonflant « Gyral », Mick Harris, unique membre résiduel de Scorn, redresse la barre. Le gars se
moque éperdument de la virtuosité, et c’est tout à son honneur. Ne subsiste des explorations de Scorn qu’un dub instrumental
planant, éminemment atmosphérique, redondant jusqu’à la nausée, entre samples peu loquaces, boîte à rythmes désenchantée
et guitare basse trop énigmatique pour induire une véritable rythmique. N’y manque que le supplément d’âme, les
clairs-obscurs qui firent la force d’ « Evanescence ». (RT)
Sielwolf IV
Épure industrielle au bord du vide, excoriée de toute velléité techno, de toute résistance hardcore, ce quatrième album de
Sielwolf tend vers un minimalisme inquiétant auquel le groupe, volontiers bruitiste, ne nous avait pas habitué. Articulé
autour d’un nombre assez réduit de samples proches de l’univers sonore d’un film tortueux de Ridley Scott, la succession de
morceaux, instrumentaux, consiste en une interférence continue de riffs percussifs étonnamment abstraits, loin de
l’assommoir Test Dept ou des Tambours du Bronx, et plus proches de rythmes organiques que témoins d’une quelconque
volonté tribale. Avec quelques instants de pure tension (« Neubell », « Mole », « Wrongcrowd »), et d’autres plus lâches,
qui remettent partiellement en cause la démarche d’ensemble. (RT)
Stone Roses
Garage flower
« Garage flower » ne va pas résoudre grand'chose au cas Stone Roses. Non pas que la publication de ces démos, antérieures
au premier album, soit totalement dépourvue d'intérêt. Mais voilà, « Garage flower » survient au moment même où le groupe
s'est disloqué pour de bon, laissant pour tout héritage deux albums qui n'ont pas fini d'entretenir la polémique. Aussi ces
démos seront nécessairement jugées en partisans : pour les inconditionnels, elles sont la preuve supplémentaire d'un génie
endémique ; pour les autres, « Garage flower » est une cible facile, bric-à-brac teinté du pire gothique, ersatz brouillon de
première oeuvre qui ne mérite guère qu'on s'y attarde. Gageons qu'une fois encore, la vérité se situe sûrement entre les deux,
dans un juste milieu dont n'ont précisément jamais voulu ni les Stones Roses, ni leurs afficionados... ni leurs pires
détracteurs. (SF)
Retrouvez les Stones Roses sur le web.
Subcircus
Carousel
Enfin un album de pure pop du meilleur acabit, ciselé avec émotion, tendresse et une certaine intensité. On peut penser «
Carousel » comme un album de Suede qui n’aurait pas honte de faire de la pop. Cette dernière est balancée ici sans
concession, sans complexes, privilégiant la mélodie, la quadrature harmonique avec une certaine classe. Les chansons
restent en tête, les paroles racontent avec mélancolie et douceur les chagrins de l’existence, sans pour autant être geignardes.
La voix de Peter Bradley s’applique parfaitement à l’exercice, surpassant d’ailleurs largement ses confrères du même genre.
Bien sûr, le fan de base de Sick of it All n’appréciera pas. D’autres, plus diplomatiques, verront dans cet exercice de style
un joli moment bourré de détails précieux. (C)
The legendary pink dots
Canta Mientras Puedas
Indispensable, cette compile 90-95 d’un des plus grands groupes multiformes de ces 15 dernières années. On pourra
regretter une impression d’ensemble assez « sage » en regard des performances bruitistes époustouflantes du groupe, sur
scène notamment. Mais l’essentiel est là. Indus, expérimental, ambient oriental ou intersidéral, touches pastel jazzy,
seventies, moyen-âgeuses, folk dénaturée, pop anti-pop, une alchimie de sons menée froidement par le prophète Qua’Spell,
dont la voix sur le fil a parfois des faux accents de Cat Stevens. Les Pink Dots attachent à la mélodie une attention presque
maladive, la léguant gracieusement à l’auditeur pour la lui reprendre quelques minutes après, n’enfermant jamais aucun
morceau dans une ligne établie, tout en conservant une limpidité sereine. Magistral et universel. (C)
Treponem Pal

Higher
Gras mélange de dub et de métal vaguement technoïde, resucée tranquille de Ministry et Meat Beat Manifesto,
« Higher » marque un tournant, très « mode » et particulièrement peu bandant, dans la carrière d’un groupe qui s’était
singularisé jusque là par une étonnante capacité à progresser, disque après disque. Même la reprise du désopilant hit disco
« Funky town », bien inférieure à celle, magistrale, délivrée par World Domination Enterprises il y a neuf ans déjà, n’a pas
de quoi arracher un sourire. Et la grande maîtrise technique des parisiens, avérée après trois opus ravageurs, exclut la thèse
de l’accident. On réécoutera avec profit « Aggravation » et « Excess & overdrive », chefs-d’oeuvre de trashcore extatique
couinant et crissant, pour s’en convaincre. (RT)
Tricky
Pre-millenium tension
Fort d’un sens marqué de la mélodie doublé d’une créativité coulant à flots, Tricky avait déjà posé la première pierre d’un
trip-hop prometteur. Depuis, beaucoup se sont engouffrés dans la brèche, banalisant ces sonorités mutantes. Tricky scelle
aujourd’hui avec l’impertinente facilité d’un génial glandeur sa volonté de conserver la longueur d’avance qui le sépare de
ses fades plagiats. A la fois plus « trip » et moins « hop », les contours indécis voire obscurs de « Pre-millenium tension »
attestent que la musique connaît aussi son esprit fin de siècle. Une voix tapie dans l’ombre, écornée d’un rictus malfaisant
sur un tempo tantôt chevrotant tantôt chuintant, et sublimée par des éclats sporadiques de sonorités urbaines : tels sont les
ingrédients du maître ! En variant savamment le dosage, celui-ci a rompu avec la monotonie parfois pesante de son premier
album. La douce torpeur et la sourde violence de « Pre-millenium tension », bien qu’omniprésentes, prennent pour notre
plus grand plaisir des formes inattendues. (PT)
U2
Pop
Avec un zeste de bon sens, on conviendra qu’ « Achtung Baby » était le meilleur album de U2. Habile recyclage du groupe
dans son époque, il brillait par des compositions aussi solides que diverses et amorçait un intérêt croissant pour le son.
Après le semi-ratage de « Zooropa », où l'innovation cotoyait le n'importe quoi, après l'épisode Passengers, remarquable
mais souvent ennuyeux, U2 avait sérieusement besoin de se repositionner. Première bonne surprise à l'écoute de « Pop » : ce
n'est pas ce qui se passe. Délaissant pour de bon l'héroïsme casse-bonbons qui fit leur renommée, les quatre Irlandais
persistent dans la vocation expérimentale esquissée dans « Zooropa ». Mais ici, pas de syndrôme Iznogoud : on n'essaie pas
de faire du Eno à la place de Eno, on se contente de faire de la pop en explorant - à petits pas - de nouvelles tendances
musicales. Et puis, de l'expérience Passengers, Bono et The Edge ont su tirer une qualité rare et précieuse†: l'humilité. Du
coup, le groupe n'a jamais été aussi sobre : chant plus subtil et guitares en retrait, on croit rêver. On le devine, « Pop »
aurait pu frapper très fort, sans même donner l'impression de lever le poing. Pour preuve : « Mofo », « Miami » ou encore «
Please », meilleurs extraits du cru. Dommage que trois ou quatre morceaux d'une désolante fadeur viennent ramener tout cela
à un niveau plus terrestre. Mais bon, il paraît que ce ne serait que de la pop... (SF)
Veruca Salt
Eight arms to hold you
Naguère porte-parole d’un pop-rock indie pêchu, Veruca Salt aurait pu revoir sa copie avant de nous la livrer, informe
magma poussif. Malgré un très bon premier morceau, dans la pure lignée L7 (toujours attendre la suite, après un très bon
premier morceau), l’album perd vite en intérêt. Hésitant entre des riffs à la Mötley Crüe et un son d’ensemble qu’on croirait
pompé sur un album des Throwing Muses, les morceaux sont confus, bruyants, plats, virant parfois à une parodie de Bangles
qui auraient mis leur doigts dodus (et mouillés) dans une prise électrique (j’en ris d’avance). Bien sûr, ce n’est pas
désagréable, mais on peut acheter (à moindre frais) les album originaux des groupes sus-cités, selon ses goûts personnels
(moi j’aime bien tout). « Walk like an Egyptian ». Na. (C)
Von Magnet

Mezclador
Somptueux et incantatoire, le flamenco postindustriel de la multinationale Von Magnet reste un cas unique dans le paysage
musical européen. C’est une invitation lente au brassage des époques et des influences, de Berlin au Sahara, des origines à
demain, chargée de songes entre drame et plaisir, chair et révélation. Le chant se veut presque classique, contrepoint
majestueux aux audaces d’une instrumentation qui recourt sans vergogne aux expérimentations techno comme aux différents
patrimoines culturels d’une Europe rêvée, oubliée à tort. (RT)
Weezer
Pinkerton
C’est le deuxième album du groupe. Cette noisy pop saturée, souvent copie (presque) conforme des Pixies et de quelques
uns de leurs nombreux enfants (Throwing Muses, Belly, Breeders etc.), agrémentée d’accents punk-rock ou de rappels à une
pop doucereuse façon Beautiful South, est super bien foutue, très entêtante, fleurant l’entrain et l’énergie, la sueur naïve du
musicos barré. Mais c’est tellement carré qu’on se demande si le groupe pourra trouver un jour matière à sortir des sentiers
creusés par leurs aînés. Hé les mecs, attention, les enfants des enfants des enfants sont parfois consanguins. (C)