ANECDOTES AMERIQUE DU SUD
En cours de
route, je me suis à l’époque beaucoup amusé à écrire de petits textes, quelque
peu satiriques, qui me permettaient de supporter les « cassures de
nerfs » nombreuses dans un voyage à vélo. Les voici rassemblées :
CHILI
DOUCES NUITS
Le moins qu’on
puisse dire, c’est que si les jours en Patagonie sont un peu monotones, ce
n’est pas le cas des nuits : une fois, c’est une bande de chevaux en liberté
qui vient faire la farandole autour de ma résidence principale. Peut-être
songeaient ils à entraîner ma monture dans leur chevauchée fantastique ? Une
autre nuit, la tempête me réveille en sursaut, et j’ai juste le temps de
rattraper au vol le double-toît qui se faisait la malle ; la nuit se terminera,
tente abattue et moi aussi. C’est une tempête du même type qui me contraindra,
une autre nuit, à déménager en toute hâte...
Au Chili, la nuit
est le temps des rapines : par deux fois, les chiens se servent sans vergogne
dans mes sacoches laissées imprudemment ouvertes ; une autre fois, c’est un
sanglier qui vient mettre mon vélo les quatre fers en l’air - excellente
position pour lui faire admirer le ciel étoilé !
“- Hay un
motor ?”, me demande un Chilien, dans un village relié depuis peu au reste
du pays. Non, et j’aurais finalement bien aimé en avoir un, pour cette Carretera
Austral. Cette “route” du sud du Chili est souvent plus proche du chemin de
montagne labouré par le sillon des jeeps, que d’une future autoroute à 6 voies,
avec ses pentes jusqu’à 20%...
Un exemple ? La
piste de Baja Caracoles (Argentine) à Cochrane (Chili) : après 400 km de désert
depuis Calafate, avec en tout et pour tout deux petits villages ne pouvant
fournir que des pâtes et quelques vieilles boites de conserve, je pars pour le
“grand” village de Cochrane, à 190 km de là. Rien entre, à part un petit poste
frontière, où l’on épluche consciencieusement tout le matériel, téléphonant
même pour savoir ce qu’on doit faire dans tel cas : c’est que les gabelous du
coin ne voient pas souvent passer un cycliste Européen, et qu’ils sont bien
désemparés devant ce cas hors-norme.
Au-delà commence
le Chili, ses forêts, ses montagnes, ses glaciers, ses rivières...Premier gué,
que je traverse aisément ; le deuxième, il me faut tout de même descendre de
selle, et pousser mon hors-norme ; idem pour le troisième, de l’eau aux
mollets. Mais voilà que j’atterris face à une rivière aux eaux tourbillonnantes
et glacées, large de 20 mètres environ. Pas le moindre pont ! Je défais donc
les sacoches, sauf la socoche de guidon, et commence à entreprendre la
traversée.
Brrr, qu’elle est
froide ! Il me faut avancer en crabe, avec la puissance du courant. De l’eau
jusqu’aux mollets...jusqu’aux genoux...jusqu’aux cuisses...jusqu’à la
taille...Eh mais, ça ne va plus : je n’ai plus que cinq mètres à faire, et je
me sens entraîné par le courant ! Je soulève le plus possible le vélo au-dessus
du niveau des eaux, la sacoche guidon prêt à vomir son contenu de dollars,
d’appareils photo et de passeport aux flots tumultueux. Le temps d’un instant,
j’imagine le tout emporté par le courant, le vélo et moi avec.
Juste à ce
moment, le sol remonte. Il était moins une. Je retourne chercher mes sacoches
en deux fois. La prochaine fois, je n’oublierai pas de sonder d’abord sans vélo
!
N'EN FAITES PAS UN FROMAGE !
“- Ouvrez voir
cette sacoche”.
Remake du célèbre
z-avez-rien-à-déclarer. La scène se déroule à un poste frontière chilien.
J’envisageais cette inspection comme une formalité. Comment avais-je pu oublier
que le Chili interdit l’entrée de produits frais ?
Il extirpe mon
sac de prunes, impossible à rater tellement il menace de déborder des coutures
de la sacoche.
“- Frutas, no”.
“- Je dois les
manger ?”
“- Si. Ahora”
(maintenant).
Et me voilà
ingurgitant bravement mon kilo de prunes, prévu à l’origine pour tenir deux
jours. Les fruits, c’est la santé ! L’inspecteur, non content de ce succès
prometteur, reprend, me faisant vider de fond en comble la sacoche.
“- Queso, no”.
Là, les oreilles
m’échauffent : je me vois mal me taper en 5 minutes 700 grammes de fromage !
“- Mais pourquoi
diable les produits frais sont interdits d’entrée au Chili ?”
“- Pour protéger
le bétail contre la fièvre aphteuse”.
Tu parles ! Ca
fait 22 km que je roule en territoire depuis le col, et ce petit poste
douanier, perdu dans la forêt, aurait la prétention de barrer la route aux
épizooties venues des hordes barbares d’Argentine ?
Remonté,
l’estomac lesté aux prunes, je décide de créer l’incident diplomatique,
espérant sans doute passer en début de journal sur Antenne 2 : je plante
ostensiblement la tente en pleine zone interdite, à deux pas des bâtiments de
la douane. Cela, prétendé-je, afin de consommer d’ici le lendemain tout mon
stock de fièvre aphteuse en puissance. Valeur de l’objet en litige : 7 FF. On a
des principes ou l’on n’en a pas.
Le combat de
tranchée tourne à mon avantage : une soudaine et brutale ondée retient les
forces de l’ordre de me déloger de mon pré carré. Les véhicules fréquentant la
route Bariloche - Osorno prennent pitié, sinon fait et cause pour ce petit
Français à vélo qui doit subir les rigueurs de la douane et de la météo.
Finalement, l’inspecteur obtiendra des carabineros qu’il me laissent
passer une nuit de camping très sauvage sur place. Et le gros du fromage
passera le lendemain matin au fond du duvet. Agréable odeur, pour les nuits
suivantes !
FROMAGE DE TETE
C’est un de ces
matins où je me levais si tôt que le soleil n’avait pas encore daigné cligner
de l’oeil. Le faisceau de ma lampe frontale surprend, dans les branchages
au-dessus de la tente, un gros chat. Un gros chat ? Un linx, oui, sans doute
par l’odeur du fromage alléché...Hello, du cyclo, que vous avez un beau
pédalage...Heureusement, j’avais mis l’antivol à mon vélo
Bon, je ne mange
pas que du fromage : de temps en temps, je prépare des nouilles, du riz ou de
la viande, plus bouillie qu’autre chose. Ach, gasdronomie vranzèse ! Pour ce,
je dispose d’un magnifique outil, un réchaud triple combustible. Et aussi
triple nouille, car il n’a pour ainsi dire jamais fonctionné. Aussi, pour
remédier à ce manque patent de chaleur, je me suis confectionné une merveille
de réchaud à alcool, avec deux morceaux de boîte de conserve. A faire breveter,
la fortune est au bout de mes roues.
TROC
Au bout de mes
roues, il y a peut-être la mauvaise surprise. “Là, il y a danger”, me signalent
les gendarmes Chiliens, mimant le tranchement de la gorge. Dans ce petit bois,
devinez quoiquigna, des bandes de malfrats pratiquant le troc bien connu du “tu
me donnes la bourse, je te laisse la vie”.
“Ils attaquent
même les bus”, reprennent mes pandores. Et ils plantent peut-être leur couteau
dans les phares avant, ces corsaires ? Je crois alors à une blague de carabineros,
pas fâchés de faire frissonner un peu le cyclo de passage. Et je m'accorde même
une halte au sommet du bois d'eucalyptus, à l'écart de la route.
Et pourtant, on
me confirmera ensuite la mauvaise fréquentation du lieu. J’ai donc bien fait de
planquer à tout hasard ma fortune dans le double-fond de mes sacoches. Juste à
côté du fromage.
ARGENTINE
LES
MALHEURS DE KIKO
Kiko, c’est le
diminutif de Federico. Ça, c’est Kiki qui m’la dit. Cocasse. (1)
Ce brave Kiko, le
long des routes souvent désertiques d’Argentine, a parfois bien du mal à
trouver un endroit discret pour planter la tente : les cactus ne sont pas
l’idéal pour poser le vélo. Cette nuit-là, le long d’une nationale bordée d’une
infinie platitude, je parviens enfin à trouver, derrière un très léger repli de
terrain, une petite cuvette me rendant invisible de la route.
Une petite
cuvette...Dans la nuit éclate un violent orage, digne d’un film hollywoodien.
Recroquevillé au fin fond de mon duvet, croisant les doigts de mains et de pieds,
je me vois déjà transformé en sardine grillé, un handicap certain pour tenir
ensuite un guidon de vélo, avec la majesté que suppose un tel acte.
Bien, l’orage
passe, je ne trépasse pas, mais...je sens le sol danser. Maman, je flotte ! En
effet, la pluie torrentielle sur ce terrain, sans doute membre de la Ligue Anti
Eponge, glisse et vient terminer sa course dans la cuvette où est plantée ma
tente amphibie. La côte d’alerte est vite atteinte, et je dois, en pleine nuit,
battu par la pluie et griffé par les épines, opter pour un repli stratégique
sur des positions pas vraiment préparées à l’avance. Water-l’eau, morne plaine.
Quel sot (d'eau) !
Kiko sauvé des
eaux, mais pas des trous d’air. Je reste basé deux semaines à Mendoza, chez
Serge et Ivana, jeune et sympathique couple Franco-Argentin. Serge est un
ancien cyclo-voyageur (3 ans et demi dans les trois Amériques) reconverti dans
les délices du mariage et de la paternité, avec leur modèle réduit nommé
Emmanuel. Depuis ce camp de base, je décide de faire une boucle de 3-4 jours,
avec le Portillo Argentino (4 380 m) à l’affiche, 3 500 mètres de montée depuis
la plaine. Dès 1 700 m d’altitude, la piste n’a pas du voir grand monde passer
depuis San Martin, le grand libérateur local.
Au menu, vent
fort de face, caillasses et pierriers, et pour finir neige et piste à moitié
fondues, sans parler de l’auteur de ces lignes. Mais le paysage, superbe, fait
oublier ces menus problèmes. Je vais bientôt déchanter, et même déjanter: les 4
chambres à air de mon deux-roues vont connaître un total de 30 crevaisons en un
kilomètre de parcours !
Responsable : la
“yareta”: de l’aspect extérieur d’une mousse parsemant cette piste
quasiment à l’abandon, cette mousse d’apparence douce et inoffensive recèle en
fait de redoutables piquants. 30 trous transformant mes chambres à air en
gruyère, et la série continue : durant 3 semaines vers le nord de l’Argentine,
je vais continuer, sur un rythme moyen de 1 ou 2 crevaisons par jour, dues
cette fois aux “rosetas”: ces épines à tête multiple, et même à têtes
chercheuses, à constater leur propension à aller se glisser juste sous mes
pneus. Propension qui n’a d’égale que le fameux don des moucherons d’aller se
suicider dans les yeux du cyclo, de préférence dans les descentes.
Kiko pas sauvé
des trous dans les poches non plus : passant deux nuits dans un refuge
militaire, je repars, momentanément délesté de mon appareil photo et de mes
papiers, subtilisés par un soldat. Ses deux compagnons de faction, comprenant
de quoi il retourne, ennuyés par l’incident, partent dans la montagne à la
recherche du larron, et reviennent une petite heure plus tard, le fruit du
larcin entre les mains. Nestor, le caporal, se confond en excuses. Dame, son
invité se fait voler dans l’enceinte du refuge dont il a la garde ! Je le
rassure. Pour moi, l’incident est clos, je ne garderai que le souvenir de deux
soirées joyeuses. Mais si on ne peut même plus avoir confiance dans l’armée...
(1) Kiki,
Christina en cette occasion. Kiko, c’était aussi un clown Mexicain, très connu
en Argentine, et qui a nommé son émission à la télé : les malheurs de Kiko.
D’où the titre, CQFD coco !
Andalgala,
provincia de Catamarca, Argentina. Adossée aux Andes, “à 80 km du bout du monde” comme se plaisent à
le dire les habitants de cette ville enclavée, à la porte des quasi-déserts du
nord-ouest de l’Argentine. Dans cette ville perdue, un cycliste chargé comme un
mulet ne passe pas inaperçu ! C’est un journaliste qui me tombe dessus le
premier.
Il aurait mieux
fait de tomber du lit en se levant. Cet imbécile, dans le but louable de me
rendre service (?), a la fine idée de me faire passer par le commissariat. Où
l’on m’apprend que les étrangers sont tenus de se présenter dans chaque ville
traversée. Première nouvelle, depuis plus de trois mois que je suis dans le
pays ! Ainsi que je l’apprendrais plus tard, cette ville serait un point de
passage du trafic de drogue, qui éviterait ainsi la route principale. “Donc”,
le cyclo vagabond est un drogué ou un drogueur en puissance. “Donc” suspect.
Donc, chef, on matraque ?
Non, pas si vite.
On fouille d’abord, par acquis de conscience. A deux pas des cellules, histoire
de me mettre dans l’ambiance. Et me voilà contraint de vider une à une le
contenu de mes sacoches. Remarquez, ça m’a permis d’exhumer des affaires
oubliées depuis des lustres, coincées dans les triple et quadruple fonds crées
par les trépidations de la piste. A la Eliott Ness, le chef examine le lait en
poudre, le sucre, la purée déshydratée. Quel dommage que je n’aie pas de
farine, de sel fin et du plâtre, on aurait fait durer le plaisir !
Faisons durer
quand même : après une fiche anthropométrique remplie dans les moindres
détails, on passe, sinon aux aveux, du moins aux empreintes digitales : les dix
doigts, six fois chacun ! Dans le lot, il doit bien y avoir un exemplaire pour
Interpol, un pour la CIA et un pour le KGB, c’est pas possible autrement. Mais
décidément, ce dealer est trop retors : si les passeurs de drogue poussent le
vice jusqu’à ne pas passer de came, où va-t’on ? Il y a bien cette énorme
citrouille de dix kilogs, qui occupe une sacoche entière. Je signale que je
l’ai trouvée la veille le long de la piste, mais le chef, intelligent, n’en
croit mot. Le coup de Blanche Neige, on lui a déjà fait.
Deux heures
après, me voici dûment fiché, ce dont je me fiche éperdument. A part qu’à cause
de ces singeries, les boutiques sont fermées, et que je dois attendre jusqu’au
soir pour me ravitailler. Je tue le temps en me rendant à la télévision locale
passer sur le petit écran, sans même relater l’incident. Décidément pas
veinard, je tombe sur un pro qui me
pose des questions pointues sur la situation politique et économique de son
pays ! Côté police, je peux le rassurer, ils sont au point...
TRANSPORTS EN GROS
“- Tirame” (tirez-moi). Je me retourne :
non ce n’est pas une hirondelle, c’est un “cycloville” qui m’interpelle. Un bon
gros qui rentre du travail, essouflé par la modeste côte à la sortie de
Tucuman.
“- Tirame”, insiste-t’il voyant que je ne
comprends pas, “c’est bien une moto que tu as ?”
Je saisis: comme
il m’est arrivé plus d’une fois, il a pris mon vélo cerné de grosses sacoches
pour une moto ! J’ai beau lui dire que je n’ai pas de moteur, il pose une main
assurée sur mon sac arrière, afin que je l’entraîne. Et il faut que je lui fasse
la démonstration de mes mollets (galbés) pour lui faire lâcher prise.
Toujours guère
convaincu. Comment pourrait-il comprendre que cette machine bourrée de sacoche,
surmontée de ce gringalet même pas bouffeur de viande (1 kg par jour minimum),
peut aller plus vite que lui, robuste Argentin même par chargé, sinon de
quelques bourrelets de graisse, dans cette montée ? Bah, il y en a bien
d’autres qui s’approchent de moi, le porte-monnaie à la main, flairant l’offerta
(la bonne occasion du jour) : ils me prennent pour un marchand ambulant, et me
demandent ce que je vends. Difficile de leur répondre que je n’ai que du
courage à revendre !
Bon, chargé c’est
un fait. Mais je ne dépare guère dans le paysage : des paysans arrivant en
ville avec d’énormes sacs de fruits ou légumes, des triporteurs chargés à
ras-bords, des remorques garnis. Pour l’instant, le record: un soir, à Salta,
une famille de six personnes (dont il est vrai des tarifs réduits) sur le même
vélo. Et tous en place assise, un vrai transport collectif !
L’ORDURE NOIRE
Et celle du
bonhomme qui se brosse les dents avec du cirage, vous la connaissez, je pense ?
Afin de renouveler un peu ce gag, dont on ne se lasse pourtant pas, j’ai
introduit un élément nouveau : le kerosen.
Car sur l’altiplano, ma réserve d’alcool à brûler a fondu comme glace au
soleil, avec cet air qui pompe tout, des muscles au combustible. Et dans des
villages indiens parsemés de loin en loin, le pétrole fait l’unanimité.
L’ennui, c’est
que ce produit aspire à lier connaissance avec ses voisins de sacoche. Et que
la plus étanche bouteille enveloppée dans trois plastiques ne saurait être de
taille à lutter contre cette noble aspiration conviviale. résultat, vous ne
tardez pas à entamer une page plus tout à fait blanche pour écrire, à croquer
une pomme au délicieux goût de pétrole, à enfiler une paire de chaussettes -
ah, là, ça améliorerait plutôt.
Quant au pouvoir
calorifique, ça me laisserait plutôt froid : pour enflammer la tente, même à 3
mètres de distance, ce serait plutôt parfait, avec ces flammes jaunes qui se
rabattent toujours du côté où l’on ne voudrait pas. Par contre, pour distinguer
les flammes bleues chauffantes, un microscope serait le bienvenu...Un point
noir, en tout cas : non seulement la popote, les paravents artisanaux sont
noircis quasiment en profondeur, mais vous ne tardez pas à en avoir plein les
mains, les vêtements, les sacoches...
A LA SOUPE !
Voici un bon mois que je tournicote sur l’altiplano argentin, alors qu’il
suffirait de 4 ou 5 jours pour le traverser de part en part ! Mais voilà, une
piste qui s’embranche à droite ou à gauche de la RN 9 vers des lieux inconnus,
et ma nature reprend le dessus : il faut que j’aille voir un peu comment c’est
fait là-bas.
C’est l’hiver, et les nuits sont froides : le thermomètre a pris l’habitude
d’indiquer entre -10 et -18° au petit matin. Ce qui me fait des soirées et des
matinées agréables, pelotonné au fond du duvet, en attendant que ça se passe. A
l’occasion, je demande l’hospitalité dans une école ou à la police. Une fois,
ce fut dans les barraquements d’un cantonnier.
En ce dimanche soir, un seul employé assure la garde, tout heureux de
passer la soirée avec un voyageur venu de si loin avec sa bicyclette. Le
bonhomme m’invite à partager sa soupe vespérale : un cyclo est parpétuellement
affamé, et ne saurait refuser une telle proposition, alléchante au sens
littéral. “Mas ?” (plus). Ben oui, puisqu’il y a ! Deuxième écuelle de guiso,
cette soupe épaisse qui tient bien au corps. Il me propose à nouveau d’en
reprendre.
Cette fois, je n’ose accepter : je me mets à penser qu’il est peut-être en
train de prendre sur sa part du lendemain...En un tour de main, voilà le reste
de la soupe dans la gamelle du chiot, que celui-ci se met à lapper, choisissant
les morceaux les plus intéressants, délaissant le reste. Zut, c’est que
j’aurais bien pris les restes en question, et sans faire le difficile comme ce
fidèle compagnon ! Il s’en est fallu de
peu que je n’aille disputer quelque os à ronger à ce chiot joufflu et mordeur
de mollets cyclistes...Affameur, va.
LES ARGENTINS: DES HOMMES DE
TERRAINS
Vous en avez eu plein les oreilles, du Mondiale? Bien, pour changer,
nous allons parler futbol. C’est que l’Argentine, par une chance que je
ne saurais attribuer qu’à la présence mascotte d’un bon petit cyclo Français
sur son sol, a réalisé un parcours surprenant dans la dernière Coupe du Monde.
Surprenant, vu les “performances” de son équipe. Le Brésil est réputé pour être
fou de foot, mais l’Argentine ne l’est guère moins. C’est tout juste si Menem,
le Président de la République, n’allait pas chuter, suite au “désastre” face au
Cameroun (1-0).
Heureusement, les “gooooooooooooooooooooool”(j’abrège) interminables des
commentateurs ont refait surface - à croire qu’ils sont embauchés d’après leur
capacité thoracique, plus que sur la qualité de leurs commentaires. Mais le
plus surprenant, pour le cyclo, lorsqu’il a roulé 20 ou 30 km dans un désert
apparent fait d’arbustes, de caillasses et de lamas, est de tomber tout-à-trac
sur un terrain de foot surgi de nulle part, avec juste 2 ou 3 fermes à
proximité. Un recensement viendrait sans doute nous confirmer qu’il y a plus de
“canchas” de foot sur la puna que de cafés à Paris, ce qui ne serait pas
une moindre performance !
ABRA-VISSIMO
Les gens d’ici
ont fréquemment tendance à confondre l’altitude des sommets avec celle des
cols. En Terre de Feu, on m’avait “promis” pour m’inquiéter un Paso Garibaldi à
1 500 m, ce qui ne pouvait que m’allécher. Enlevez seulement un zéro, et vous
aurez tout juste ! A Salta, il a fallu que je bataille ferme face à des gens
qui me situaient l’Abra del Acay à 5 900 m, en fait l’altitude du sommet du
Nevado del Acay. Le col, lui, se situe plus modestement à 4 895 m, néanmoins
une bonne mise en jambes pour l’altiplano.
Il doit plutôt
s’agir de l’abra de la caille, avec ce vent violent, glacé contre lequel j’ai
du lutter. La piste est aujourd’hui quasiment désaffectée, au sol mou,
caillouteux, avec de la neige dans les derniers lacets, et la redoutable puna
coupe le souffle et semble couper la tête en deux. Les 5 ou 6 derniers
kilomètres me demandent près de 2 heures de marche. Mais quelle sensation
grisante de parvenir à vélo plus haut que notre riquiqui Mont Blanc ! Et quel
beau début d’angine les jours suivants, sur l’altiplano, nuit à - 15°..
SAINT MILLE, PRIEZ POUR
NOUS
Non, j’vous jure, je dois être un peu casse-cou. Il ne m’a pas suffi, une
fois, de me retrouver perdu sur une piste de montagne, sans mes précieuses
sacoches laissées dans la vallée, les jambes trempées après la traversée d'une
rivière alors que tout se mettait à geler, pour ne retrouver mon campement
qu’après deux heures à rouler de nuit sur une piste fort caillouteuse,
entrecoupée de rios à moitié congelés à traverser: je tenais à récidiver ce
genre de l’exploit de l’inutile.
Lieu choisi : la Mina El Aguilar, dont j’avais auparavant aperçu le réseau
de chemins courant haut dans la montagne. On m’avait rejeté à l’entrée
principale, alors même que j’essayais de faire passer ma casquette de cycliste
pour un casque de mineur. Ils sont physionomistes, quand même...Qu’à cela ne
tienne, je faisais plus tard, et par hasard, la découverte d’un accès
superbement ignoré de quelque carte que ce soit, et seulement connu localement.
Impressionnante, cette mine : une ville à 3 931 m, l’autre perchée à 4 509
m, les deux alignant des corons, tout de même moins miséreux que ceux aperçus à
Mina Pirquitas (où les mineurs ne sont plus payés depuis...9 mois). Une
activité de fourmis, de taupes plutôt, pour extraire zinc, plomb, argent.
Le petit fûté que je suis (si) a fini par trouver un chemin culminant un
peu plus haut que les autres : 5 010 m. Voici donc cette ligne symbolique des 5
000 m franchie ! Vue quasi-circulaire sur le moutonnement des chaînes de montagnes à l’infini, avec la
ville d’El Aguilar 100 m en-dessous. Et la nuit tout proche ! Bien que
bénéficiant d’un ultime rayon de soleil, il fait déjà -2°. Grand temps de
dévaler le chemin, à la manière d’un contre la montre, pour camper à des
altitudes tout de mêmes plus sereines: 4 550 m. En plein hiver austral, et ses
-15°. Avec une tempête de tous les diables qui se lèvera dans la nuit. Fou,
vous dis-je.
LE VELO, C’EST DU BOULOT
En redescendant de la Mina El Aguilar, je croise un mineur. Rencontre
extraordinaire, persiflez vous. Laissez-moi finir, bon sang ! Ce mineur,
surpris de croiser un type bizarre, au drôle d’accent et au curieux vélo,
s’enquiert: “vous êtes un padrecito ?” (curé, littéralement: petit
père). Bof, j’ai l’habitude de ce genre de réflexions. Combien de “foi” l’on
m’aura demandé si je réalise una promesa...En effet, comment expliquer
autrement qu’un type s’aventure dans la montagne ? C’est vrai qu’il faut
l’avoir, la foi, pour rouler si haut - si près du ciel ! Surtout avec ce temps
si froid. On dit qu’elle soulève les montagnes, elle permet au moins de les
franchir.
Cependant, sur la puna (l’altiplano argentin), on me prend aussi
pour un ingénieur, un universitaire, que sais-je encore: un type suffisamment
obstiné, pour chercher à grimper toujours plus haut, dans ce pays bourré de
mines, ce ne peut être que pour faire des investigations, pas vrai ? Ma foi...
O GUE, O GUE
Mais quelle idée
m’a pris d’aller me fourvoyer sur cette piste à l’abandon, raccourci élastique
entre Tucuman et Salta ! J’aurais du écouter ces paysans, qui m’annonçaient
sept gués à franchir. Mais non, je n’en fais qu’à ma tête. Pourquoi faire
simple, quand on peut faire compliqué ?
Sur 45 km d’une
piste envahie par l’herbe, c’est en fait 18 gués que je vais devoir traverser,
pieds et genoux dans l’eau, m’enfonçant dans le sable, luttant pied à pied dans
les raidillons caillouteux, zig-zagant dans la boue, me coinçant dans les ornières
tracées par l’unique tracteur passant régulièrement par là. Allez, le détour de
huit heures par cette quebrada (canyon) verdoyante, bordée de falaises
colorées, valait la peine. Mais juré, promis, désormais, j’éviterai les pistes.
Serment de cyclo..
BOLIVIE
LA FETE AU VILLAGE
C’est la fête au village. Oui, mais nous sommes
en Bolivie : en guise de flon-flons, ce sera tambours et sikus (flute de
Pan) ; en guise de majorettes, des spectacles présentés avec fierté par chaque
groupe du village, écoliers au premier rang. Et le maître d’école promu chef
d’orchestre de toute cette organisation. La cause ? 6 Août, fête de
l’Indépendance, suivi par le 7 Août, fête du Drapeau, suivi du 8 Août,
fête...de la chicha. Car cet alcool léger, né de la fermentation du
maïs, va couler à flots. Et c’est traître !
Le village tout entier accueille à bras ouverts
ce témoin inattendu, venu d’un lointain si peu imaginable. Invité d’honneur, on
me remet une couronne de pain, hautement symbolique pour ce peuple qui se bat
chaque jour pour sa subsistance ; on m’invite à jouer au sikus, parmi le
groupe de musiciens interprétant cette fameuse musique andine ; Isabel
l’institutrice m’entraîne dans la farandole...et l’on me sert, à l’égal des
autres, de bonnes rasades de chicha, qu’on gros buveur de bière style Papa
Talon ne mépriserait pas.
La fête se terminera à quatre pattes, et le
joueur de sikus improvisé se noiera le sifflet. Panne de son et d’image.
Passants, méfiez-vous de la chicha ! Re-belote du 15 au 18 Août : on
vénère la Vierge de Urkupina, ce qui donnera, dans la plupart des villages où
je passe, à de nouvelles festivités. Mais cette fois, je connais la chicha…
LE PLAISIR D’ESSENCE
Pause déjeûner, un mini-bus s’arrête à ma
hauteur. Pas moyen de manger tranquille ! Raison à cela : panne sèche. Un type
s’extrait de l’engin, et vient me demander un litre de gasolina. Devant
ce qui lui parait de ma part comme un refus de leur venir en aide, il se permet
d’insister :
“- Juste un litre, pas plus, vous trouverez
bien à en racheter au village voisin”.
Allons bon, voilà qu’on me prend une fois de
plus pour un motard ! Il est vrai que la charge de la bestiole est
impressionnante, dépassant les 60 kg : non content d’avoir dans les sacoches
l’équivalent d’un vélo entier en pièces détachées, de compter une garde-robe à
la Veuve Marcos, j’ai de plus une autonomie (je devrais dire vélonomie) de 5 à
7 jours en nourriture, comme si je craignais de mourir de faim en cours de
chemin ! Va falloir que je me crée d’autres handicaps, 50 kg de sable en plus,
ou rouler freins serrés. Pas assez dur, le vélo !
TRI(SA)TURATION
Vous prenez d’un côté un pneu dont la corde n’est guère plus raide, au
point de laisser la chambre glisser un oeil furtif sur la chaussée, histoire de
s’éclater ; de l’autre, un pneu de rechange déjà bien usé, dont la vie des
manchons (bouts de pneu que vous avez cousus à l’intérieur pour renforcer les
zones entaillées au niveau du contact avec la jante) ne tient même plus par un
fil. Aucun autre moyen de réparer, perdu que vous êtes sur l’altiplano.
Solution ? Mettre un pneu dans l’autre, et le tour est joué, pour 2 000 km de
plus. C’est sans doute cela, mettre toute la gomme...
CHRONIQUE D’UN VOYAGE ANNONCE
Ce groupe de 4 Allemands avait un projet clair, précis, bien défini. En un
mot, net et carré : rallier les chutes de Iguazu, à la frontière Brésil -
Paraguay - Argentine, à Quito, capitale de l’Equateur. Le temps était bien
délimité, trois mois juste. étapes bien prévues à l’avance pour chaque soir,
bref, ces amis Germains n’allaient pas se laisser surprendre par de stupides
imprévus, du style de paysans les agressant de questions (du reste, un seul
parlait un peu d’espagnol, ce qui limitait les risques), de visites de villes,
joyaux de l’art colonial, de coutumes ancestrales, etc..
Une exception : Cuzco, car il fallait avoir ce site sur ses cartes de
visite, par conséquent sur sa carte de route. Mais, afin de ne pas perdre
stupidement de temps sur le rugueux altiplano, les billets d’avion de Cuzco à
Arequipa étaient d’ores et déjà retenus. Un voyage, ça se prépare, et bien. Du
reste, ce raid, minutieusement programmé, ne laissant place à aucune fantaisie
de ces cigales imprévoyantes de Latins, allait leur montrer, une fois de plus,
la justesse de leur position en tous points.
Les Chutes de Iguazu, rapidement mises en bobine, afin sans doute de ne pas
abîmer le paysage de leurs regards d’acier (noble souci écologique), ne leur
montraient que trop l’écoulement rapide du temps : vingt minutes de retard
venaient d’être prises en même temps que les photos, fort heureusement
rattrapées (les minutes) le soir-même, grâce à la force, à la puissance de ce
quarteron de cyclos d’active.
Le trajet en Argentine fut conforme aux prévisions. Certes, la région
traversée n’était pas vraiment très intéressante, mais pas question par exemple
de faire un détour vers les Andes, trop lointaines et gaspilleuses de ce
précieux temps minuté. Ils avaient eu écho de ce cyclo, un Français disait-on,
qui y était resté traîner deux mois. Ils pénêtrèrent donc en Bolivie le jour
dit, à l’heure dite, après avoir évité Salta et Jujuy, villes argentines d’un
certain intérêt. Mais leur programme, aux contours fixés depuis les environs
d’un robuste et ferme mur (abattu depuis), n’avaient pas prévu d’après-midi
libre dans le secteur.
Or donc, nos amis passèrent en trombe Potosi, cette ville minière à 4 000 m
d’altitude peuplée d’Indiens. En avance de deux heures, grâce à un vent
favorable non compté à l’origine, ils avaient eu le temps de faire la photo
typique du groupe, à côté de ces si pittoresques vendeuses d’empenadas
sur une petite place. Ils eurent même la tentation de visiter la casa de la
Moneda. Seulement voilà, la visite guidée durait deux heures...
Ils atteignirent Sucre deux jours plus tard. Certes, la campagne était
charmante : avant de partir, ils avaient même lu un guide leur parlant des
fêtes et de la musique bolivienne. Mais eux, dans tous les villages, on voulait
les faire payer pour les héberger. Ils n’avaient pourtant pas des têtes de deutschmarks, enfin ! A Sucre, ils
cherchèrent le lieu idéal pour la photo, revêtus de leurs splendides combis
fluo. Un type mal barbu, habillé d’un survet terne, accompagné d’une femelle à
pied, qui sait une autochtone, essaya de leur parler, dans une espèce
d’allemand tel que le parlent ces sous-évolués d’Outre-Rhin.
Ils n’accordèrent fort justement aucune importance à cet importun, et
trouvèrent enfin le lieu idoine : face à une entrée de caserne, vaguement type castillo colonial. Il y avait certes
d’autres sites dans cette ville-musée, de l’université aux églises et aux
monastères...mais aucun ne cadrait avec leur angle de vue. tandis que cette
caserne...
Depuis l’entrée en Bolivie, le parcours était dur : de la piste, de la
piste, de la piste. Certes, cela avait été pris en compte dans le délai, mais
enfin...A Oruro, ils retrouvèrent la route, plus seyante pour leurs tenues
fluo. Hélas, deux d’entre eux, dans la nuit, furent pris de malaise. Ah, ces
cochonneries boliviennes! C’était décidé, le prochain raid, ils se feraient
accompagner d’un camion transportant la nourriture et l’eau, amenées depuis
l’Allemagne. Mais là, dans l’immédiat, c’était un coup dur. Comment faire, pour
ne pas prendre de retard, tout en respectant le challenge ? Ils décidèrent que
les deux malades sauteraient deux jours en “gagnant” directement La Paz en bus,
tandis que les deux valides continueraient à vélo.
C’est à mi-chemin entre Oruro et Sica Sica qu’ils rattrapèrent un cyclo mal
rasé, au vélo chargé à ras le guidon de sacoches rapiécées. Quel curieux animal
! Il était Français, ce qui ne les surprirent pas : toujours aussi mal
organisés. Dire qu’il fallait faire l’Europe avec ces inconséquentes gens....Il
était zu viel, ce petit Français: ça
faisait huit mois qu’il était parti de la Terre de Feu, après 17 000 km. Mais
quel tarte ! Depuis Ushuaïa, il y avait tout au plus 7 000 km par la route
directe ! Sans doute n’avait-il pas bien planifié son voyage, et qu’il errait
de droite à gauche, sans bien savoir où aller. Non, décidément, ces cousins
Gaulois, on les connaissait trop bien. Tandis qu’eux, avec leurs cartes topo
achetées pour quelques dizaines de poignées de marks dans des magasins
spécialisés d’Allemagne...
Il valait tout de même la photo : sa dégaine, ses vêtements en lambeaux, et
surtout son assemblage à l’avant, un pneu troué sur un autre pneu en guère
meileur état. Et ce drôle, en début d’après-midi, ne savait même pas où il
allait passer la nuit ! Eux, c’était bien sûr rêglé, Sica Sica ce soir, La Paz
demain. Mais ils ne comprenaient pas comment ce gringalet, par un itinéraire
plus long et plus dur, ayant traîné invraisemblablement dans ces villages
boliviens, avait pu aller aussi vite qu’eux depuis Sucre. Un voyage dans une
autre dimension, sans doute...
Il ne leur restait plus qu’un mois pour atteindre Quito : pas le moment de
relâcher l’effort. Une fois regroupés, ils passèrent donc Copacabana, Puno,
pour atteindre Juliaca, trois villes situées sur cette merveille de la nature,
j’ai nommé le Lac Titicaca. Quelle ne fut pas leur surprise de voir que la
piste au-delà de Juliaca était dans un état excécrable ! En plus, on leur
parlait du risque de se faire attaquer. Ils décidèrent donc de prendre le train
jusqu’à Sicuani, où reprenait le goudron. Sans cette légère entorse à leur
programme, sans doute n’auraient-ils pu le respecter.
Cuzco valait la peine. Pour se rendre à Machu Picchu, ils prirent le train
des touristes. Certes, ils n’avaient plus le vélo, mais enfin, ils avaient les
ruines en boîte, n’était-ce pas là l’essentiel ? Les ruines : ah oui, elles
n’étaient pas mal. La luminosité, surtout, pour les prises de vues. De Cuzco,
avion comme prévu pour Aréquipa. Ari queypa, “ici, la ville” en quechua,
et là bas, Quito, au bout de la ligne droite, de cette panaméricaine péruvienne traversant un désert de sable.
A Nazca, ils louèrent un avion pour tirer le portrait des célèbres pistes
du lieu : leurs sponsors seraient contents. Lima ne les retint guère : la garua,
cette brûme persistante, ne permettait pas de bonnes photos. Si, cependant, ils
avaient pu, audace suprême, prendre un véhicule blindé (en photo bien sûr),
l’élément de frisson de leur futur diaporama. On leur avait dit qu’il y avait
des guerilleros dans la montagne, cela renforçait le côté aventure de
leur authentique exploit.
Bref (oui, bref), poussés par le vent, ils abattirent le nord du Pérou en
neuf jours. Vraiment pas intéressant, sinon le temple Arco Iris, près de
Trujillo, bien situé sur la Panam’, et facile à cadrer. Cependant, à cause de
cette saloperie de nourriture locale, un autre membre du groupe tomba malade.
Il ne pouvait plus suivre le rythme rêglementaire, et dut donc rentrer en
Allemagne plus tôt. C’est donc à trois qu’il rentrèrent en Equateur.
A ce moment, vers Riobamba, ils croisèrent un barbu. Vu sa dégaine, tout à
parier que c’était un Français. Gagné! Lui non plus ne tenait pas un parcours
bien logique : parti des USA, il atteignait l’Equateur après onze mois de
route...pour retourner en Colombie! Affaire de femme, disait-il. Non, ces
Français, jamais on ne pourrait les comprendre. A faire des détours inutiles,
sous le prétexte fallacieux de mieux connaitre le pays. Alors que la Panam’
suffisait bien largement pour cela, non ?
Allez donc, à celui-là, le pneu arrière menaçait d’exploser rien qu’à le
regarder de trop près, et l’on voyait la chambre à air vouloir faire bande à
part. Vraiment trop. Une habitude, ces Français, de rouler avec des rapiéçages
! A ce malheureux, ils allaient donc donner
un de ces pneus pliés qui leur étaient désormais de trop. Ce serait une
contribution au rattrapage économique de la France.
Quito fut atteinte avec une avance de quatre heures : le temps de faire
cadrer les tenues fluo avec les principaux monuments de la ville. Voilà, leur
projet de trois mois était réalisé, les pièces d’un superbe et original
diaporama stockées. Ils étaient fiers d’eux, non sans raison : ils avaient fait
les Andes. Les Indiens ? Ah oui, ils en avaient photographié sur les marchés,
moyennant quelques dollars. L’an prochain, ce serait le Japon en deux mois. Dès
leur retour en Allemagne, ils allaient travailler au découpage minutieux des
étapes journalières. Eux, au moins, n’attendaient pas qu’un pneu soit crevé pour
en changer !
Quatre Allemands dans le vent (Kersten, Stefan, Thomas et Boris), avec
Frédérick Ferchaux puis Thierry Lahrer dans le rôle de faire-valoirs Gaulois.
PEROU
RENCONTRE DE TOUS
TYPES
- Dis-donc, Aténa, ce sont tes roulements qui craquent comme ça ?"
"- Mais non, sot, tu vois bien que ce sont des bruits de mitraillettes
!"
"- Ah bon, je me disais aussi...Comment ça, des bruits de
mitraillettes ?"
"- Bah, que veux-tu qu'ils nous fassent, on ne les intéresse
pas..."
D’accord, mais enfin, je n’aimerais guère me trouver face à un canon de
fusil. On ne sait jamais, des fois que
ma tête ne leur revienne pas...Nous nous trouvons, ma bicyclette et moi, sur la
difficile piste des Andes, au Pérou. Cette piste a tout pour plaire : chaussée défoncée,
montées ahurissantes, chiens agressifs, et terroristes en armes ! Tout en préparant mon déjeûner le long de la
piste, je contemple cet altiplano désert, à 4 000 m d’altitude. Arrive alors un
camion : enfin quelque chose de rassurant. Mon optimisme tourne court : des
types armés, au visage recouvert d’un passe-montagne, semblent avoir pris à
l’abordage le poids lourd. Crânement je...
“- Menteur, tu tremblais comme une feuille morte !”
“- Tais-toi, Aténa, ils n’ont pas besoin de savoir cela !”
Reprenons. Pas très rassuré donc, je réponds à leur question. En fait, je
comprends bientôt qu’il s’agit de policiers en patrouille, venus surveiller
s’il n’y a pas de “compañeros” sur la piste. Non, juste un cycliste un
peu fou, en train de préparer une gamelle de riz, en plein territoire du
Sentier Lumineux. Inutile que le coeur a mis du temps à battre à un rythme
moins rapide, et pas seulement à cause de l’altitude...
Fausse alerte. Ce n’était que partie remise : au Paso Chonta, à 4 853 m
d’altitude, dans la neige virevoltante d’un orage d’après-midi, arrive un
véhicule. Me voyant, les occupants, armés jusqu’aux dents, arrêtent brusquement
la voiture, se concertant, comme pour savoir ce qu’ils pourraient faire de moi.
Sûr de moi, je...
“- Tu parles : tu te demandais plutôt dans quel pétrin tu t’étais mis !”
“- Bon, ça suffit, Aténa, sinon je te jette à la ferraille !”
Donc, j’attends que le véhicule arrive à ma hauteur. Deux ou trois
questions, d’où je viens, qui je suis, de quel pays je suis, et salut ! Ces
types ne m’inspiraient pas confiance, et je n’ai pas traîné à descendre le col
: surtout que mes bonhommes s’arrêteront un peu plus haut, sur la piste montant
à plus de 5 000 m depuis le col. Le regret de ne m’avoir pas mis un peu de
plomb dans la tête ?
“- Tu en aurais bien besoin : déjà que ton histoire a du plomb dans l’aile
!”
“- Aténa !”
LE DANGER PLANE SUR LES SOMMETS
L’homme est seul, debout dans son poncho, au
Col de Punta Callan, à 4 225 m d’altitude. En soi, rencontrer des Indiens à
cette altitude n’a rien d’exceptionnel : nombreux sont les bergers et bergères
à emmener paître leur maigre troupeau de moutons et de vaches, là où l’on
côtoie le ciel. Mais celui-ci n’a aucun animal à sa disposition pour
“justifier” sa présence, que je ne peux m’empêcher de trouver insolite.
M’apercevant, il se dirige à grands pas, comme pour aller à ma rencontre. C’est
alors que j’aperçois, dépassant du poncho, mal dissimulé par la main gauche, le
canon d’un révolver !
“- Buen’
dia”, je lance, peu rassuré.
“- Hola,
como estas, hermano !” (salut, comment vas-tu, frère !).
Et le type me croise, alors qu’une voiture nous
dépasse. Ai-je eu la berlue ? Je m’arrête un peu au col ; lui aussi, 50 m plus
loin. Je décide malgré tout de m’en tenir à mon programme, et de monter à un
autre col, la dernière occasion de me retrouver à plus de 4 500 m avant
l’Equateur. Une fois que je m’éloigne, le poncho revient à sa place, à l’exacte
intersection des pistes !
Que faisait ce jeune avec une arme ? D’où la
tenait-il, et pourquoi ne m’a-il rien fait ? Mystère. Le passage de la voiture,
au même moment, l’a-t’il fait hésiter ? Ou bien, il pourrait s’agir d’un “compañero”
(guerrillero du Sentier Lumineux) chargé de surveiller cet axe, en sentinelle
avancée...Plus sûrement, le membre d’une milice paysanne, chargé justement de
lutter contre les guerrilleros et leurs exactions.
Après tout, cela fait deux soirs de suite que
j’entends mitrailler autour de Huaraz, avec même des grenades en guise de feu
d’artifice. Je suis dans le bain ! Déjà la veille, au col de Curcuy, j’avais
croisé un curieux type vêtu d’un poncho, qui semblait comme surveiller les
flancs de part et d’autre de la passe. Et au col de Conacocha, toujours dans
les mêmes altitudes aériennes, c’étaient des policiers qui scrutaient, l’arme
en main, la moindre motte de terre dans la pampa en contrebas, où j’allais
camper pour la nuit. Ne bougez plus, vous êtes surveillés !
Huaraz était la dernière occasion de revoir les
Andes péruviennes, m’échappant ainsi de l’archi-monotone Panamericana, sur 1300
km. Splendides paysages de montagne enneigée, avec la cordillère tropicale la
plus haute du monde (6 700 m). Mais décidément, désormais, il pleut trop, et
les pistes deviennent parfois de véritables bourbiers.
Quelques Péruviens me mettent du baume au cœur
: tel cet hôtelier qui m’offre une statuette “d’époque” Chimu (z’avez pas de
carbone 14 sous la main ?) ; tel ce type qui, à Talara, va m’inviter, courir la
ville pour me trouver du kérozène industriel, pour me laisser quelques billets
en poche pour continuer ma route...Ou bien, ce soudeur me posant gratis un
renfort sur mon cadre en bronze (d’époque !), histoire qu’il ne me claque pas
trop vite entre les mains. Non, les Péruviens ne sont pas tous des voleurs,
gangsters et ruffians, loin de là.
COLOMBIE
Mais
quelle chaleur ! Là-haut, autour de Medellin, à 2500 m, il faisait bon. Surtout
que quelques orages bien ajustés venaient chaque après-midi tempérer l'ardeur
du thermomètre. Mais en approchant du Rio Magdalena, sur la route de Bogota, on
se rapproche aussi du niveau 0, et du degré 35. A l'ombre bien entendu, et
quand il y en a. Bizarre, ça, le corps fonctionne à 37°, et ne supporte pas
l'équivalent dehors. La femme non plus du reste, même si certains l'aiment
chaude (mot d'esprit qui me laisse froid).
Je
repensais fortuitement à ce pauvre Gil : un cyclo US qui, après deux ans de
voyage, se fit piquer son vélo, ses papiers, ses dollars, son manuscrit de
thèse économique, en plein vélodrôme de Medellin, où nous avions pu nous faire
héberger. Et bien qu'il s'agisse d'une belle ville, entourée de montagnes, je
n'étais pas mécontent d'avoir mis 160 km entre cette ville et moi. J'avais déjà
eu mon compte à la sortie de la ville, passant par l'ancienne route traversant
les plus hauts quartiers, par conséquent les plus bas dans l'échelle sociale,
là où les coups de feu ne sont pas nécessairement tirés en l'air...Un jour, un
habitué du vélodrôme me dit : "évite tel quartier, hier soir il y a eu un
peu de bagarre...". Ecoutant RFI (Radio France International) le soir
même, le sujet faisait la une : "sept morts à Medellin, encore un
rêglement de compte entre factions rivales...". Mais ici, ça ne fait pas
la une, c'est le train-train.
L'avenue
de Medellin débouchait brusquement, les derniers taudis dépassés, sur une piste
déserte, lieu idéal pour une attaque de la diligence. Pour me retrouver coincé
dans une taverne durant deux heures, inviter à écluser bière sur bière par des
Colombiens, mais l'oeil prudemment rivé sur le vélo dehors, malgré l'accueil
sympathique et chaleureux. Amis cyclos, ne quittez jamais Medellin par la
Carrera 39, en fin d'après-midi !
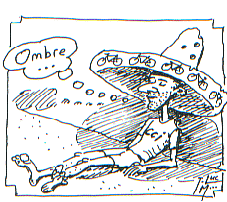 Dessin de Jean-Luc Maréchal, paru avec l'article dans le
n° 50 de la revue CCI (automne 93)
Dessin de Jean-Luc Maréchal, paru avec l'article dans le
n° 50 de la revue CCI (automne 93)
Tandis
que là, si loin de tout...Route désertique, tout autant propice à une attaque,
mais d'où pourraient venir les assaillants ? Ça faisait tout au plus cinq
kilomètres que j'avais eu cette pensée, lorsque survint un type à moto, qui me
tend un revolver sous le nez, me faisant signe de m'arrêter. Allons donc,
encore un admirateur qui veut une photo souvenir de moi - dans - le - parc - de
- Vincennes. C'est que j'en ai presque plus, bonhomme ! Non, ça semble être
autre chose. Le gars me hurle des trucs donc je crois extraire le mot
"réquisition", et visiblement la volonté de voir ce qu'il y a dans
mes sacoches joufflues. Tiens donc : des fois qu'il y traînerait des dollars,
comme ça ? J'essaie de gagner du temps en parlant, et jauge la situation : je
songe même à user de ma ridicule bombinette de gaz, qui m'a jusqu'ici servi à
éloigner quelques chiens admirateurs de mes mollets.
Mais
voilà qu'apparaît un comparse, extirpant lui-aussi un colt de sa chemise. Là où
je commence à m'inquiéter plus sérieusement (jusque là, somme toute, ça n'avait
l'air que d'un sympathique braquage), c'est que le nouvel arrivant est muni
d'un talkie-walkie. Et qu'il sait s'en servir. Ça y est, ils appellent à
coup sûr un troisième larron, conduisant un véhicule, et vont gentiment
s'embarquer mon vélo, la pompe y compris. Fichu ton voyage, mon vieux Frédo,
t'as plus qu'à continuer en stop jusqu'à Bogota, comme Gil...
Par
chance, à ce moment précis passent un bus, puis une voiture : je me mets en
travers de la route, pour les faire stopper. Eux aussi ont bien compris de quoi
il retourne, et ne tiennent pas à voir leur radiateur troué. Ils m'évitent donc
de justesse, dans un slalom à la Picard, et filent sans demander l'heure qu'il
est. Bravo ! Je fais mine de partir : "toi, reste là, ou je t'en plante
une dans la tête !". Et le gars de se préparer à tirer. Bon, bon, si l'on
ne peut plus plaisanter, maintenant ! Mieux vaut pour moi retourner à la case
départ sans vélo, que d'aller directement dans une case de morgue, au moins
pour trois tours (double six exigé pour en sortir).
Arrive
soudain une voiture de police, si vite que je n'ai pas eu le temps d'agir. Mais
ce sont mes malfrats, au visage hideux (ils auraient pu mettre quand même une
cagoule !) qui les arrêtent. Un petit cyclo ne leur suffit pas, il faut qu'ils
s'en prennent aux forces de l'ordre qui ne leur ont rien fait ? Et voilà
comment j'apprends que j'avais affaire à une milice locale (ou des agents en
civil de la DAS ?), luttant parallèlement à la police pour traquer les minables
de mon espèce ! La prochaine fois, ils leur mettront une étoile de shérif, afin
qu'on les distingue : j'ai été au bord de prendre des pruneaux pour des prunes,
oui...
Euh,
les gars, quand vous vous barrez après le contrôle, vous pouvez au moins dire :
"enchantés d'avoir fait ta connaissance", ça vous écorcherait la
langue ?
CICLO-VIA: LE CONTRETEMPS DU MOTEUR QUATRE-TEMPS
Ah, ces pays sous-développés, tout à leur apprendre ! Tenez, figurez-vous
qu’à Bogota (Colombie), le dimanche matin, on réserve certaines avenues à la
circulation sans moteur. On ne leur a pas dit que la voiture était reine ? Si,
pourtant, les autres jours. Au point que certaines avenues sont interdites aux
vélos, et que vient d’être décrété un plan de jours de circulation, selon la
terminaison des plaques d’immatriculation paires et impaires (et tous les jours
pour la famille et les copains du maire, mais ceci est une autre histoire). En
semaine, les yeux piquent, tellement ça carbure à 2 600 m, où l’air se fait
rare.
Mais le dimanche, ils se croient encore à l’époque des conquistadores
: l’oeuvre civilisatrice de l’Occident n’a pas été achevée, hélas. La faute ?
Un certain Padre Rozo, un marteau du vélo. Il s’est dit, cet allumé, qu’il
fallait réserver des oasis de tranquillité pour le cyclo, habituellement
bousculé par une circulation agressive. Quelle idée! Et la liberté du
chauffeur-pollueur-écraseur à toute heure, qu’en fait-on ? bref, à force de
cogner son bâton de pélerin à toutes les portes, il obtint de la mairie
l’inconcevable : la Carrera 7, l’une des grandes avenues centrales de cette
métropole de six millions d’habitants, serait désormais réservée, tous les dimanches
de 7 h à 13 h, aux cyclos, trottineurs, marcheurs,...tous ces inutiles qui
passent leur temps à flâner, à soit-disant profiter un peu de la vie. Pas bien
rentable, tout cela.
Et cette pieuvre ciclo-viesque enserre peu à peu la pauvre Bogota
dans un circuit qu’il sera bientôt possible de parcourir sans croiser un seul
véhicule de l’ère moderne. Au secours, Bogota est en danger! Déjà, La Paz
(Bolivie) est touchée : “la” grande avenue (le Prado) est réservée le dimanche
matin pour une destination anachronique, à l’aube du troisième millénaire : les
piétons.
Le XXI ème siècle sera silencieux ou ne sera pas ? Heureusement, Paris
semble à l’abri de ces égarements de municipalités cédant démagogiquement aux
lubies d’une populace inconsciente : le jour où vous verrez les Champs Elysées
envahis (hors Tour de France) de hordes barbares cyclistes n’est pas venu. On y
veille !
VOUS ETES DANS MON ASSIETTE
Et la boustifaille, dans tout cela ?
En Argentine, ce n’est pas vraiment un scoop, on mange
énormément de viande : notamment sous forme d’asado, version australe du barcecue, et prétexte à réunion
dominicale ente amis. Dans un pays où le kilo de viande tourne autour de 10-15
FF, rien de plus normal. Par contre, grosse déception : pas
de fromage après ces agapes. J’ai bien mis plusieurs mois à m’y faire.
Dès l’altiplano argentin, un autre ton était donné, qui me suivrait
jusqu’en Amérique Centrale : la soupe et le riz. Une soupe plus ou moins
épaisse, avec parfois une seule patate surnageant, et un plat de riz blanc,
parfois agrémenté d’un (bas) morceau de viande de mouton ou de lama. Style
vieille carne ayant roulé sa bosse à 4 000 m.
Le riz : à un poste de contrôle, un militaire, à l’insu de ses compères,
m’en filera un gros sac plastique, qui me fera trois repas par jour, durant
près d’une semaine ! Car ici, foin des sophistications de nos riches pays, on
mange la même chose matin midi et soir. Le Français n’a pas encore réussi à
instituer le croissant matinal à ces sauvages. L’humanisme éclairé de notre
incomparable patrie a encore du chemin à faire.
Si les restaurants étaient assez chers au Chili et surtout en Argentine
(30 francs, des matraqueurs), par
contre, plus au nord, les prix devenaient plus attractifs : 5 à 10 francs,
voire 2,50 dans certains coins du Pérou ! Evidemment, à ce tarif, ne cherchez
pas la carte : vous ne la trouverez même pas derrière la frite. Dans les
grandes villes, on mange tout de même un peu mieux. En Bolivie, on trouve
d’excellents...poulets-frites, et au Pérou, des chifas, des restaurants chinois où l’on mange abondamment.
Car le cyclo-voyageur est obsédé par l’abondant-et-pas-cher. Il se pâme
devant une gamelle de nouille (à la sauce bolognaise pour les fins gourmets),
laisse son lyrisme s’exprimer face à un pot de confiture accompagné d’un pain
(entier, le pain. La tranche, c’est pour le commun des mortels).
Mais le pays au meilleur rapport qualité-prix, c’est la Colombie,
singulièrement Bogota sa capitale : pour 4 ou 5 francs, on vous sert une bonne
soupe, puis la bandeja : une vaste
assiette en forme de saucière, avec un mélange (que vous pouvez absorber
séparément) de riz bien sûr, de purée de frijoles
(haricots rouges), de viande, de salade, et une banane en guise de dessert...ou
d’orange du canard, selon votre goût. Les haricots rouges vous poursuivront
toute l’Amérique Centrale, du Panama des selfs services au Guatemala des
gargottes.
La grande surprise, c’est que, contrairement à une légende tenace, dans pas
un seul de ces pays vous n’aurez été tenu de manger piquante : les sauces sont servies à part sur la table. Mais si
vous voulez faire couleur locale, rien ne vous empêche de manger les piments
tels quels, comme les gens du coin...Il faut attendre le Mexique pour vous
faire emporter la gueule par l’assaisonnement des tortillas, ces petites galettes de maïs qui sont l’essentiel de
l’offre des restautants à faible prix. Dans ce pays, sauf à taper dans une
gamme de prix dépassant l’imaginaire du cyclo-voyageur (limité forfaitairement
à 20 francs), pas question de sortir de ces
tortillas épicées (qu’on vous affirmera du reste ne pas être piquantes -
ou si peu : c’est juste un assaisonnement normal !). Ouf, il y a le riz pour
éteindre un peu le début d’incendie de votre oesophage.
Ces repas de l’homme ordinaire ne sauraient toutefois suffire au cyclo affamé, en perpétuelle quête de reconstitution de sa
force musculaire. En Argentine, il y a le manteca
de mani, qu’on retrouve ensuite de l’Equateur aux USA et en...Australie. C’est le beurre de
cacahuètes, pas encore “no cholesterol added” ici, le sujet n’est
pas à la mode - quoique l’embompoint de
certains Argentins...
Dans le même pays, c’est le dulce de
leche, qui s’appelle manjar au
Chili, cajeta de leche en Colombie,
et encore autrement au Mexique ; mais c’est la même succulente “confiture de
lait”, c’est-à-dire du lait concentré sucré caramélisé. Energétique au
possible, je ne vous dis pas le nombre de tonnelets que j’ai du en ingurgiter !
Sur les hauts plateaux argentin et bolivien, c’est aussi à l’anchi que je me rassasie : vous prenez une
bonne quantité de polenta (semoule de
maïs), vous y ajoutez forces morceaux de sucre, et pilez deux oranges.
Consistante friandise.
Enfin, les fruits. En Argentine et au Chili, pas de problème : toute la
région au pied des Andes est un véritable panier à fruits, débordant de
raisins, d’abricots, de grenades, de coings, de figues...En Bolivie, rien ne
pousse à 3 000 - 4 000 m, sorti de quelques céréales et de la patate noire. Au
Pérou, dans les basses vallées andines, j’imiterai les gens du crû à mâcher la
canne à sucre : excellent pour la mâchoire et les gencives.
C’est encore en Colombie, décidément au hit-parade, que les fruits sont les
plus variés, les plus exotiques et les meilleurs. Tellement il y en a que je
n’ai même pas pu retenir tous les noms ! C’est une cure de produits naturels
qu’on y fait. Bien sûr enfin, la banane, de l’Equateur au Guatemala, avec
toutes ces variétés dont on n’a même pas idée en France. On les mange même
comme des frites, et c’est vraiment bon.
Pour le petit-déjeûner ? “El Quaker”: ces flocons d’avoine
bourratifs m’on ouvert la journée et lesté l’estomac durant des mois, de la
Bolivie à l’Amérique Centrale. Avec Coca Cola, un des rares produits qui ait
réussi à s’imposer en Amérique du Sud. Ma surprise a été de constater qu’on
trouve bien moins (voire pas du tout) de McDo et de Pizza Hut que par chez
nous. La culture latino-américaine serait-elle plus forte que la culture
européenne face à l’impérialisme culturel des gringos ?
vers les anecdotes Amérique
Centrale / Mexique