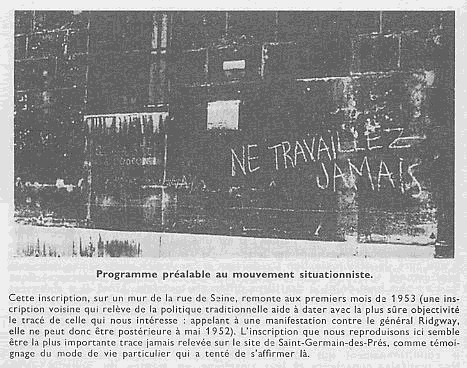
Internationale situationniste
Bulletin central édité par les sections de l’Internationale situationniste
Numéro 8
Janvier 1963 — Directeur : G.-E. Debord
Rédaction : B.P. 75-06 Paris
La rédaction de ce bulletin appartient au Conseil Central de l’I.S. :
BERNSTEIN, DEBORD, KOTÁNYI, LAUSEN, MARTIN, STRIJBOSCH, TROCCHI, VANEIGEM.Tous les textes publiés dans Internationale Situationniste
peuvent être librement reproduits, traduits ou adaptés même sans indication d’origine.ù Table
¶ Domination de la nature, idéologies et classes
¶ L’avant-garde de la présence
¶ L’I.S. vous l’avait bien dit
¶ RAOUL VANEIGEM, Banalités de base (seconde partie)
ALEXANDER TROCCHI, Technique du coup du monde
UWE LAUSEN, Répétition et nouveauté dans la situation construite
ù
Notes éditoriales
Domination de la nature, idéologies et classes L’APPROPRIATION de la nature par les hommes est précisément l’aventure dans laquelle nous sommes embarqués. On ne peut la discuter ; mais on ne peut discuter que sur elle, à partir d’elle. Ce qui est en question toujours, au centre de la pensée et de l’action modernes, c’est l’emploi possible du secteur dominé de la nature. L’hypothèse d’ensemble sur cet emploi commande les choix aux embranchements que présente tout moment du processus ; commande aussi le rythme et la durée d’une expansion productive dans chaque secteur. L’absence d’hypothèse d’ensemble, c’est-à-dire en fait le monopole d’une seule hypothèse non théorisée, qui est comme le produit automatique de la croissance aveugle du pouvoir actuel, fait le vide qui est le lot de la pensée contemporaine depuis quarante ans.
L’accumulation de la production et de capacités techniques toujours supérieures va encore plus vite que dans la prévision du communisme du XIXe siècle. Mais nous sommes restés au stade de la préhistoire avec sur-équipement. Un siècle de tentatives révolutionnaires a échoué en ceci que la vie humaine n’a pas été rationalisée et passionnée (le projet d’une société sans classes n’a pas encore été réalisé). Nous sommes entrés dans un accroissement de moyens matériels qui n’aura pas de fin, mais qui reste placé au service d’intérêts fondamentalement statiques, et par là même des valeurs dont la mort ancienne est de notoriété publique. L’esprit des morts pèse très lourd sur la technologie des vivants. La planification économique qui règne partout est folle, non tant par son obsession scolaire de l’enrichissement organisé des années qui suivent, mais bien par le sang pourri du passé qui circule tout seul en elle ; et qui est relancé sans arrêt en avant, à chaque pulsation artificielle de ce « cœur d’un monde sans cœur ».
La libération matérielle est un préalable à la libération de l’histoire humaine, et ne peut être jugée qu’en cela. La notion de niveau de développement minimum à atteindre d’abord, ici ou là, dépend justement du projet de libération choisi, donc de qui a fait ce choix : les masses autonomes ou les spécialistes au pouvoir. Ceux qui épousent les idées de telle catégorie d’organisateurs sur l’indispensable, pourront être libérés de toute privation concernant les objets que les organisateurs en question choisiront de produire, mais à coup sûr ne seront jamais libérés des organisateurs eux-mêmes. Les formes les plus modernes et les plus inattendues de la hiérarchie seront toujours le remake coûteux du vieux monde de la passivité, de l’impuissance, de l’esclavage, quelle que soit la force matérielle abstraitement possédée par la société : le contraire de la souveraineté des hommes sur leur entourage et leur histoire.
Du fait que la domination de la nature dans la société actuelle se présente comme une aliénation sans cesse aggravée et la seule grande caution idéologique justifiant cette aliénation sociale, elle est critiquée d’une manière unilatérale, sans dialectique ni compréhension historique suffisante, par certains des groupes d’avant-garde qui sont en ce moment à mi-chemin entre l’ancienne conception dégradée et mystifiée du mouvement ouvrier, qu’ils ont dépassée, et la prochaine forme de contestation globale, qui est encore en avant de nous (voir par exemple dans la revue Socialisme ou Barbarie les théories très significatives de Cardan et autres). Ces groupes s’opposant à juste titre à la réification toujours plus parfaite du travail humain et à son corollaire moderne, la consommation passive de loisirs manipulés par la classe dominante, en viennent à entretenir plus ou moins inconsciemment une sorte de nostalgie du travail sous ses formes anciennes, des relations réellement « humaines » qui ont pu s’épanouir dans des sociétés d’autrefois ou même en des phases moins développées de la société industrielle. Ceci va bien, du reste, avec l’intention d’obtenir un meilleur rendement de la production existante, en y abolissant à la fois le gaspillage et l’inhumanité qui caractérisent l’industrie moderne (cf. à ce propos Internationale Situationniste 6, page 4). Mais ces conceptions abandonnent le centre du projet révolutionnaire qui n’est rien de moins que la suppression du travail au sens courant (de même que la suppression du prolétariat) et de toutes les justifications du travail ancien. On ne peut comprendre la phrase du Manifeste communiste qui dit que « la bourgeoisie a joué dans l’histoire un rôle éminemment révolutionnaire », si l’on néglige la possibilité, ouverte par la domination de la nature, de l’effacement du travail au profit d’un nouveau type d’activité libre ; et si l’on néglige en même temps le rôle de la bourgeoisie dans la « dissolution des idées anciennes », c’est-à-dire si l’on suit la malheureuse pente du mouvement ouvrier classique à se définir positivement en termes d’« idéologie révolutionnaire ».
Vaneigem expose dans Banalités de Base le mouvement de dissolution de la pensée sacrée, son remplacement inférieur dans la fonction d’analgésique, d’hypnotique et de calmant, par l’idéologie. L’idéologie, comme il est arrivé à la pénicilline, en même temps qu’elle a été répandue de plus en plus massivement est devenue de moins en moins opérante. Il faut forcer sans cesse sur la dose et sur la présentation, il suffit de penser aux excès divers du nazisme et de la propagande de consommation aujourd’hui. On peut considérer que, depuis la disparition de la société féodale, les classes dominantes sont de plus en plus mal servies par leurs propres idéologies, en ce sens que ces idéologies — en tant que pensées critiques pétrifiées — leur ont servi d’armes universelles pour la prise du pouvoir, et à ce moment présentent des contradictions à leur règne particulier. Ce qui était dans l’idéologie mensonge inconscient (arrêt sur des conclusions partielles) devient mensonge systématique quand certains des intérêts qu’elle a recouverts sont au pouvoir et qu’une police les protège. L’exemple le plus moderne est aussi le plus frappant : c’est par le détour de l’idéologie dans le mouvement ouvrier que la bureaucratie a constitué son pouvoir en Russie. Toutes les tentatives de modernisation d’une idéologie — aberrantes comme le fascisme ou conséquentes comme l’idéologie de la consommation spectaculaire dans le capitalisme développé — vont dans le sens de la conservation du présent, lui-même dominé par le passé. Un réformisme de l’idéologie, dans un sens hostile à la société établie, n’aura jamais d’efficacité, parce qu’il n’aura jamais les moyens d’absorption forcée grâce auxquels cette société dispose encore d’un usage efficace de l’idéologie. La pensée révolutionnaire est forcément du côté de la critique impitoyable des idéologies ; en y comprenant, bien entendu, l’idéologisme spécial de « la mort des idéologies », dont le titre est déjà un aveu, les idéologies ayant toujours été de la pensée morte, et l’idéologie empirique en question se réjouissant seulement de la déconfiture d’un rival envié.
La domination de la nature contient la question « pour quoi faire ? » mais cette interrogation sur la praxis surmonte forcément cette domination, ne peut se passer d’elle. Elle rejette seulement la réponse la plus grossière « faire comme avant en plus encombré de produits », la domination réifiante qui est contenue dès l’origine de l’économie capitaliste, mais qui peut « produire elle-même ses fossoyeurs ». Il faut mettre au jour la contradiction entre la positivité de la transformation de la nature, le grand projet de la bourgeoisie, et sa récupération mesquine par le pouvoir hiérarchisé qui, dans toutes ses variantes actuelles, suit le modèle unique de la « civilisation » bourgeoise. Dans sa forme massifiée, le modèle bourgeois s’est « socialisé » à l’usage d’un petit-bourgeois composite qui accumulerait toutes les capacités d’abrutissement des vieilles classes pauvres et tous les signes de richesses (eux-mêmes massifiés), qui marquent, l’appartenance à la classe dominante. Les bureaucrates de l’Est rallient forcément ce modèle, et il leur suffit de produire plus pour que la police serve moins à maintenir leur propre schéma de la disparition de la lutte de classes. Le capitalisme moderne proclame hautement un but similaire. Mais tous chevauchent le même tigre : un monde en transformation rapide où ils souhaitent la dose d’immobilité utile à la perpétuation de telle nuance du pouvoir hiérarchique.
Le réseau de la critique du présent est cohérent, exactement comme l’est le réseau de l’apologie. La cohérence de l’apologie est seulement moins apparente, en ce qu’elle doit mentir ou valoriser arbitrairement à propos de beaucoup des détails et des nuances du modèle régnant, contre d’autres. Mais si l’on renonce vraiment à toutes les variantes de l’apologie, on est de plain-pied dans la critique, qui ne connaît pas cette mauvaise conscience subjective, parce qu’elle n’a partie liée avec aucune force dominante du présent. Celui qui admet qu’une bureaucratie hiérarchisée peut être un pouvoir révolutionnaire, et qui admet en plus comme un bien et comme un plaisir, le tourisme de masse tel qu’il est universellement organisé par la société du spectacle, celui-là pourra faire les voyages de Sartre en Chine ou ailleurs. Ses erreurs, ses bêtises, ses mensonges ne devront étonner personne. Il faut bien suivre la pente de ce que l’on aime ; et d’autres voyageurs sont encore plus détestables, et payés en monnaies plus réelles, qui vont servir Tschombé au Katanga. Les témoins intellectuels de la gauche, qui passent si promptement là où on les invite, témoignent principalement sur l’abandon d’une pensée qui, depuis des décennies, a renoncé à sa propre liberté pour osciller entre des patrons qui sont en conflit. Les penseurs qui admirent les réalisations actuelles de l’Ouest ou de l’Est, en tombant dans tous les panneaux du spectacle, n’avaient donc jamais pensé à rien, constatation qui ne peut surprendre ceux qui les ont lus. Évidemment la société dont ils sont le miroir nous demande d’admirer ses admirateurs. Et même, en beaucoup d’endroits, il leur est loisible de choisir leur jeu de glaces (ce qu’ils ont appelé « s’engager »), choisir avec ou sans repentirs l’emballage et l’étiquette de la société établie qui les inspirent.
Les hommes aliénés obtiennent chaque jour — on le leur apprend, on le leur montre — de nouveaux succès dont ils n’ont que faire. Ce qui ne signifie pas que ces étapes du développement matériel sont inintéressantes ou mauvaises. Elles peuvent être réinvesties dans la vie réelle, mais seulement avec tout le reste. Les victoires actuelles sont le fait de vedettes-spécialistes. Gagarine montre que l’on peut survivre plus loin dans l’espace, dans des conditions toujours plus défavorables. Mais aussi bien quand l’ensemble de l’effort médical et biochimique permet de survivre plus loin dans le temps, cette extension statistique de la survie n’est nullement liée à une amélioration qualitative de la vie. On peut survivre plus loin et plus longtemps, jamais vivre plus. Nous n’avons pas à fêter ces victoires, mais à faire vaincre la fête, dont ces avances mêmes des hommes déchaînent la possibilité infinie dans le quotidien.
Il s’agit de retrouver la nature comme « adversaire valable ». Il faut que le jeu mené contre elle soit passionnant, que les points marqués dans un tel jeu nous concernent directement. La domination (passagère, mouvante) de notre milieu et du temps, c’est par exemple la construction d’un moment de la vie. L’expansion de l’humanité dans le cosmos est, sur une polarisation inverse de la construction (post-artistique) de la vie individuelle — mais qui demeure étroitement liée à cet autre pôle du possible — un exemple d’entreprise où viennent en conflit l’actuelle petitesse des compétitions militaires de spécialistes et la grandeur objective du projet. L’aventure cosmique sera étendue, donc ouverte à une tout autre participation que celle des cobayes-spécialistes, d’autant plus vite et loin que sur cette planète l’effondrement du règne avare des spécialistes aura ouvert les vannes d’une immense créativité concernant tout ; créativité en ce moment figée et inconnue, capable cependant d’entraîner une progression géométrique sur tous les problèmes humains, à la place de l’actuelle croissance cumulative réservée à un secteur arbitraire de la production industrielle. Le vieux schéma de la contradiction entre forces productives et rapports de production ne doit certes plus se comprendre comme une condamnation automatique à court terme de la production capitaliste qui stagnerait et deviendrait incapable de continuer son développement. Mais cette contradiction doit se lire comme la condamnation (dont il reste à tenter l’exécution avec les armes qu’il faudra) du développement à la fois mesquin et dangereux que se ménage l’auto-régulation de cette production, en regard du grandiose développement possible qui s’appuierait sur la présente infrastructure économique.
Toutes les questions ouvertement posées dans la société actuelle impliquent déjà certaines réponses. On n’en pose jamais qui entraîneraient ailleurs qu’à ce type obligatoire de réponse. Quand on remarque cette évidence que la tradition moderne est justement d’innover, on se bouche les yeux sur cette autre évidence qu’il n’est pas question d’innover partout. Dans une époque où l’idéologie pouvait encore croire en son rôle, Saint-Just disait que « tout ce qui n’est pas nouveau dans un temps d’innovations est pernicieux ». Les nombreux successeurs de Dieu qui organisent l’actuelle société du spectacle savent très bien maintenant jusqu’où on peut questionner trop loin. Le dépérissement de la philosophie et des arts tient aussi à cet interdit. Dans leur part révolutionnaire, la pensée et l’art modernes ont revendiqué, plus ou moins précisément, une praxis encore absente qui serait le champ minimum de leur déploiement. Le reste tisse les dentelles sur les questions officielles, ou la vaine question du questionnement pur (la spécialité d’Arguments).
Il y a beaucoup de chambres idéologiques dans la Maison du Père, c’est-à-dire la vieille société, dont les références fixes ont été perdues mais dont la loi est intacte (malgré l’inexistence de Dieu, rien n’est permis). Y ont droit de cité tous les modernismes qui peuvent servir à combattre le moderne. La bande de bonimenteurs de l’incroyable revue Planète, qui impressionne tant les maîtres d’école, incarne une démagogie insolite, qui profite de l’absence géante de la contestation et de l’imagination révolutionnaire, au moins dans leurs manifestations intellectuelles, depuis bientôt un demi-siècle (et des obstacles multiples qui sont opposés partout à leur resurgissement aujourd’hui). Jouant en même temps sur cette évidence que la science et la technologie avancent de plus en plus vite, sans que l’on sache vers où. Planète harangue les braves gens pour leur faire savoir qu’il faut désormais tout changer ; et en même temps admet comme donnée immuable les 99/100 de la vie réellement vécue par notre époque. On peut ainsi profiter du vertige de la nouveauté de foire pour réintroduire imperturbablement les inepties rétrogrades qui n’étaient que fort mal conservées dans les campagnes les plus reculées. Les drogues de l’idéologie finiront leur histoire dans une apothéose de grossièreté dont même Pauwels n’a pas encore idée, malgré ses efforts.
Les variétés actuelles d’idéologie fluide — par rapport au système mythique solide du passé — ont un rôle accru à mesure que des dirigeants spécialisés doivent planifier davantage tous les aspects d’une production et d’une consommation croissantes. La valeur d’usage, tout de même indispensable, mais qui déjà tendait à devenir seulement implicite dès la prédominance d’une économie produisant pour le marché, est désormais explicitement manipulée (créée artificiellement) par les planificateurs du marché moderne. C’est le mérite de Jacques Ellul dans son livre Propagandes (A. Colin, 1962), qui décrit l’unité des diverses formes de conditionnement, de montrer que cette publicité-propagande n’est pas une simple excroissance maladive que l’on pourrait prohiber, mais en même temps un remède dans une société globalement malade, remède qui permet de supporter le mal en l’aggravant. Les gens sont dans une large mesure complices de la propagande, du spectacle régnant, parce qu’ils ne pourraient le rejeter qu’en contestant la société entièrement. Et le seul travail important de la pensée aujourd’hui doit tourner autour de cette question de la réorganisation de la force théorique et de la force matérielle du mouvement de la contestation.
L’alternative n’est pas seulement dans un choix entre la vraie vie et la survie qui n’a à perdre que ses chaînes modernisées. Elle est aussi posée du côté de la survie même, avec les problèmes sans cesse aggravés que les maîtres de la seule survie n’arrivent pas à résoudre. Les risques des armements atomiques, de la sur-population planétaire et du retard accru dans la misère matérielle pour la grande majorité de l’humanité sont des sujets d’angoisse officiels jusque dans la grande presse. Exemple banal entre tous, dans un reportage sur la Chine (Le Monde, septembre 1962), Robert Guillain écrit sans ironie, du problème du surpeuplement : « Les dirigeants chinois semblent le reconnaître de nouveau et vouloir s’y attaquer. On les voit revenir à l’idée d’un contrôle des naissances, essayé en 1956 et abandonné en 1958. Une campagne nationale s’est ouverte contre les mariages précoces et pour l’espacement des naissances dans les nouveaux foyers ». Ces oscillations des spécialistes, aussitôt suivies d’instructions impératives, démasquent aussi complètement la réalité de l’intérêt qu’ils prennent à la libération du peuple que les troubles de conscience et les conversions des princes du XVIe siècle (cujus regio, ejus religio), ont pu démasquer la nature de leur intérêt pour l’arsenal mythique du christianisme. Et quelques lignes plus loin, le même journaliste avance que « l’U.R.S.S. n’aide pas la Chine parce que ses disponibilités sont maintenant consacrées à la conquête de l’espace, fantastiquement coûteuse ». Les ouvriers russes, pour fixer la mesure de ces « disponibilités » excédentaires de leur travail, ou son affectation sur la Lune plutôt qu’en Chine, n’ont pas plus eu la parole que les paysans chinois pour choisir d’avoir ou non des enfants. L’épopée des dirigeants modernes aux prises avec la vie réelle, qu’ils sont amenés à prendre complètement en charge, a eu sa meilleure traduction écrite dans le cycle d’Ubu. La seule matière première que n’a pas encore expérimenté notre époque expérimentale, c’est la liberté de l’esprit et des conduites.
Dans les vastes drugstores de l’idéologie, du spectacle, de la planification et de la justification de la planification, les intellectuels spécialisés ont leur job, et leur rayon à tenir (ceux qui ont une part dans la production même de la culture, couche que l’on ne doit pas confondre avec la masse accrue des « travailleurs intellectuels », laquelle voit ses conditions de travail et de vie se rapprocher toujours plus nettement du travail des ouvriers et des employés tel qu’il évolue lui-même selon les principes de l’industrie moderne). Il y en a pour tous les goûts, tel ce Roberto Guiducci qui montre d’abord qu’il est compréhensif en écrivant (sur La difficile recherche d’une nouvelle politique, dans Arguments n° 25-26), que le retard existant « nous laisse encore aujourd’hui entre la stupidité de vivre parmi les ruines d’institutions mortes et la faculté d’exprimer seulement des propositions encore très difficilement réalisables ». Que va-t-il donc proposer ? On découvre que c’est bien facilement réalisable. Après avoir réussi à assimiler dans une même phrase Hegel et Engels à Jdanov et Staline, il nous propose de convenir que « sont également rongées par le temps, les tendances à reconsidérer l’impatience romantique du jeune Marx, les exégèses tourmentées de Gramsci… ». Voilà donc un homme qui a l’air d’en être bien revenu, et qui ne s’avise pas un instant que s’il avait réellement su lire Hegel et Gramsci, cela se verrait ! Nous pourrions, nous, le lire à livre ouvert, dans son passé et dans son article. Mais il a plus probablement coulé de belles années dans le respect de Jdanov et Togliatti. Un jour, comme les autres pantins d’Arguments quel que soit leur parti communiste d’origine, il a tout remis en question. Mais si tous n’avaient pas les mains sales, tous avaient l’esprit encrassé. Il a dû consacrer lui aussi, quelques semaines à « reconsidérer » le jeune Marx. Mais, après tout, s’il avait été capable de comprendre Marx, comme de comprendre le temps que nous vivons, comment voudrait-on qu’il n’ait pas compris tout de suite Jdanov ? Enfin, depuis belle lurette que lui et d’autres ont reconsidéré la pensée révolutionnaire, ce moment lui apparaît déjà comme « rongé par le temps ». Pourtant, reconsidérait-il quoi que ce soit il y a dix ans ? C’est très improbable. On peut donc dire que c’est un homme qui reconsidère plus vite que l’histoire, parce qu’il n’est jamais avec l’histoire. Sa nullité exemplaire n’aura nul besoin d’être reconsidérée par personne.
En même temps, une partie de l’intelligentsia élabore la nouvelle contestation, commence à penser la critique réelle de notre époque, ébauche des actes en conséquence. Dans le spectacle, qui est son usine, elle lutte contre les cadences et la finalité même de la production. Elle a forgé ses propres critiques et saboteurs. Elle rejoint le nouveau lumpen (du capitalisme de la consommation) qui exprime avant tout le refus des biens que le travail présent peut acquérir. Elle commence ainsi à refuser les conditions de concurrence individuelles, et donc de servilité, où est tenue l’intelligentsia créatrice : le mouvement de l’art moderne peut être considéré comme une déqualification permanente de la force de travail intellectuel par les créateurs (ceci alors que l’ensemble des travailleurs, dans la mesure où ils acceptent la stratégie hiérarchique de la classe dirigeante, peuvent entrer en concurrence par catégories).
La tâche que va accomplir maintenant l’intelligentsia révolutionnaire est immense du moment qu’elle s’écarte, sans aucun compromis, de la longue période finissante où « le sommeil de la raison dialectique engendrait les monstres ». Le.nouveau monde qu’il faut comprendre est à la fois celui des pouvoirs matériels qui se multiplient sans emploi, et celui des actes spontanés de la contestation vécue par les gens sans perspective. Au contraire, de l’ancien utopisme, où des théories entachées d’arbitraire avançaient au-delà de toute pratique possible (non sans fruit cependant), il y a maintenant, dans l’ensemble de la problématique de la modernité, une foule de pratiques nouvelles qui cherchent leur théorie.
Il ne saurait y avoir un « parti intellectuel » comme le rêvent quelques-uns, car l’intellectualité qui pourrait être reconnue dans ce corporatisme serait justement la réflexion licite de MM. Guiducci, Morin, Nadeau. Merci bien. L’intelligentsia patentée en tant que corps séparé et spécialisé — même s’il vote à gauche, qu’importe ? — en dernière analyse satisfait, ou même satisfait de sa médiocre insatisfaction littéraire, est au contraire le secteur social le plus spontanément contre-situationniste. Cette couche intellectuelle qui est comme un public d’avant-prermère, qui goûte représentativement la consommation qui sera offerte peu à peu à tous les travailleurs des pays développés, nous devons l’écœurer de ses valeurs et de ses goûts (le mobilier dit moderne ou les écrits de Queneau). Sa honte sera un sentiment révolutionnaire.
Il faut distinguer, dans l’intelligentsia, les tendances à la soumission et les tendances au refus de l’emploi offert. Et alors, par tous les moyens, jeter l’épée entre ces deux fractions pour que leur opposition totale éclaire les approches de la prochaine guerre sociale. La tendance carriériste, qui exprime fondamentalement la condition de tout service intellectuel dans une société de classe mène cette couche, comme le remarque Harold Rosenberg dans sa Tradition du Nouveau, à disserter de son aliénation sans acte d’opposition, parce qu’on lui a fait une aliénation confortable. Cependant, alors que toute la société moderne va vers ce passage au confort, et que d’un même mouvement, ce confort s’infecte davantage d’ennui et d’angoisse, la pratique du sabotage peut s’étendre dans l’intelligence. C’est ainsi qu’à partir de l’art moderne — de la poésie —, de son dépassement, de ce que l’art moderne a cherché et promis, à partir de la place nette, pour ainsi dire, qu’il a su faire dans les valeurs et les règles du comportement quotidien, on va voir maintenant reparaître la théorie révolutionnaire qui était venue dans la première moitié du XIXe siècle à partir de la philosophie (de la réflexion critique sur la philosophie, de la crise et de la mort de la philosophie).
Les valeurs vivantes de la création intellectuelle et artistique sont niées autant qu’il est possible de le faire par tout le mode d’existence de l’intelligentsia soumise, qui en même temps veut orner sa position sociale par sa parenté de la main gauche avec cette création de « valeurs ». L’intelligentsia employée, qui sent cette contradiction, essaie de se rattraper par l’exaltation ambiguë de ce que l’on a appelé la bohême artistique. La bohême est reconnue par les valets de la réification comme le moment de l’usage qualitatif de la vie quotidienne, exclu partout ailleurs ; comme le moment de la richesse dans la pauvreté extrême, etc. Mais le conte de fée doit avoir, dans sa version officielle, une fin moralisante : ce moment du qualitatif pur dans la pauvreté devra passer, aboutir à la « richesse » courante. Les artistes pauvres auront, pendant ce temps même, produit des chefs-d’œuvre non-valorisés par le marché. Mais ils sont sauvés (leur jeu avec le qualitatif est excusé, et devient même édifiant) parce que leur travail, qui n’était à ce moment qu’un sous-produit de leur activité réelle, va être hautement valorisé ensuite. Les hommes vivants de l’anti-réification ont tout de même produit leur dose de marchandise. Ainsi, sur la bohême, la bourgeoisie a fait son darwinisme, applaudissant les valeurs sélectionnées qui entrent dans son paradis quantitatif. On se fait un devoir de considérer que c’est purement accidentel si ce sont rarement les mêmes hommes qui ont eu en main les produits au stade de la création et au stade de la marchandise rentable.
La dégradation accélérée de l’idéologie culturelle a ouvert une crise permanente de cette valorisation intellectuelle et artistique, crise dont le dadaïsme a marqué l’éclatement au grand jour. Un double mouvement très apparent caractérise cette fin de culture : d’une part la diffusion de fausses nouveautés automatiquement ressorties sous nouvelle présentation par des mécanismes spectaculaires autonomes ; d’autre part le refus public et le sabotage portés par des individus qui étaient manifestement parmi les plus doués pour le renouvellement d’une production culturelle « de qualité » : Arthur Cravan est comme le prototype de ces hommes dont on a noté le passage dans la zone la plus radioactive du désastre culturel, et qui n’ont laissé aucune sorte de marchandises ou souvenirs. La conjonction de ces deux influences démoralisantes ne cesse d’épaissir le malaise dans l’intelligentsia.
Depuis le dadaïsme, et bien que la culture dominante ait pu récupérer une sorte d’art dadaïste, il n’est plus du tout évident que la rébellion artistique soit toujours récupérable en œuvres consommables par la prochaine génération. Et en même temps qu’une imitation de la manière post-dadaïste peut produire aujourd’hui n’importe quels objets culturels vendables, par l’arrivisme le plus facile dans le spectacle, il existe dans différents pays du capitalisme moderne, les foyers d’une bohême non artistique, réunie sur la notion de la fin ou de l’absence de l’art, et qui ne vise plus explicitement une production artistique quelconque. L’insatisfaction ne peut que s’y radicaliser avec le progrès de la thèse selon laquelle « l’art de l’avenir » (expression déjà impropre puisqu’elle paraît disposer de l’avenir dans les encadrements spécialisés du présent) ne pourra plus se valoriser comme marchandise, puisque nous le découvrons entièrement suspendu au changement global de notre emploi de l’espace, des sentiments et du temps. Toutes les expériences réelles de pensée et de comportement libres qui parviennent à s’ébaucher dans ces conditions vont certainement dans notre sens, vers l’organisation théorique de la contestation.
Nous estimons que le rôle des théoriciens, rôle indispensable mais non dominant, est d’apporter les éléments de connaissance et les instruments conceptuels qui traduisent en clair — ou en plus clair et cohérent — la crise, et les désirs latents, tels qu’ils sont vécus par les gens : disons le nouveau prolétariat de cette « nouvelle pauvreté » qu’il faut nommer et décrire.
On assiste dans notre époque à une redistribution des cartes de la lutte de classes : certainement pas à sa disparition, ni à sa continuation exacte dans le schéma ancien. De même que l’on n’assiste pas à un dépassement des nations mais à une new deal du nationalisme dans le dispositif de supra-nationalités : deux blocs mondiaux composés eux-mêmes de zones supra-nationales plus ou moins centrifuges, comme l’Europe ou la mouvance chinoise ; à l’intérieur des domaines nationaux ainsi encadrés il peut advenir des modifications et remembrements à différents niveaux, de la Corée à la Wallonie.
Suivant la réalité qui s’esquisse actuellement, on pourra considérer comme prolétaires les gens qui n’ont aucune possibilité de modifier l’espace-temps social que la société leur alloue à consommer (aux divers degrés de l’abondance et de la promotion permises). Les dirigeants sont ceux qui organisent cet espace-temps, ou ont une marge de choix personnel (même, par exemple, du fait de la survivance importante de formes anciennes de la propriété privée). Un mouvement révolutionnaire est celui qui change radicalement l’organisation de cet espace-temps et la manière même de décider désormais sa réorganisation permanente (et non un mouvement qui changerait seulement la forme juridique de la propriété ou l’origine sociale des dirigeants).
Aujourd’hui déjà, partout, l’immense majorité consomme l’espace-temps social odieux et désespérant qu’une infime minorité « produit » (il faut préciser que cette minorité ne produit littéralement rien d’autre que cette organisation, alors que la « consommation » de l’espace-temps, au sens où nous l’entendons ici, englobe toute la production courante, dans laquelle prend évidemment racine l’aliénation de la consommation, et de toute la vie). En regard de la dépense humaine que les classes dirigeantes du passé savaient faire de la mince part de plus-value arrachée à une production sociale statique, sur la base d’une pénurie générale, on peut dire que les individus de cette minorité dirigeante ont eux-mêmes aujourd’hui perdu leur « maîtrise ». Ils sont seulement consommateurs de pouvoir, mais du pouvoir même de l’organisation débile de la survie. Et c’est à seule fin de consommer ce pouvoir-là qu’ils organisent si misérablement cette survie. Le possesseur de la nature, le dirigeant, est dissous dans la mesquinerie de l’usage de son pouvoir (le scandale quantitatif). La maîtrise sans dissolution assurerait le plein-emploi : non de tous les travailleurs, mais de toutes les forces de la société, de toutes les possibilités créatrices de chacun pour lui-même et pour le dialogue. Où sont alors les maîtres ? À l’autre bout de ce système absurde. Au pôle du refus. Les maîtres viennent du négatif, ils sont porteurs du principe anti-hiérarchique.
La séparation tracée ici entre ceux qui organisent l’espace-temps (ainsi que les agents directement à leur service) et ceux qui subissent cette organisation, vise à polariser nettement la complexité savamment tissée des hiérarchies de fonctions et de salaires, qui donnent à penser que toutes les gradations sont insensibles et qu’il n’y a presque plus de vrais prolétaires ni de vrais propriétaires aux deux extrémités d’une courbe sociale devenue hautement plastique. Cette division étant posée, les autres différences de statut doivent être considérées d’emblée comme secondaires. En revanche, on n’ignore pas qu’un intellectuel, et aussi bien un ouvrier « révolutionnaire professionnel », à tout moment risquent de basculer sans retour dans l’intégration ; à une place ou à une autre d’une famille ou d’une autre dans le camp des zombies dirigeants (qui n’est aucunement harmonieux ou monolithique). Jusqu’à ce que la vraie vie soit présente pour tous, le « sel de la terre » peut toujours s’affadir. Les théoriciens de la nouvelle contestation ne sauraient pactiser avec le pouvoir ou se constituer eux-mêmes en pouvoir séparé sans cesser d’exister comme tels dans l’instant (d’autres représentant alors la théorie). Ceci revient à dire que l’intelligentsia révolutionnaire ne pourra réaliser son projet qu’en se supprimant ; que le « parti de l’intelligence » ne peut effectivement exister qu’en tant que parti qui se dépasse lui-même, dont la victoire est en même temps la perte.
* L’avant-garde de la présence DANS LE N° 4 de Médiations, Lucien Goldmann, devenu tout récemment critique spécialisé dans l’avant-garde culturelle, parle d’une « avant-garde de l’absence », celle qui exprime dans l’art et l’écriture un certain refus de la réification de la société moderne, mais qui d’après lui n’exprime que cela. Ce rôle négatif de la culture d’avant-garde dans notre siècle, il le reconnaît environ quarante-cinq ans après l’événement mais, chose étrange, parmi ses contemporains et ses amis. On trouve donc, sous le masque des Dadaïstes ressuscités, rien d’autre que Ionesco, Beckett, Sarraute, Adamov et Duras, sans oublier ce Robbe-Grillet qui Marienbad. La joyeuse petite équipe au complet rejoue donc en farce la tragédie de la mise à mort des formes artistiques. Sarraute ! qui l’eût dit ? Adamov ! qui l’eût cru ? Goldmann, bon public, commente gravement ce qu’il voit : « La plupart des grands écrivains d’avant-garde expriment surtout, non des valeurs réalisées ou réalisables, mais l’absence, l’impossibilité de formuler ou d’apercevoir des valeurs acceptables au nom desquelles ils pourraient critiquer la société ». Voilà justement ce qui est faux, comme il apparaît immédiatement si l’on abandonne les acteurs du roman comique de Goldmann pour examiner la réalité historique du dadaïsme allemand, ou du surréalisme entre les deux guerres. Goldmann semble littéralement les ignorer — ce qui est curieux : trouverait-il que l’on est fondé à contester complètement l’interprétation historique de son Dieu Caché, tout en signalant que l’on n’a lu ni Pascal ni Racine parce que le XVIIe siècle est complexe et qu’il est déjà bien long de venir à bout des œuvres complètes de Cotin ? On voit mal comment, en ayant au moins une connaissance sommaire de l’original, il pourrait trouver une telle fraîcheur au déguisement. Le vocabulaire même est peu adapté au sujet. On parle de « grands écrivains » de l’avant-garde, notion que l’avant-garde justement a jetée dans un ridicule définitif il y a bien longtemps. Plus loin, évoquant les amusements de bon goût que Planchon monte joliment avec les pièces et les morceaux d’une tradition théâtrale achevée, Goldmann qui subodore là encore quelque avant-gardisme dit qu’il n’y constate tout de même pas « une création littéraire d’importance égale, centrée sur la présence des valeurs humanistes et du devenir historique ». La notable quantité d’importance nulle qui appartient indélébilement à l’avant-garde goldmannienne fait pourtant à Planchon la partie belle. Mais enfin, Goldmann parle de création littéraire. Peut-il ne pas savoir que le rejet de la littérature, la destruction même de l’écriture, a été la première tendance des vingt ou trente années de recherches d’avant-garde en Europe, que ses pitres spectaculaires n’ont vu que par le mauvais bout de la lorgnette, et exploitent avec une parcimonie de petits rentiers ? Cette avant-garde de la réelle autodestruction de l’art avait traduit inséparablement l’absence et la présence possible d’une tout autre vie. Et faudrait-il donc verser dans la mystification de l’humanisme pour peu que l’on ne veuille pas suivre Adamov, dans cette absence qui lui va si bien qu’il est en passe d’en devenir propriétaire ?
Soyons plus sérieux que Goldmann. Il se demande dans le même article s’il existe dans la présente société, dans ce capitalisme moderne qui se consolide et se développe aussi fâcheusement que l’on sait, « des forces sociales assez puissantes pour provoquer son dépassement ou du moins orientées vers le dépassement ». Cette question est en effet très importante. Nous essaierons de prouver la réponse affirmative. L’étude démystifiée justement des mouvements d’avant-garde artistiques ou politiques réels peuvent donner en tout cas des éléments d’appréciation qui sont plutôt rares dans l’œuvre de Ionesco, comme dans celle de Garaudy. Le visible social de la société du spectacle est plus éloigné que jamais de la réalité sociale. Même son art d’avant-garde et sa pensée questionnante sont désormais maquillés dans l’éclairage de ce visible. Ceux qui se tiennent en dehors de ce Son et Lumière du présent qui ébahit tant Goldmann sont précisément, comme les situationnistes pour le moment, à l’avant-garde de la présence. Ce que Goldmann appelle l’avant-garde de l’absence n’est rien d’autre que l’absence de l’avant-garde. Nous animions hautement que, de toutes ces prétentions et agitations, il ne restera rien dans la problématique réelle et dans l’histoire de cette époque. Sur ce point comme sur les autres, on verra dans cent ans si nous nous sommes trompés.
L’avant-garde goldmanniste et son absentéisme sont d’ailleurs déjà en retard (Robbe-Grillet excepté, qui mise sur tous les numéros à la roulette du spectacle avant-gardiste). La dernière tendance est de s’intégrer, d’intégrer plusieurs arts entre eux, d’intégrer le spectateur à tout prix. D’abord, depuis Marienbad, qui est la référence journalistique obligatoire, on ne compte plus les œuvres qui ne peuvent exister « que par la participation individuelle du spectateur, chacun étant destiné à la ressentir différemment ». (Jacques Siclier dans Le Monde du 28 novembre 1962, à propos d’un quelconque ballet télévisé). Marc Saporta vient de publier un roman-jeu de cartes, qu’il faut battre avant la lecture, de sorte qu’on participe. Ensuite on intègre : une musique expérimentale que le visiteur pourra écouter, à des céramiques (exposition parisienne de Starczewski). De la musique de Stockhausen, mais dont la partition est devenue « mobile » au gré de l’interprète, à un film abstrait de l’Allemand Kirchgässer (Institut de musique contemporaine de Darmstadt). On a l’intégration de Nicolas Schoeffer et de la maison Philips dans un climat audiovisuel (le « mur-création »). Enfin, mille intégrations, à travers l’Europe, qui s’entr’intègrent dans les biennales de partout qui deviennent des Himalaya de l’intégration. Dans la même revue Médiations, il faut signaler l’intégration d’un métier nouveau : la critique en prose « abstraite » de l’œuvre abstraite, qui était courante depuis quinze ans dans les catalogues de peinture, et où Michel Tapié a réussi des merveilles, fait son apparition en littérature avec Jean Ricardou, qui transpose simplement la sage et enfantine forme de l’explication de texte, mais avec cette amélioration qu’il commente, peignant noir sur noir, les pages très peu lisibles, et volontairement pauvres de contenu, du nouveau roman pur, en un langage critique informel digne du modèle pour le contenu et la lisibilité. On peut aussi intégrer n’importe quoi, trente petites cuillers, cent mille bouteilles, un million de Suisses, dans le « nouveau réalisme », c’est sa force. La nouvelle figuration veut intégrer le passé, le présent et l’avenir de la peinture dans n’importe quoi qui paie bien, assurance tous risques pour les amateurs de l’abstrait et pour ceux du figuratif à la fois.
La culture étant ce qu’elle est, il faut bien que l’on n’intègre que des dissolutions les unes dans les autres. Et ces dissolutions sont elles-mêmes à peu près toujours des redites, que personne ne veut signaler, de quelque chose de plus ancien (le roman-jeu de cartes de Saporta est la reprise du poème-jeu de cartes de Paul Nougé, Le jeu des mots et du hasard, d’avant 1930, réédité il y a quelques années. On pourrait multiplier ces exemples.). Quant à l’intégration du spectateur dans ces belles choses, elle est une image appauvrie de son intégration dans les villes nouvelles, dans la densité de téléviseurs du territoire, dans l’entreprise qui l’emploie. Elle poursuit le même plan, mais avec infiniment moins de force, et même infiniment moins de cobayes. Les vieilles formes de l’art de la néo-décomposition sont maintenant, en elles-mêmes, loin du centre des luttes pour la maîtrise de la culture moderne. Le changement du terrain culturel n’est pas seulement la thèse de l’avant-garde révolutionnaire dans la culture, il est malheureusement aussi le projet inverse, déjà largement réalisé, des dirigeants actuels. Il faut pourtant noter à part les spécialistes du mouvement « cinétique ». Ceux-là veulent seulement intégrer le temps dans l’art. Ils n’ont pas eu de chance, puisque le programme de notre époque est plutôt de dissoudre l’art dans le temps vécu.
En plusieurs points déjà, des chercheurs, pour s’assurer une spécialisation moins encombrée, s’aventurent au-delà de ces intégrations hâtives et de leurs justifications sommaires. Des techniciens veulent réformer le spectacle comme Le Parc, dans un tract du « Groupe de Recherche d’Art Visuel », en septembre 1962, qui pense que l’on peut faire évoluer le spectateur passif jusqu’à être « spectateur-stimulé » ou même « spectateur-interprète », mais toujours dans le cadre des vieilleries spécialisées qui donneraient « des sortes de sculptures pour être luttées, de danses à être peintes, de tableaux à escrime ». Au plus, Le Parc va-t-il jusqu’à utiliser quelques formules para-situationnistes : « En admettant franchement le renversement de la situation traditionnelle du spectateur-passif, on contourne l’idée de spectacle… ». C’est pourtant une idée qu’il vaut mieux ne pas contourner, mais bien mesurer à sa juste place dans la société. La futilité des espérances de Le Parc sur son spectateur qui le comblera en atteignant « la participation réelle (manipulation d’éléments) » — oui ! et les artistes visuels auront là bien sûr leurs éléments tout prêts — aboutit à quelque chose de plus solide quand, à la fin du texte, la main est tendue du côté de « la notion de programmation », c’est-à-dire aux cybernéticiens du pouvoir. Il y en a qui vont beaucoup plus loin (cf. France-Observateur du 27-12-1962), comme ce « Service de la Recherche de la R.T.F. » qui ne voulait rien d’autre que « créer une situation » le 21 décembre dernier en organisant une conférence à l’U.N.E.S.C.O., avec la participation des fameux extra-terrestres qui dirigent la revue Planète.
La dialectique de l’histoire est telle que la victoire de l’Internationale situationniste en matière de théorie oblige déjà ses adversaires à se déguiser en situationnistes. Dès maintenant, il y a deux tendances dans la lutte rapprochée contre nous : ceux qui se proclament situationnistes sans en avoir aucune idée (les quelques variétés de nashisme). Ceux qui, au contraire, se décident à adopter quelques idées sans les situationnistes, et sans que l’on nomme l’I.S. La probabilité grandissante de la vérification de certaines de nos thèses, parmi les plus simples et les moins récentes, conduit bien des gens à reprendre une bonne part de l’une ou l’autre à leur compte sans le dire. Bien sûr, ceci n’est pas une question d’antécédents à reconnaître, de célébrités personnelles méritées, etc. S’il est intéressant de signaler cette tendance, c’est pour la dénoncer sur un seul point crucial : ces gens peuvent, ce faisant, parler d’un nouveau problème, pour le banaliser eux-mêmes après l’avoir repoussé tant qu’ils ont pu, en en extirpant seulement la violence, sa liaison avec la subversion générale, donc en le désamorçant jusqu’à l’exposé universitaire, ou pire. C’est dans cette intention qu’il est nécessaire de cacher l’I.S.
Ainsi le n° 102 de la revue Architecture d’aujourd’hui (juin-juillet 1962) est finalement consacré à un relevé des « architectures fantastiques », dont certaines tentatives anciennes et actuelles qui peuvent être fort intéressantes. Mais il se trouve que c’est seulement l’I.S. qui tient la clé de leur application intéressante. Avec les barbouilleurs d’Architecture d’aujourd’hui, elles ne servent qu’à orner les murailles de la passivité. Le directeur de cette revue, par exemple, dans son activité personnelle d’artiste, si l’on peut dire, a essayé presque tous les genres des sculpteurs à la mode, les imitant à s’y méprendre, ce qui paraît lui avoir donné une autorité confirmée en matière de plastique du conditionnement. Si des gens comme cela s’avisent maintenant qu’il faut améliorer le décor, c’est qu’ils agissent, comme tous les réformistes, pour contrer une pression plus forte en la prenant de vitesse. Ces responsables d’aujourd’hui veulent bien penser à réformer le décor, mais sans toucher à la vie que l’on y mène. Et ils appellent frileusement « système » les investigations à ce propos, afin d’être abrités de n’importe quelle conclusion là-dessus. Ce n’est pas pour rien que dans ce numéro on fait la part du pauvre au sous-produit « technicien » de l’urbanisme unitaire qui a dû quitter l’I.S. en 1960. Même cette sous-théorie au maximum de l’appauvrissement est trop gênante pour l’éclectisme des convertis du vieux fonctionnalisme. Pourtant nous, justement, nous ne défendons aucun système, et nous voyons mieux que personne, à tous les niveaux, le système qu’eux-mêmes défendent, et qui les défend en les mutilant tellement. Nous voulons la peau d’un tel système.
Nous devons faire la même objection aux personnes qui commencent depuis six ou dix mois à repenser dans quelques revues le problème des loisirs, ou celui des nouvelles relations humaines nécessaires à l’intérieur de la future organisation révolutionnaire. Qu’y manque-t-il ? l’expérience réelle, l’oxygène de la critique impitoyable de l’existant, la totalité. Le point de vue situationniste apparaît maintenant indispensable comme le levain, sans lequel retombe la pâte dégonflée des meilleurs thèmes soulevés par l’I.S. depuis quelques années. Ceux qui sont façonnés entièrement par l’ennui de la vie et de la pensée dominantes ne peuvent qu’applaudir aux loisirs de l’ennui. Ceux qui n’ont jamais bien perçu ni le présent ni le possible du mouvement révolutionnaire ne peuvent que rechercher une pierre philosophale psychotechnique. Celle qui retransmuterait les travailleurs modernes dépolitisés en militants dévoués d’organisations de gauche reproduisant si bien le modèle de la société établie qu’elles pourraient employer, ainsi qu’une usine, quelques psycho-sociologues pour huiler un peu leurs micro-groupes. Les méthodes de la sociométrie et du psychodrame ne mèneront personne très avant dans la construction des situations.
À mesure que la participation devient plus impossible, les ingénieurs de seconde classe de l’art moderniste exigent comme leur dû la participation de tout un chacun. Ils distribuent cette facture avec les prospectus du mode d’emploi en tant que règle du jeu devenue explicite, comme si cette participation n’avait pas été toujours la règle implicite d’un art où elle existait effectivement (dans les limites de classe et de profondeur qui ont encadré tout art). On nous presse insolemment d’« intervenir » dans un spectacle, dans un art qui nous concernent si peu. Derrière le comique de cette mendicité glorieuse, on rejoint les sphères sinistres de la haute police de la société du spectacle qui organise « la participation dans quelque chose où il est impossible de participer » — travail ou loisirs de la vie privée — (cf. I.S. 6, page 16). Il faut probablement revoir à cette lumière la naïveté apparente du texte cité de Le Parc, dans son irréalisme si étrange à propos du public qu’il veut « stimuler ». « On pourrait même, écrit-il, arriver dans ce souci de participation violente des spectateurs à la non-réalisation, non-contemplation, non-action. On pourra alors imaginer, par exemple, une dizaine de spectateurs non-action dans le noir le plus complet, immobiles, ne disant rien. » Il se trouve que, placés dans une telle position, les gens crient très fort, comme ont pu heureusement le remarquer tous ceux qui ont participé à l’action réelle de l’avant-garde négative, qui nulle part n’a été, comme croit Goldmann, avant-garde de l’absence pure, mais toujours mise en scène du scandale de l’absence pour appeler à une présence désirée, « la provocation à ce jeu qu’est la présence humaine » (« Manifeste » dans I.S. 4). Les écoliers du « Groupe de Recherche d’Art Visuel » ont une idée si métaphysique d’un public abstrait qu’ils ne le trouveront certainement pas sur le terrain de l’art — toutes ces tendances postulent avec une incroyable impudence un public totalement abruti, et capable d’un aussi pesant sérieux que ces spécialistes pour leurs petites machines. Mais en revanche un tel public est en voie de constitution au niveau de la société globale. C’est la « foule solitaire » de la société du spectacle, et ici Le Parc n’est plus si en avance qu’il croit sur la réalité ; dans l’organisation de cette aliénation, il n’y a certainement pas de spectateur libre de rester purement passif, leur passivité même est organisée, et les « spectateurs-stimulés » de Le Parc sont déjà partout.
Nous constatons toujours davantage que l’idée de construction de situations est une idée centrale de notre époque. Son image inverse, sa symétrie esclavagiste, apparaît dans tout le conditionnement moderne. Les premiers psychosociologues — dont Max Pagès dit qu’ils ne sont encore qu’une cinquantaine surgis dans les vingt dernières années — vont se multiplier vite ; ils commencent à savoir manipuler quelques situations données, encore grossières ; comme l’est aussi la situation collective permanente qui a été calculée pour les habitants de Sarcelles. Les artistes qui se rangent dans ce camp pour sauver une spécialisation de décorateurs de la machinerie cybernéticienne ne cachent pas qu’ils font leurs premières armes dans la manipulation de l’intégration. Mais du côté de la négation artistique rebelle à cette intégration, il semble que l’on ne puisse approcher ce terrain miné de la situation sans frôler la récupération, sauf si l’on se place sur les positions d’une nouvelle contestation cohérente sur tous les plans. Et d’abord le plan politique, où aucune organisation révolutionnaire future ne peut plus sérieusement se concevoir sans plusieurs qualités « situationnistes ».
Nous parlons de récupération du jeu libre, quand il est isolé sur le seul terrain de la dissolution artistique vécue. Au printemps de 1962, la presse a commencé à rendre compte de la pratique du happening parmi l’avant-garde artistique new-yorkaise. C’est une sorte de spectacle dissous à l’extrême, une improvisation de gestes, d’allure dadaïste, par des gens qui se trouvent ensemble en un lieu fermé. La drogue, l’alcool, l’érotisme y ont leur part. Les gestes des « acteurs » tentent un mélange de poésie, de peinture, de danse et de jazz. On peut considérer cette forme de rencontre sociale comme un cas-limite du vieux spectacle artistique dont les débris sont jetés là dans une fosse commune ; comme une tentative de renouvellement, trop encombrée alors d’esthétique, de la surprise-party ordinaire ou de l’orgie classique. On peut même estimer que, par la recherche naïve de « quelque chose qui se passe », l’absence de spectateurs séparés, et la volonté d’innover tant soit peu dans le si pauvre registre des relations humaines, le happening est, dans l’isolement, une recherche de construction d’une situation sur la base de la misère (misère matérielle, misère des rencontres, misère héritée du spectacle artistique, misère de la philosophie précise qui doit beaucoup « idéologiser » la réalité de ces moments). Les situations que l’I.S. a définies, au contraire, ne peuvent être construites que sur la base de la richesse, matérielle et spirituelle. Ce qui revient à dire que l’ébauche d’une construction des situations doit être le jeu et le sérieux de l’avant-garde révolutionnaire, et ne peut exister pour des gens qui se résignent sur certains points à la passivité politique, au désespoir métaphysique et même à la pure absence subie de la créativité artistique. La construction des situations est à la fois le but suprême et la première maquette d’une société où domineront des conduites libres et expérimentales. Mais le happening n’a pas attendu longtemps pour être importé en Europe (à Paris, en décembre, à la galerie Raymond Cordier) et totalement retourné par ses imitateurs français, obtenant un entassement de spectateurs figés dans une ambiance de bal à l’école des Beaux-Arts, comme pure et simple publicité d’un vernissage de petites choses surréalisantes.
Ce qui est construit sur la base de la misère sera toujours récupéré par la misère ambiante, et servira les garants de la misère. L’I.S. a évité au début de 1960 (cf. « Die Welt als Labyrinth », dans I.S. 4) le piège qu’était devenue cette proposition du Stedelijk Museum de construire un décor qui servirait de prétexte à une série de dérives dans Amsterdam et ainsi à quelques projets d’urbanisme unitaire pour cette ville. Il apparaissait que le labyrinthe dont l’ I.S. avait imposé le plan serait ramené par trente-six sortes de limitations et contrôles à quelque chose qui ne sortirait guère d’une manifestation de l’art d’avant-garde traditionnel. Nous avons alors rompu cet accord. Ce musée avant-gardiste semble être resté longtemps inconsolable, puisqu’il vient de faire réaliser finalement « son » labyrinthe en 1962, mais plus simplement confié à la bande du « nouveau-réalisme » qui a assemblé quelque chose de très photogénique « qui avait dada au cœur », comme disait Tzara dans son bon temps.
Nous voyons que ceux qui nous pressent d’exposer des projets de détail utilisables et convaincants — pourquoi devrions-nous les convaincre eux ? — si nous les leur fournissions, ou bien les retourneraient à l’instant contre nous comme preuves de notre utopisme, ou bien en favoriseraient une diffusion édulcorée dans l’immédiat. En vérité, on peut demander des projets de détail à presque tous les autres — c’est vous qui vous persuadez que beaucoup pourraient être satisfaisants — mais justement pas à nous ; c’est notre thèse qu’il n’y aura pas de renouvellement culturel fondamental dans le détail, mais seulement en bloc. Nous sommes évidemment très bien placés pour trouver, quelques années avant les autres, tous les trucs possibles de l’extrême décomposition culturelle actuelle. Comme ils ne sont utilisables que dans le spectacle de nos ennemis, nous gardons quelques lignes de notes là-dessus dans un tiroir. Après quelque temps, beaucoup sont bel et bien retrouvés spontanément et lancés à grands fracas par tel ou tel. Nous en possédons cependant une majorité qui n’est pas encore « rattrappée par l’histoire ». Plusieurs peuvent ne jamais l’être. Ce n’est même pas un jeu, c’est une vérification expérimentale de plus.
Nous pensons que l’art moderne, partout où il s’est trouvé réellement critique et novateur par les conditions mêmes de son apparition, a bien accompli son rôle qui était grand ; et qu’il reste, malgré la spéculation sur ses produits, détesté par les ennemis de la liberté. Il suffit de voir la peur qu’inspire en ce moment aux dirigeants de la déstalinisation homéopathique le plus mince signe de son retour chez eux, où on l’avait fait oublier. Ils le dénoncent comme une voie d’eau dans l’idéologie et avouent que le monopole de la manipulation de cette idéologie à chaque niveau est vital pour leur pouvoir. Mais tout de même les gens qui prospèrent maintenant à l’Ouest sur les prolongations respectueuses et les réanimations artificielles de l’ancien jeu culturel bloqué sont en réalité les ennemis de l’art moderne. Et nous, nous sommes ses légataires universels.
Nous sommes contre la forme conventionnelle de la culture, même dans son état le plus moderne ; mais évidemment pas en lui préférant l’ignorance, le bon sens petit-bourgeois du boucher, le néo-primitivisme. Il y a une attitude anti-culturelle qui est le courant d’un impossible retour aux vieux mythes. Nous sommes pour la culture, bien entendu, contre un tel courant. Nous nous plaçons de l’autre côté de la culture. Non avant elle, mais après. Nous disons qu’il faut la réaliser, en la dépassant en tant que sphère séparée ; non seulement comme domaine réservé à des spécialistes, mais surtout comme domaine d’une production spécialisée qui n’affecte pas directement la construction de la vie — y compris la vie même de ses propres spécialistes.
Nous ne sommes pas complètement dépourvus d’humour ; mais cet humour même est d’une espèce quelque peu nouvelle. S’il s’agit de choisir sommairement une attitude à propos de nos thèses, sans entrer dans les finesses ou telle compréhension plus subtile de nuances, le plus simple et le plus correct est de nous prendre avec un entier sérieux au pied de la lettre.
Comment allons-nous mettre en faillite la culture dominante ? De deux façons, graduellement d’abord et puis brusquement. Nous nous proposons d’utiliser d’une manière non-artistique des concepts d’origine artistique. Nous sommes partis d’une exigence artistique, qui ne ressemblait à aucun esthétisme ancien parce qu’elle était justement l’exigence de l’art moderne révolutionnaire dans ses plus hauts moments. Nous avons porté cette exigence dans la vie, donc vers la politique révolutionnaire, c’est-à-dire en fait son absence et la recherche des explications sur son absence. La politique révolutionnaire totale qui en découle, et qui est confirmée par les plus hauts moments de la lutte révolutionnaire réelle des cent dernières années, revient alors au premier temps de ce projet (une volonté de la vie directe), mais sans qu’il y ait plus d’art ni de politique comme formes indépendantes, ni la reconnaissance d’aucun autre domaine séparé. La contestation et la reconstruction du monde ne vivent que dans l’indivision d’un tel projet, où la lutte culturelle, au sens conventionnel, n’est plus que le prétexte et la couverture pour un travail plus profond.
Il est facile de dresser une liste interminable des problèmes à régler en priorité ; des difficultés ; ou même de quelques impossibilités à court terme qui sont attristantes. Il est probable que la grande popularité, par exemple, qu’a rencontré parmi les situationnistes le projet d’un scandale d’une ampleur assez notable dans les locaux parisiens de l’U.N.E.S.C.O., témoigne d’abord du goût, latent dans l’I.S., de trouver un terrain d’intervention concret, où une activité situationniste apparaîtrait ouvertement en tant que telle, positivement, une sorte de construction de l’événement accompagnant ici la prise de position retentissante contre le centre mondial de la culture bureaucratisée. Complémentaires à cet aspect des choses, les vues soutenues par Alexander Trocchi, précédemment et en ce moment, sur la clandestinité d’une part de l’action situationniste peuvent nous mener à augmenter notre liberté d’intervention. Dans la mesure où, comme l’écrit Vaneigem, « nous ne pouvons éviter de nous faire connaître jusqu’à un certain point sur le mode spectaculaire », ces nouvelles formes de clandestinité seraient sans doute utiles pour lutter contre notre propre image spectaculaire que forgent déjà nos ennemis et nos suiveurs disgrâciés. Comme tout prestige qui peut se constituer dans le monde (et bien que notre « prestige » soit vraiment très particulier), nous avons commencé à déchaîner les forces mauvaises de la soumission à nous-mêmes. Pour ne jamais céder à ces forces, il nous faudra inventer les défenses adéquates, qui dans le passé ont été très peu étudiées. Un autre des sujets de fatigue de l’action situationniste est certainement l’espèce de spécialisation que constitue forcément, dans une société de la pensée et de la pratique hautement spécialisées, la tâche de tenir la base de la non-spécialisation que tout assiège et bat en brèche, de porter les couleurs de la totalité. Un autre encore, l’obligation de juger les gens en fonction de notre action et de la leur, de rompre les rencontres avec plusieurs qui, à l’échelle de la vie privée — référence inacceptable, — seraient plaisants. Cependant la contestation de l’existant, si elle envisage aussi la vie quotidienne, se traduit naturellement en luttes dans la vie quotidienne. La liste de ces difficultés, disons-nous, est longue, mais les arguments qui en découlent demeurent extrêmement faibles puisque nous voyons parfaitement l’autre côté de l’alternative de la pensée au carrefour de cette époque, à savoir la soumission inconditionnelle sur tous les points. Nous avons fondé notre cause sur presque rien : l’insatisfaction et le désir irréductibles à propos de la vie.
L’I.S. est encore loin d’avoir créé des situations, mais elle a déjà créé des situationnistes, ce qui est beaucoup. Cette puissance de contestation libérée, outre ses premières applications directes, est l’exemple qu’une telle libération n’est pas impossible. De sorte que d’ici peu, en différentes matières, on va voir le travail.
* L’I.S. vous l’avait bien dit ! « Le Conseil a décidé que toute personne qui collaborera à la revue Arguments à partir du 1er janvier 1961 ne pourra en aucun cas être admise, à quelque moment de l’avenir que ce soit, parmi les situationnistes. L’annonce de ce boycott tire sa force de l’importance que nous savons garantie à l’I.S. au moins dans la culture des années qui vont suivre. Aux intéressés de risquer le pari contraire, si les compagnies douteuses les attirent. »
(Résolution du C.C. de l’I.S., le 6 novembre 1960,
publiée dans Internationale Situationniste 5 — page 13 — décembre 1960.)« Peut-être oserons-nous un jour affronter Dieu-problème, questionner le sacré et la religion. »
(Déclaration liminaire de la rédaction d’Arguments, numéro 24,
du quatrième trimestre 1961, paru en mars 1962.)« On peut aller jusqu’à qualifier ce niveau de la vie quotidienne de secteur colonisé… La vie quotidienne, mystifiée par tous les moyens et contrôlée policièrement, est une sorte de réserve pour les bons sauvages qui font marcher, sans la comprendre, la société moderne, avec le rapide accroissement de ses pouvoirs techniques et l’expansion forcée de son marché. »
(Internationale Situationniste 6 — page 22 — août 1961.)
« Ce fait aujourd’hui éclatant que cette vie quotidienne, considérée, en somme, comme le domaine colonisé de l’existence, comme la “réserve” pour les bons sauvages qui font marcher la société, soit devenue l’ennemie même de toute activité militante. »
(Arguments, numéro 25-26 — page 46 — des 1er et 2e trimestres de 1962, paru en juin.)
« Tous les textes publiés dans Internationale Situationniste peuvent être librement reproduits, traduits ou adaptés même sans indication d’origine. »
(Avertissement d’anti-copyright au début de tous les numéros d’I.S.)
DÉSORMAIS, LES PREUVES DE NOTRE JUGEMENT SONT FAITES :
« ARGUMENTS » N’A PLUS QU’À DISPARAÎTRE !* L’opération contre-situationniste dans divers pays LA DÉCLARATION publiée le 25 juin 1962 par l’Internationale situationniste à propos du procès d’Uwe Lausen à Munich énumérait les trois sortes de négation que, sans préjuger de la suite, le mouvement situationniste a rencontrées jusqu’ici : la police, comme en Allemagne ; le silence, dont le record est solidement détenu par la France ; enfin la falsification étalée, dont l’Europe du Nord a fourni pendant la dernière année le plus riche champ d’études. Il va de soi que ces trois méthodes ne sont nullement prédestinées à rester sans mélange, comme recettes locales, ainsi qu’elles ont pu être utilisées lors de la première apparition de situationnistes isolés. On peut prévoir au contraire, partout, mais à des dosages toujours changeants, une confluence de ces manières, dont la fonction commune est de faire disparaître les problèmes gênants. La police est un procédé apparemment quelque peu archaïque ; alors que la falsification est le pain quotidien de ce siècle ; et que le silence des spécialistes est une arme beaucoup plus récente de la société du spectacle. Mais la force de cette société est de pouvoir jouer simultanément sur ce clavier. Les éléments non intégrés devront de toute façon apprendre à maintenir et à faire progresser leur critique de la pensée et de la vie actuellement permises, en dépit d’un barrage de cette sorte et de son renforcement continu. L’I.S. donc ne s’étonne ni ne s’indigne de l’hostilité méritée qu’elle suscite. Il suffit d’en faire la description et l’analyse, dans la perspective des contre-mesures qui sont et seront à notre portée.
Dans les huit derniers mois, c’est sans contredit la tactique de l’imposture, par l’étalage de nuances situationnistes factices, qui caractérise surtout la résistance contre l’I.S. ; bien qu’un tel essai de falsification du programme situationniste ait eu des précédents, plus timides, que nous avons déjà fait retomber à l’oubli. On a cité (Internationale Situationniste 7, pages 53 et 54), l’espèce de manifeste par lequel Jørgen Nash, en mars s’attaquait à l’I.S., au nom de la section scandinave. Nash, tablant sur la grande dispersion de l’habitat des situationnistes scandinaves, n’avait pas consulté tout son monde avant son coup de force. Surpris de n’être pas unanimement suivi, et de se trouver contré sur place par les partisans de la majorité de l’I.S. diffusant aussitôt un démenti définitif, Nash a d’abord feint l’étonnement d’avoir abouti à une rupture complète avec les situationnistes, comme si le fait de lancer par surprise une attaque publique et mensongère était conciliable avec la poursuite d’un dialogue, sur la base d’on ne sait quelle autonomie d’une Scandinavie nashiste. D’ailleurs, le développement de la conspiration ne laisse guère de doute sur ses objectifs réels, puisque le « Bauhaus » suédois, réunissant deux ou trois anciens situationnistes scandinaves, plus une foule d’inconnus accourus en sentant la bonne soupe, s’est lancé immédiatement dans la production artistique la plus éculée (il n’y a pas à chercher plus loin que les « poèmes » d’un nommé Fazarkeley, comme on n’osait plus en écrire dès 1930, premier aboutissement des travaux de ce néo-Bauhaus). En même temps paraissait en Hollande une petite revue nashiste toute vide, intitulée Situationist Times, qui a cette particularité d’être uniquement « situationniste » en ceci qu’elle est dirigée contre l’I.S., la foule de ses collaborateurs occasionnels n’ayant jamais été situationnistes et ne pensant même pas à s’en vanter ; à l’unique exception d’un des deux directeurs, qui a passé dix-huit mois dans l’I.S. et en parle d’abondance. L’autre directeur n’est rien de mieux que Noël Arnaud, ressorti de sa tombe stalino-pataphysique. Dans le reste de cette éclectique assemblée, sont mêlés un ex-lettriste et, à titre encore plus posthume, Boris Vian. Dans la polémique entre nashistes et situationnistes en Scandinavie, les nashistes ont recouru, aussi bien qu’à toutes les menaces et violences qu’ils ont cru praticables, à la diffusion systématique d’une série de fausses nouvelles (aidés en cela par quelques journalistes résolument complices). La plus retentissante, au mois de juin, c’était simplement que l’I.S. avait accepté de reprendre le dialogue avec eux en vue de leur réintégration. Et pour prouver leur chance, ils faisaient état d’une lettre du Conseil Central, qui était un faux pur et simple. Enfin, et malgré le fait que la grande extension de cette affaire dans la presse scandinave ait porté le débat sur un terrain qui, par nature, devait être plus favorable à la déformation nashiste qu’à l’exposé objectif des thèses de l’I.S. — tous leurs efforts pour gagner du temps, et prolonger à la petite semaine la confusion, n’ont pu empêcher les nashistes d’apparaître pour ce qu’ils sont : étrangers à l’I.S., beaucoup plus sociables certainement, mais beaucoup moins intelligents.
Tous les nashistes ont d’abord déclaré, une bonne fois et pour ne plus avoir jamais à y penser, qu’ils étaient d’accord avec toutes les théories de l’I.S. ; mais ils ne le sont en rien avec sa pratique. Ce qu’ils attaquent de cette pratique, d’ailleurs, c’est sur le seul point de la discipline excessive de l’I.S. Et cet excès de discipline n’est précisément rien d’autre que l’accord des situationnistes pour chercher un certain rapport entre leurs théories et leur pratique possible. La pratique que veulent les nashistes, c’est très évidemment la continuation de l’art moderniste « actuel » — c’est-à-dire plus que passé — mais assortie de beaux bavardages et d’une étiquette qui soient publicitaires. Le peu de créativité de ces gens (qui ne s’accordent entre eux sur rien, sauf sur l’opposition à l’I.S. qu’ils ont connue fort mal ou pas du tout), momentanément fédérés par le nashisme, explique qu’ils aiment mieux dire vite qu’ils adopteront toutes nos thèses, plutôt que s’épuiser à un quelconque révisionnisme. Mais leur carence est si excessive qu’il est même probable qu’ils n’auront pas la force de s’y référer, même par de plats commentaires. Il serait bizarre que ceux mêmes d’entre eux qui sont d’ex-situationnistes excercent maintenant sous la pression d’une nécessité contestable (car nos idées ne sont pas vraiment une bonne recommandation pour des arrivistes) un talent qu’ils ont si soigneusement dissimulé quand ils étaient dans l’I.S.
Nous ne voulons pas attribuer à Nash et à ses associés une perversité particulière. Il nous semble que le nashisme exprime une tendance objective, résultant de la politique ambiguë et aventureuse dont l’I.S. a dû prendre le risque en acceptant d’agir dans la culture, en étant contre toute l’organisation présente de cette culture, et même contre toute la culture comme sphère séparée — et il n’est pas moins ambigu et aventureux forcément de vivre en portant sur toutes choses le regard et le programme de la plus rude contestation, qui tout de même coexiste avec la vie telle qu’elle est faite. Ceux des situationnistes allemands qui ont été exclus au début de 1962 exprimaient, avec plus de franchise, et aussi plus de puissance artistique, une opposition comparable à celle des nashistes en ce qu’elle pourrait avoir quand même de réellement fondée. L’intervention d’Heimrad Prem à la Conférence de Göteborg (cf. I.S. 7, pages 28-29), insistait sur le refus réitéré que la majorité situationniste a opposé à un grand nombre d’offres de « réalisations » sur le plan conventionnel de l’avant-garde artistique, où beaucoup de gens voulaient engager l’I.S., ramenant ainsi les choses dans l’ordre, et les situationnistes dans les vieilles classifications de la praxis artistique. Prem exprimait le désir des artistes situationnistes de trouver un champ d’activité suffisant dans l’immédiat. Il est certain que cette attitude, qui ambitionne de renouveler seulement et tout de suite l’art, est en contradiction totale avec la théorie situationniste qui postule qu’on ne peut plus apporter de renouvellement fondamental de l’art traditionnel séparé, sans les autres transformations nécessaires, sans la reconstruction libre de la société globale (l’hypothèse de la situation construite étant un premier exemple d’une explosion post-artistique qui désintégrera toutes les « armes conventionnelles » de l’art ancien). Les nashistes ont seulement poussé beaucoup plus loin la mauvaise foi, l’indifférence profonde à n’importe quelle théorie et même à l’action artistique conventionnelle, au profit de la grossière publicité commerciale. Mais les amis de Prem, quoique plus dignes, n’avaient certes pas complètement évité eux-mêmes les concessions au marché culturel. Il apparaît donc qu’il y a eu dans l’I.S., où ils se sont réfugiés en passant, des artistes de la répétition, incapables de comprendre la mission actuelle de l’avant-garde artistique, ce qui n’est pas trop surprenant si l’on tient compte à la fois du caractère à peine ébauché de notre recherche et de l’épuisement notoire de l’art conventionnel. Le moment où les contradictions entre eux et nous aboutissent à ces antagonismes indique une avance de l’I.S. jusqu’au point où les ambiguïtés sont forcées de venir au jour et d’être tranchées. Le point de non-retour, dans les rapports avec les partisans d’un rajeunissement de l’art conventionnel sous l’autorité d’une école situationniste, a peut-être été atteint avec la décision adoptée à Göteborg de nommer anti-situationnistes les productions artistiques du mouvement. Les contradictions dont le nashisme était porteur sont vulgaires, mais il peut y en avoir bien d’autres à un degré supérieur du développement de l’I.S. Le point de rupture actuel est cependant notable en ceci qu’il marque le moment où le milieu culturel dominant passe à l’offensive, dans le but de nous éliminer avant que nous ne soyons devenus trop forts. On avait rencontré précédemment quelques essais de falsifications, comme celle du prétendu « urbanisme unitaire » de la Ruhr au printemps de 1961 (cf. I.S. 6, page 7). Mais nous sommes maintenant devant une tentative centrale. Tous ceux qui connaissent l’I.S. ont pu constater qu’elle résistait aux pressions de toutes sortes, et allait vers le contraire d’un adoucissement et d’une atténuation de sa pensée. Le milieu culturel, même dans ses nuances les plus modernistes et bienveillantes, va donc en même temps favoriser le maximum de confusion sur la réalité de l’I.S. (brutalement : les capitaux ne manqueront jamais aux entreprises nashistes) ; nous traiter plus ouvertement encore en réprouvés (comme c’est apparu avec le grand nombre de gens qui ont refusé de défendre Uwe Lausen avant son emprisonnement, alors que les mêmes avaient pris la défense des exclus de la section allemande de l’I.S. poursuivis pour le même délit de presse ancien) ; et particulièrement essayer d’organiser un étouffement économique renforcé.
Dans ce courant, le détail nashiste actuel n’est qu’un épiphénomène. Ses successeurs seront sans doute plus forts. Les Nash sont interchangeables : ils représentent notre antagonisme avec le vieux monde artistique.
L’évolution du nashisme, depuis le début de sa brève vie, confirme déjà notre analyse. Coupé de l’I.S. dont la section scandinave publie maintenant la revue Situationistisk Revolution, les nashistes ont retrouvé très vite ce qu’il y a de plus traditionnel dans les mœurs du milieu artistique, c’est-à-dire d’une part les marchandages et petits fours des vernissages, d’autre part, la saine plaisanterie du style « École des Beaux-Arts ». Nash a fait savoir aux journaux que, parmi ses partisans exclus de l’I.S., le plus désolé était Ambrosius Fjord, qui n’arrivait pas à comprendre les raisons de son malheur. En effet, Ambrosius Fjord ne serait autre qu’un cheval appartenant à Nash, qui aurait mis un jour son nom sous une proclamation quelconque, parce qu’il manquait un Norvégien représentatif pour que le nashisme scandinave fût au complet. Est-ce un exemple de la fameuse règle du pouvoir absolu qui corrompt absolument ? Toujours est-il que, resté le premier dans son village à la suite de son pronunciamento, Caïus Nash a fait de son cheval un situationniste. Attendons sa prochaine trouvaille : il prétendra que son cheval était en plus membre du Conseil Central de l’I.S. ; il a déjà essayé quelque chose de ce genre (voir I.S. 7, page 54). Le nashisme est ainsi tellement tourné vers le passé, que le seul effort d’imagination des nashistes jusqu’ici a été de remodeler à leur guise leur mince passé situationniste. D’ailleurs, plus récemment, au mois de septembre, le même Nash s’est dissimulé sous l’identité d’un autre cheval appelé Patrick O’Brien (à moins qu’il ne s’agisse cette fois d’un coyote ou d’un hareng également nashiste inconditionnel ?) pour présenter, dans une galerie de la ville d’Odense, la peinture de « Sept rebelles » dont il avoue maintenant qu’ils ont été jetés par l’I.S. — bien que certains n’aient même jamais eu pareille occasion — et qu’ils sont enfin entre eux dans une « Internationale Situationniste-Scandinave ». Belle Idée. Après le national-situationnisme que méditaient en 1961 certains Allemands, la savante écurie de Nash nous fera connaître le situscandinavisme. Qu’y faire ? Si tous les chevaux qui savent compter savaient également parler, les cirques feraient d’encore plus belles recettes.
Il y a tout de même, dans la polémique insignifiante des nashistes, un point qui vaut d’être éclairé parfaitement. Ils ont affirmé que la majorité qui les excluait était douteuse, mais pour la faire apparaître douteuse ils ont publié (sur la réunion du C.C. à Paris en février), des chiffres et des faits qui sont des mensonges absolument non douteux, et ainsi démoli leur propre prétention « démocratique ». Cette question doit être pourtant précisée, parce qu’elle concerne la nature même de l’I.S. La majorité de l’I.S. a effectivement suivi des règles démocratiques, formellement, ce qui a placé toute contradiction nashiste sur un plan de pure malhonnêteté. Mais le fond du problème est ailleurs : si la mauvaise politique des recrutements aveugles et du noyautage de l’I.S., dans certains pays, par des suiveurs débiles ou intéressés, avait été tolérée encore un peu plus longtemps, certainement le nombre des faux situationnistes officiellement intégrés à l’I.S. serait devenu majoritaire. Cela n’aurait rien changé, pour les situationnistes, au droit et au devoir de les rejeter comme non-situationnistes. Ceci pour le plus élémentaire motif ; parce qu’ils ne comprenaient pas et n’approuvaient pas notre base de pensée et d’action, comme tout le démontrait à tout instant, à une unique exception près : leur choix d’adhérer un jour à l’I.S. Agissant ainsi, nous n’en aurions pas moins représenté toute l’I.S., et eux rien. Mais il valait mieux s’épargner un tel recours à la violence scissionniste ; et il était hors de question de suivre les nashistes sur leur terrain de lutte en acceptant de baisser, même légèrement, le niveau exigé des situationnistes dans la plupart des pays, afin d’augmenter le poids des sections « loyalistes ». Une telle astuce pratiquée pour maintenir l’apparence du vote égalitaire, eût signifié en fait le renoncement de tous à une égalité réelle dans l’I.S. (l’admission irréversible de disciples ou de militants subordonnés). Il était donc temps de rejeter la minorité arriviste avant qu’elle ne prolifère davantage par cooptation ; et d’instaurer des règles plus objectives pour l’entrée dans l’I.S., où que la question se pose.
L’I.S. ne peut pas être organisation massive, et ne saurait même accepter, comme les groupes d’avant-garde artistiques conventionnels, des disciples. À ce moment de l’histoire où est posée, dans les plus défavorables conditions, la tâche de réinventer la culture et le mouvement révolutionnaire sur une base entièrement nouvelle, l’I.S. ne peut être qu’une Conspiration des Égaux, un état-major qui ne veut pas de troupes. Il s’agit de trouver, d’ouvrir le « passage au Nord-Ouest » vers une nouvelle révolution qui ne saurait connaître de masses d’exécutants, et qui doit déferler sur ce terrain central, jusqu’ici abrité des secousses révolutionnaires, la conquête de la vie quotidienne. Nous n’organisons que le détonateur : l’explosion libre devra nous échapper à jamais, et échapper à quelque autre contrôle que ce soit.
Une des armes traditionnelles du vieux monde, la plus employée peut-être contre les groupes qui expriment une recherche dans la disposition de la vie, c’est d’y distinguer et isoler quelques noms de « vedettes ». Nous devons nous défendre contre ce processus qui présente, comme presque tous les ignobles choix habituels de la société présente, l’apparence du « naturel ». Il est indiscutable que ceux qui voulaient parmi nous tenir un rôle de vedette ou tabler sur des vedettes devaient être rejetés. Il se trouve d’ailleurs qu’ils n’avaient pas les moyens de leurs ambitions ; et nous sommes en mesure de garantir leur disparition complète de la zone d’influence de la problématique situationniste — le seul Nash excepté, à qui nous ferons un sort : il va être célèbre pour les autres ! Parmi les membres de l’I.S. maintenant — dont aucun ne veut jouer un tel jeu hiérarchique — ce péril objectif se présentera plus réellement, car l’I.S. entre dans une phase plus publique, et ces situationnistes donneront, plus que des nashistes, matière à des exégèses ou commentaires qui peuvent être extrêmement éloignés de leurs buts réels et de ceux de l’I.S. (voir les interprétations très personnelles du dernier chapitre de l’ouvrage de M. Robert Estivals, L’avant-garde culturelle parisienne depuis 1945).
En parant à ce processus de mise en vedette, qui tend à reconstituer l’ancien modèle de la culture et de la société, nous devons tenir compte des différents degrés de publicité que connaîtra obligatoirement la participation à l’I.S., ne serait-ce que la division entre les situationnistes connus et nos camarades clandestins, cette clandestinité étant inévitable dans des pays où nous ne pouvons développer autrement nos liaisons, et même souhaitable pour quelques autres cas, à condition que les membres clandestins de l’I.S. soient choisis parmi les plus sûrs, et non comme le proposaient les nashistes des éléments plus ou moins incontrôlables ou doubles. La répression même va normalement placer plus en vue tel ou tel de nous. Dans les guerres de décolonisation de la vie quotidienne, il ne saurait y avoir de culte des chefs (« un seul héros : l’I.S. »).
C’est le même mouvement qui nous ferait admettre des situationnistes exécutants, et qui nous fixerait sur des positions erronées. Il est dans la nature du disciple de demander des certitudes, de transformer des problèmes réels en dogmes stupides, pour en tirer sa qualité, et son confort intellectuel. Et ensuite, bien sûr, de se révolter, au nom de ces certitudes réduites, contre ceux mêmes qui les lui ont transmises, pour rajeunir leur enseignement. Ainsi se fait, avec le temps, le renouvellement des élites de l’acceptation. Nous voulons laisser de tels gens au dehors parce que nous combattrons tous ceux qui veulent transformer la problématique théorique de l’I.S. en simple idéologie ; ces gens sont extrêmement désavantagés et inintéressants par rapport à tous ceux qui ignorent l’I.S., mais regardent leur propre vie. Ceux qui au contraire, ont compris la direction où va l’I.S., peuvent s’y joindre, parce que tout le dépassement dont nous parlons est à trouver effectivement dans la réalité, et nous devons le trouver ensemble. La tâche d’être plus extrémiste que l’I.S. appartient à l’I.S., c’est même la première loi de sa permanence.
Il se trouve déjà certaines gens qui, par paresse, croient pouvoir arrêter notre projet à un programme parfait, déjà là, admirable, incriticable, devant lequel ils n’ont plus rien à faire. Sauf se déclarer encore plus radicaux de cœur, dans l’abstention, puisque tout serait déjà dit par l’I.S., on ne peut mieux. Nous disons au contraire que non seulement le plus important des questions que nous avons ouvertes est encore à trouver — par l’I.S. et par d’autres — mais aussi que le plus important de ce que nous avons déjà trouvé n’est pas encore publié, du fait de notre manque de moyens de toutes sortes ; sans parler même de l’absence encore plus sensible de moyens pour les expériences que l’I.S. a esquissé en d’autres domaines (et d’abord en matière de comportement). Mais, par exemple, sans sortir des problèmes éditoriaux, nous estimons maintenant que nous devons réécrire nous-même le plus intéressant de tout ce que nous avons publié jusqu’ici. Il ne s’agit pas ce faisant de réviser certaines erreurs, ou de supprimer quelques germes déviationnistes dont on a pu voir depuis les aboutissements grossis (par exemple, la conception technocratique de Constant à propos du métier situationniste, voir I.S. 4 pages 24 et 25), mais au contraire de corriger et améliorer nos thèses les plus importantes, celles justement dont le développement nous a menés plus loin, à partir de la connaissance acquise maintenant grâce à elles. Ce qui obligera à différentes rééditions, alors que les difficultés d’édition courante de l’I.S. sont bien loin d’être résolues.
Ceux qui croient, à propos de la pensée situationniste primitive, qu’elle est déjà un acquis historique à propos duquel le temps serait venu de la falsification rageuse aussi bien que de l’admiration béate, n’ont pas compris le mouvement dont nous parlons. L’I.S. a semé le vent. Elle récoltera la tempête.
* DÉFINITION
adoptée par la Conférence d’Anvers, sur le rapport de J.V. MartinNashisme : terme tiré régulièrement du nom de Nash, auteur qui semble avoir vécu au Danemark au XXe siècle. Principalement connu pour sa tentative de trahison du mouvement et de la théorie révolutionnaire de ce temps, Nash a vu son nom détourné par ce mouvement comme terme générique applicable à tous les faux-frères dans les luttes engagées contre les conditions dominantes de la culture et de la société. Exemple : « Le nashisme cependant a passé du matin au soir, ainsi que l’herbe des champs ». Allemand : nashismus. Anglais : nashism. Italien : nascismo. Nashiste : partisan de Nash, ou de sa doctrine. Par extension, ce qui relève, dans la conduite ou l’expression, des intentions ou de l’allure du nashisme. Nashistique : doublet populaire, probablement par attraction de l’adjectif anglais nashistic. Nashisterie : généralement, le milieu social du nashisme. L’argot nashistouse est vulgaire.
* All the King’s men LE PROBLÈME du langage est au centre de toutes les luttes pour l’abolition ou le maintien de l’aliénation présente ; inséparable de l’ensemble du terrain de ces luttes. Nous vivons dans le langage comme dans l’air vicié. Contrairement à ce qu’estiment les gens d’esprit, les mots ne jouent pas. Ils ne font pas l’amour, comme le croyait Breton, sauf en rêve. Les mots travaillent, pour le compte de l’organisation dominante de la vie. Et cependant, ils ne sont pas robotisés ; pour le malheur des théoriciens de l’information, les mots ne sont pas eux-mêmes « informationnistes » ; des forces se manifestent en eux, qui peuvent déjouer les calculs. Les mots coexistent avec le pouvoir dans un rapport analogue à celui que les prolétaires (au sens classique aussi bien qu’au sens moderne de ce terme) peuvent entretenir avec le pouvoir. Employés presque tout le temps, utilisés à plein temps, à plein sens et à plein non-sens, ils restent par quelque côté radicalement étrangers.
Le pouvoir donne seulement la fausse carte d’identité des mots ; il leur impose un laisser-passer, détermine leur place dans la production (où certains font visiblement des heures supplémentaires) ; leur délivre en quelque sorte leur bulletin de paye. Reconnaissons le sérieux du Humpty-Dumpty de Lewis Carroll qui estime que toute la question, pour décider de l’emploi des mots, c’est « de savoir qui sera le maître, un point c’est tout ». Et lui, patron social en la matière, affirme qu’il paie double ceux qu’il emploie beaucoup. Comprenons aussi le phénomène d’insoumission des mots, leur fuite, leur résistance ouverte, qui se manifeste dans toute l’écriture moderne (depuis Baudelaire jusqu’aux dadaïstes et à Joyce), comme le symptôme de la crise révolutionnaire d’ensemble dans la société.
Sous le contrôle du pouvoir, le langage désigne toujours autre chose que le vécu authentique. C’est précisément là que réside la possibilité d’une contestation complète. La confusion est devenue telle, dans l’organisation du langage, que la communication imposée par le pouvoir se dévoile comme une imposture et une duperie. C’est en vain qu’un embryon de pouvoir cybernéticien s’efforce de placer le langage sous la dépendance des machines qu’il contrôle, de telle sorte que l’information soit désormais la seule communication possible. Même sur ce terrain, des résistances se manifestent, et l’on est en droit de considérer la musique électronique comme un essai, évidemment ambigu et limité, de renverser le rapport de domination en détournant les machines au profit du langage. Mais l’opposition est bien plus générale, bien plus radicale. Elle dénonce toute « communication » unilatérale, dans l’art ancien comme dans l’informationnisme moderne. Elle appelle à une communication qui ruine tout pouvoir séparé. Là où il y a communication, il n’y a pas d’État.
Le pouvoir vit de recel. Il ne crée rien, il récupère. S’il créait le sens des mots, il n’y aurait pas de poésie, mais uniquement de l’« information » utile. On ne pourrait jamais s’opposer dans le langage, et tout refus lui serait extérieur, serait purement lettriste. Or, qu’est-ce que la poésie, sinon le moment révolutionnaire du langage, non séparable en tant que tel des moments révolutionnaires de l’histoire, et de l’histoire de la vie personnelle ?
La mainmise du pouvoir sur le langage est assimilable à sa mainmise sur la totalité. Seul le langage qui a perdu toute référence immédiate à la totalité peut fonder l’information. L’information, c’est la poésie du pouvoir (la contre-poésie du maintien de l’ordre), c’est le truquage médiatisé de ce qui est. À l’inverse, la poésie doit être comprise en tant que communication immédiate dans le réel et modification réelle de ce réel. Elle n’est autre que le langage libéré, le langage qui regagne sa richesse et, brisant ses signes, recouvre à la fois les mots, la musique, les cris, les gestes, la peinture, les mathématiques, les faits. La poésie dépend donc du niveau de la plus grande richesse où, dans un stade donné de la formation économique-sociale, la vie peut être vécue et changée. Il est alors inutile de préciser que ce rapport de la poésie à sa base matérielle dans la société n’est pas une subordination unilatérale, mais une interaction.
Retrouver la poésie peut se confondre avec réinventer la révolution, comme le prouvent à l’évidence certaines phases des révolutions mexicaine, cubaine ou congolaise. Entre les périodes révolutionnaires où les masses accèdent à la poésie en agissant, on peut penser que les cercles de l’aventure poétique restent les seuls lieux où subsiste la totalité de la révolution, comme virtualité inaccomplie mais proche, ombre d’un personnage absent. De sorte que ce qui est appelé ici aventure poétique est difficile, dangereux, et en tout cas, jamais garanti (en fait, il s’agit de la somme des conduites presque impossibles dans une époque). On peut seulement être sûrs de ce qui n’est plus l’aventure poétique d’une époque sa fausse poésie reconnue et permise. Ainsi, alors que le surréalisme, au temps de son assaut contre l’ordre oppressif de la culture et du quotidien, pouvait justement définir son armement dans une « poésie au besoin sans poèmes », il s’agit aujourd’hui pour l’I.S. d’une poésie nécessairement sans poèmes. Et tout ce que nous disons de la poésie ne concerne en rien les attardés réactionnaires d’une néo-versification, même alignée sur les moins anciens des modernismes formels. Le programme de la poésie réalisée n’est rien de moins que créer à la fois des événements et leur langage, inséparablement.
Tous les langages fermés — ceux des groupements informels de la jeunesse ; ceux que les avant-gardes actuelles, au moment où elles se cherchent et se définissent, élaborent pour leur usage interne ; ceux qui, autrefois, transmis en production poétique objective pour l’extérieur, ont pu s’appeler « trobar clus » ou « dolce stil nuovo », — tous ont pour but, et résultat effectif, la transparence immédiate d’une certaine communication, de la reconnaissance réciproque, de l’accord. Mais pareilles tentatives sont le fait de bandes restreintes, à divers titres isolées. Les événements qu’elles ont pu aménager, les fêtes qu’elles ont pu se donner à elles-mêmes, ont dû rester dans les plus étroites limites. Un des problèmes révolutionnaires consiste à fédérer ces sortes de soviets, de conseils de la communication, afin d’inaugurer partout une communication directe, qui n’ait plus à recourir au réseau de la communication de l’adversaire (c’est-à-dire au langage du pouvoir), et puisse ainsi transformer le monde selon son désir.
Il ne s’agit pas de mettre la poésie au service de la révolution, mais bien de mettre la révolution au service de la poésie. C’est seulement ainsi que la révolution ne trahit pas son propre projet. Nous ne rééditerons pas l’erreur des surréalistes se plaçant à son service quand précisément il n’y en avait plus. Lié au souvenir d’une révolution partielle vite abattue, le surréalisme est vite devenu un réformisme du spectacle, une critique d’une certaine forme du spectacle règnant, menée à l’intérieur de l’organisation dominante de ce spectacle. Les surréalistes semblent avoir négligé le fait que le pouvoir imposait, pour toute amélioration ou modernisation internes du spectacle, sa propre lecture, un décryptage dont il tient le code.
Toute révolution a pris naissance dans la poésie, s’est faite d’abord par la force de la poésie. C’est un phénomène qui a échappé et continue d’échapper aux théoriciens de la révolution — il est vrai qu’on ne peut le comprendre si on s’accroche encore à la vieille conception de la révolution ou de la poésie —, mais qui a généralement été ressenti par les contre-révolutionnaires. La poésie, là où elle existe, leur fait peur ; ils s’acharnent à s’en débarrasser par divers exorcismes, de l’autodafé à la recherche stylistique pure. Le moment de la poésie réelle, qui « a tout le temps devant elle », veut chaque fois réorienter selon ses propres fins l’ensemble du monde et tout le futur. Tant qu’il dure, ses revendications ne peuvent connaître de compromis. Il remet en jeu les dettes non réglées de l’histoire. Fourier et Pancho Villa, Lautréamont et les dinamiteros des Asturies — dont les successeurs inventent maintenant de nouvelles formes de grève — les marins de Cronstadt ou de Kiel, et tous ceux qui, dans le monde, avec et sans nous, se préparent à lutter pour la longue révolution, sont aussi bien les émissaires de la nouvelle poésie.
La poésie est de plus en plus nettement, en tant que place vide, l’anti-matière de la société de consommation, parce qu’elle n’est pas une matière consommable (selon les critères modernes de l’objet consommable : équivalent pour une masse passive de consommateurs isolés). La poésie n’est rien quand elle est citée, elle ne peut être que détournée, remise en jeu. La connaissance de la poésie ancienne n’est autrement qu’exercice universitaire, relevant des fonctions d’ensemble de la pensée universitaire. L’histoire de la poésie n’est alors qu’une fuite devant la poésie de l’histoire, si nous entendons par ce terme non l’histoire spectaculaire des dirigeants, mais bien celle de la vie quotidienne, de son élargissement possible ; l’histoire de chaque vie individuelle, de sa réalisation.
Il ne faut pas ici laisser d’équivoque sur le rôle des « conservateurs » de la poésie ancienne, de ceux qui en augmentent la diffusion à mesure que, pour des raisons tout autres, l’État fait disparaître l’analphabétisme. Ces gens ne représentent qu’un cas particulier des conservateurs de tout l’art des musées. Une masse de poésie est normalement conservée dans le monde. Mais il n’y a nulle part les endroits, les moments, les gens pour la revivre, se la communiquer, en faire usage. Étant admis que ceci ne peut jamais être que sur le mode du détournement ; parce que la compréhension de la poésie ancienne a changé par perte aussi bien que par acquisition de connaissances ; et parce que dans chaque moment où la poésie ancienne peut être effectivement retrouvée, sa mise en présence avec des événements particuliers lui confère un sens largement nouveau. Mais surtout, une situation où la poésie est possible ne saurait restaurer aucun échec poétique du passé (cet échec étant ce qui reste, inversé, dans l’histoire de la poésie, comme succès et monument poétique). Elle va naturellement vers la communication, et les chances de souveraineté, de sa propre poésie.
Étroitement contemporains de l’archéologie poétique qui restitue des sélections de poésie ancienne récitées sur microsillons par des spécialistes, pour le public du nouvel analphabétisme constitué par le spectacle moderne, les informationnistes ont entrepris de combattre toutes les « redondances » de la liberté pour transmettre simplement des ordres. Les penseurs de l’automatisation visent explicitement une pensée théorique automatique, par fixation et élimination des variables dans la vie comme dans le langage. Ils n’ont pas fini de trouver des os dans leur fromage ! Les machines à traduire, par exemple, qui commencent à assurer l’uniformisation planétaire de l’information, en même temps que la révision informationniste de l’ancienne culture, sont soumises à leurs programmes préétablis, auxquels doit échapper toute acception nouvelle d’un mot, aussi bien que ses ambivalences dialectiques passées. Ainsi, en même temps, la vie du langage — qui se relie à chaque avance de la compréhension théorique : « Les idées s’améliorent. Le sens des mots y participe » — se trouve expulsée du champ machiniste de l’information officielle, mais aussi la pensée libre peut s’organiser en vue d’une clandestinité qui sera incontrôlable par les techniques de police informationniste. La recherche de signaux indiscutables et de classification binaire instantanée va si clairement dans le sens du pouvoir existant, qu’elle relèvera de la même critique. Jusque dans leurs formulations délirantes, les penseurs informationnistes se comportent en lourds précurseurs à brevets des lendemains qu’ils ont choisis, et qui sont justement ceux que modèlent les forces dominantes de la société actuelle : le renforcement de l’État cybernéticien. Ils sont les hommes liges de tous les suzerains de la féodalité technique qui s’affermit actuellement. Il n’y a pas d’innocence dans leur bouffonnerie, ils sont les fous du roi.
L’alternative entre l’informationnisme et la poésie ne concerne plus la poésie du passé ; de même qu’aucune variante de ce qu’est devenu le mouvement révolutionnaire classique ne peut plus, nulle part, être comptée dans une alternative réelle face à l’organisation dominante de la vie. C’est d’un même jugement que nous tirons la dénonciation d’une disparition totale de la poésie dans les anciennes formes où elle a pu être produite et consommée, et l’annonce de son retour sous des formes inattendues et opérantes. Notre époque n’a plus à écrire des consignes poétiques, mais à les exécuter.
RÉSUMÉ DES CHAPITRES PRÉCÉDENTS Le WELFARE STATE nous impose aujourd’hui, sous la forme de techniques de confort (mixer, conserves, Sarcelles et Mozart pour tous), les éléments d’une SURVIE au maintien de laquelle le plus grand nombre des hommes n’a cessé et ne cesse de consacrer toute son énergie, s’interdisant du même coup de VIVRE.
Or, l’organisation qui répartit l’équipement matériel de notre vie quotidienne est telle que ce qui, en soi, devrait permettre de la construire richement nous plonge dans un luxe de pauvreté et rend l’aliénation d’autant plus insupportable que chaque élément de confort nous tombe dessus avec l’allure d’une libération et le poids d’une servitude. Nous voici condamnés à l’esclavage du travail libérateur.
Pour comprendre ce problème, il importe de le situer dans l’éclairage du pouvoir hiérarchisé, qui est l’évidence du jour et de la nuit. Mais peut-être ne suffit-il pas de dire que le pouvoir hiérarchisé protège l’humanité depuis des millénaires comme l’alcool protège le fœtus en l’empêchant de pourrir ou de croître. II faut encore préciser que le pouvoir hiérarchisé représente le stade le plus élevé de l’appropriation privative, et historiquement son alpha et son oméga. Quant à l’appropriation privative, on peut la définir comme l’appropriation des choses par l’appropriation des êtres, la lutte contre l’aliénation naturelle donnant naissance à l’aliénation sociale.
L’appropriation privative implique une ORGANISATION DE L’APPARENCE où soient dissimulées les contradictions radicales : il faut que les serviteurs se reconnaissent comme des reflets dégradés du maître, renforçant ainsi, au-delà du miroir d’une illusoire liberté, ce qui accroît leur soumission et leur passivité ; il faut que le maître s’identifie au serviteur mythique et parfait d’un dieu ou d’une transcendance qui n’est autre que la représentation sacrée et abstraite de la TOTALITÉ des êtres et des choses sur lesquels il exerce un pouvoir d’autant plus réel et d’autant moins contesté que s’accrédite universellement la vertu de son renoncement. Au sacrifice réel de l’exécutant répond le sacrifice mythique du dirigeant, l’un se nie dans l’autre, l’étrange devient familier et vice-versa, chacun se réalise en sens inverse. De l’aliénation commune naît l’harmonie, une harmonie négative dont la notion de sacrifice est l’unité fondamentale. Ce qui maintient l’harmonie objective (et pervertie), c’est le mythe, et ce terme a été employé pour désigner l’organisation de l’apparence dans les sociétés unitaires, c’est-à-dire dans les sociétés où le pouvoir esclavagiste, tribal ou féodal est officiellement coiffé par une autorité divine et où le sacré permet la mainmise du pouvoir sur la totalité.
Or, l’harmonie fondée initialement sur le « DON de soi » englobe une forme de rapport qui va se développer, devenir autonome et la détruire. Ce rapport s’appuie sur l’ÉCHANGE parcellaire (marchandise, argent, produit, force de travail…), l’échange d’une parcelle de soi qui fonde la notion de liberté bourgeoise. Il naît à mesure que le commerce et la technique deviennent prépondérants à l’intérieur des économies de type agraire.
Avec la prise du pouvoir par la bourgeoisie, l’unité du pouvoir disparaît. L’appropriation privative sacrée se laïcise dans les mécanismes capitalistes. Libérée de la mainmise du pouvoir, la totalité est redevenue concrète, immédiate. L’ère parcellaire n’est qu’une suite d’efforts pour reconquérir une unité inaccessible, ressusciter un ersatz de sacré pour y abriter le pouvoir.
Un moment révolutionnaire, c’est quand « tout ce que la réalité présente » trouve sa REPRÉSENTATION immédiate. Tout le reste du temps, le pouvoir hiérarchisé, de plus en plus éloigné de son apparat magique et mystique, s’emploie à faire oublier que la totalité (qui n’était autre que la réalité !) le dénonce comme imposteur.
14 EN ATTAQUANT de front l’organisation mythique de l’apparence, les révolutions bourgeoises s’en prenaient, bien malgré elles, au point névralgique, non seulement du pouvoir unitaire, mais surtout du pouvoir hiérarchisé sous quelque forme que ce soit. Cette erreur inévitable expliquerait-elle le complexe de culpabilité qui est un des traits dominants de l’esprit bourgeois ? Ce qui est hors de doute, c’est qu’il s’agit bien d’une erreur inévitable.
Erreur d’abord parce qu’une fois brisée l’opacité mensongère dissimulant l’appropriation privative, le mythe éclate et laisse un vide que seule une liberté délirante et la grande poésie viennent combler. Certes, la poésie orgiaque n’a pas jusqu’à ce jour abattu le pouvoir. Elle n’y a pas réussi pour des raisons aisément explicables, et ses signes ambigus dénoncent les coups portés en même temps qu’ils cicatrisent les plaies. Et poutant — laissons à leurs collections les historiens et les esthètes — il suffit de gratter la croûte du souvenir pour que les cris, les mots, les gestes anciens fassent à nouveau saigner le pouvoir sur toute son étendue. Toute l’organisation de la survie des souvenirs n’empêchera pas l’oubli de les effacer à mesure que, devenus vivants, ils commenceront à se dissoudre ; au même titre que notre survie dans la construction de notre vie quotidienne.
Processus inévitable : comme l’a montré Marx, l’apparition de la valeur d’échange, et sa substitution symbolique par la monnaie, ouvrent une crise latente et profonde au sein du monde unitaire. La marchandise introduit dans les relations humaines un caractère universel (un billet de 1.000 francs représente tout ce que je peux acquérir pour cette somme) et un caractère égalitaire (il y a échange de choses égales). Cette « universalité égalitaire » échappe en partie à l’exploitant comme à l’exploité mais l’un et l’autre s’y reconnaissent. Ils se retrouvent face à face, confrontés non plus dans le mystère de la naissance et de l’ascendance divine, comme c’était le cas pour la noblesse, mais dans une transcendance intelligible, qui est le Logos, un ensemble de lois compréhensibles pour tous, même si pareille compréhension reste englobée par le mystère. Un mystère qui a ses initiés, les prêtres d’abord, s’efforçant de maintenir le Logos dans les limbes de la mystique divine, pour céder bientôt aux philosophes, aux techniciens ensuite, la place tout autant que la dignité de leur mission sacrée. De la République platonicienne à l’État cybernéticien.
Ainsi, sous la pression de la valeur d’échange et de la technique (que l’on pourrait appeler la « médiation à portée de la main »), le mythe se laïcise lentement. Cependant, deux faits sont à noter :
a) Le Logos se dégageant de l’unité mystique s’affirme à la fois en elle et contre elle. Aux structures comportementales magiques et analogiques se surimpressionnent des structures comportementales rationnelles et logiques, qui les nient et les conservent (mathématique, poétique, économie, esthétique, psychologie, etc.) ;
b) Chaque fois que le Logos ou « organisation de l’apparence intelligible » gagne en autonomie, il tend à se couper du sacré et à se parcellariser. De telle sorte qu’il présente un double danger pour le pouvoir unitaire. On sait déjà que le sacré exprime la mainmise du pouvoir sur la totalité, et que quiconque veut accéder à la totalité doit passer par l’intermédiaire du pouvoir : l’interdit qui frappe les mystiques, les alchimistes, les gnostiques le prouve suffisamment. Ceci explique aussi pourquoi le pouvoir actuel « protège » les spécialistes en qui il reconnaît confusément les missionnaires d’un Logos resacralisé, sans leur accorder pleine confiance. Des signes existent historiquement qui attestent des efforts accomplis pour fonder dans le pouvoir unitaire mystique un pouvoir rival revendiquant son unité du Logos : tels apparaissent le syncrétisme chrétien, qui rend Dieu explicable psychologiquement, le mouvement de la Renaissance, la Réforme et l’Aufklärung.
En s’efforçant de maintenir l’unité du Logos, tous les maîtres avaient pleine conscience de ce que l’unité seule fait le pouvoir stable. Si l’on y regarde de plus près, leurs efforts n’ont pas été aussi vains que semble le prouver la parcellarisation du Logos aux XIXe et XXe siècles. Dans le mouvement général d’atomisation, le Logos s’est effrité en techniques spécialisées (physique, biologie, sociologie, papyrologie, j’en passe), mais le retour à la totalité s’impose simultanément avec plus de force. Qu’on ne l’oublie pas, il suffirait d’un pouvoir technocratiquement tout-puissant pour que soit mise en œuvre la planification de la totalité, pour que le Logos succède au mythe en tant que mainmise du pouvoir unitaire futur (cybernétique) sur la totalité. Dans une telle perspective, le rêve des Encyclopédistes (progrès indéfini étroitement rationalisé) n’aurait connu qu’un atermoiement de deux siècles avant de se réaliser. C’est dans ce sens que les stalino-cybernéticiens préparent l’avenir. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre que la coexistence pacifique amorce une unité totalitaire. Il est temps que chacun prenne conscience qu’il y résiste déjà.
15 Le champ de bataille est connu. Il s’agit de préparer le combat avant que ne soit dûment béni le coït politique du pataphysicien nanti de sa totalité sans technique et du cybernéticien avec sa technique sans totalité.
Du pont de vue du pouvoir hiérarchisé, désacraliser le mythe n’était admissible que si l’on resacralisait le Logos, ou tout au moins ses éléments désacralisants. S’attaquer au sacré, c’était du même coup — chanson connue — libérer la totalité, donc détruire le pouvoir. Or, le pouvoir de la bourgeoisie, émietté, pauvre, contesté sans cesse, garde un équilibre relatif en s’appuyant sur cette ambiguïté : la technique, qui désacralise objectivement, apparaît subjectivement comme un instrument de libération. Non pas une libération réelle, comme seule le permettrait la désacralisation, c’est-à-dire la fin du spectacle, mais une caricature, un ersatz, une hallucination provoquée. Ce que la vision unitaire du monde rejetait dans l’au-delà (l’image de l’élévation), le pouvoir parcellaire l’inscrit dans un mieux-être futur (l’image du projet) des lendemains qui chantent sur le fumier du présent, et qui ne sont que le présent multiplié par le nombre de gadgets à produire. Du slogan « vivez en Dieu » on est passé à la formule humaniste « survivez mieux » qui se dit « vivez jeune, vivez longtemps ».
Le mythe désacralisé et parcellarisé perd sa superbe et sa spiritualité. Il devient une forme pauvre, conservant ses caractéristiques anciennes mais les révélant de façon concrète, brutale, tangible. Dieu a cessé d’être metteur en scène et, en attendant que le Logos lui succède avec les armes de la technique et de la science, les fantômes de l’aliénation se matérialisent partout et sèment le désordre. Qu’on y prenne garde : ce sont là les prodromes d’un ordre futur. Dès maintenant, c’est à nous de jouer si nous voulons éviter que l’avenir soit placé sous le signe de la survie, ou même que la survie devenue impossible disparaisse radicalement (l’hypothèse d’un suicide de l’humanité). Et avec elle, évidemment, toute l’expérience de construction de la vie quotidienne. Les objectifs vitaux d’une lutte pour la construction de la vie quotidienne sont les points névralgiques de tout pouvoir hiérarchisé. Construire l’une, c’est détruire l’autre. Pris dans le tourbillon de la désacralisation et de la resacralisation, les éléments contre lesquels nous nous définissons en priorité restent : l’organisation de l’apparence en spectacle où chacun se nie ; la séparation qui fonde la vie privée, puisqu’elle est le lieu où la séparation objective entre possédants et dépossédés est vécue et répercutée sur tous les plans ; et le sacrifice. Les trois éléments sont solidaires, cela va de soi, comme leurs antagonismes d’ailleurs, participation, communication, réalisation. Il en va de même pour leur contexte : non-totalité (monde déficitaire, ou de totalité sous contrôle) et totalité.
16 Les rapports humains dissous jadis dans la transcendance divine (autrement dit : la totalité coiffée par le sacré), se sont décantés et solidifiés dès que le sacré a cessé d’agir comme catalyseur. Leur matérialité s’est révélée et, tandis que les lois capricieuses de l’économie succédaient à la providence, sous le pouvoir des dieux transparaissait le pouvoir des hommes. Au rôle alors mythique joué par chacun sous les sunlights divins répond aujourd’hui une multitude de rôles, dont les masques, pour être des visages humains, n’en continuent pas moins d’exiger de l’acteur — comme du figurant — qu’il nie sa vie réelle, selon la dialectique du sacrifice mythique et du sacrifice réel. Le spectacle n’est que le mythe désacralisé et parcellarisé. Il constitue la carapace d’un pouvoir (qu’on pourrait appeler aussi médiation essentielle) qui devient vulnérable à tous coups dès qu’il ne réussit plus à dissimuler, dans la cacophonie où tous les cris s’étouffent et s’harmonisent, sa nature d’appropriation privative. Et le malheur qu’elle distribue à tous à plus ou moins forte dose.
Dans le cadre d’un pouvoir parcellaire rongé par la désacralisation, les rôles s’appauvrissent, comme le spectacle marque un appauvrissement par rapport au mythe. Ils trahissent le mécanique et l’artifice avec tant de lourdeur que le pouvoir, pour parer à la dénonciation populaire du spectacle, n’a d’autre ressource que de prendre l’initiative de cette dénonciation avec plus de lourdeur encore, en changeant d’acteurs comme de ministères, ou en organisant des pogromes de metteurs en scène putatifs ou pré-fabriqués (agents de Moscou, de Wall Street, de la judéocratie, des deux cents familles). Cela signifie aussi que chaque acteur ou figurant de la vie a fait place malgré lui au cabotin, que le style s’est effacé devant la manière.
Le mythe, en tant que totalité immobile, englobait le mouvement (exemple du pélerinage, qui est accomplissement et aventure dans l’immobilité). D’une part, le spectacle ne saisit la totalité qu’en la réduisant à un fragment et à une suite de fragments (les Weltanschauung psychologique, sociologique, biologique, philologique, mythologique), de l’autre, il se situe au confluent du mouvement de désacralisation et des tentatives de resacralisation. Ainsi ne réussit-il à imposer l’immobilité qu’à l’intérieur du mouvement réel, du mouvement qui le change malgré sa résistance. Dans l’ère parcellaire, l’organisation de l’apparence fait du mouvement une succession linéaire d’instants immobiles (cette progression en crémaillère se trouve parfaitement illustrée par la diamat stalinienne). Dans le cadre de ce que nous avons appelé la « colonisation de la vie quotidienne », il n’y a d’autres changements que des changements de rôles fragmentaires. On est successivement, et selon des convenances plus ou moins impératives : citoyen, père de famille, partenaire amoureux, politicien, spécialiste, homme de métier, producteur, consommateur. Et cependant, quel gouvernant ne se sent gouverné ? À tous s’applique l’adage : baiseur parfois, baisé toujours !
L’époque parcellaire n’aura du moins permis aucun doute sur ce point : c’est la vie quotidienne qui est le champ de bataille où se livre le combat entre la totalité et le pouvoir, qui engage toute son énergie pour la contrôler.
Ce que nous revendiquons en exigeant le pouvoir de la vie quotidienne contre le pouvoir hiérarchisé, c’est tout. Nous nous situons dans le conflit généralisé qui va de la querelle domestique à la guerre révolutionnaire, et nous avons misé sur la volonté de vivre. Cela signifie que nous devons survivre comme anti-survivants. Nous nous intéressons fondamentalement aux moments de jaillissement de la vie à travers la glaciation de la survie (que ces moments soient inconscients ou théorisés, historiques — comme la révolution — ou personnels). Mais il faut se rendre à l’évidence, nous sommes aussi empêchés de suivre librement le cours de tels moments (excepté le moment de la révolution même), aussi bien que par la répression générale du pouvoir, par les nécessités de notre lutte, de notre tactique, etc. Il importe également de trouver le moyen de compenser ce « pourcentage d’erreur » supplémentaire, dans l’élargissement de ces moments et dans la mise en évidence de leur portée qualitative. Ce qui empêche ce que nous disons sur la construction de la vie quotidienne d’être récupéré par la culture et la sous-culture (Arguments, les penseurs questionnants avec congés payés), c’est précisément que chacune des idées situationnistes est le prolongement fidèle des gestes ébauchés à chaque instant et par des milliers de gens pour éviter qu’un jour ne soit vingt-quatre heures de vie gâchée. Sommes-nous une avant-garde ? Si oui, être d’avant-garde, c’est marcher au pas de la réalité.
17 Nous ne prétendons pas avoir le monopole de l’intelligence mais bien celui de son emploi. Notre position est stratégique, nous sommes au centre de tout conflit quel qu’il soit. Le qualitatif est notre force de frappe. Si quelqu’un jette cette revue à l’égoût parce qu’elle l’horripile, il fait un geste beaucoup plus riche que s’il la lit, la comprend à moitié et nous demande un mémoire ampliatif grâce auquel il puisse se prouver à lui-même qu’il est un homme intelligent et cultivé, c’est-à-dire un imbécile. Il faudra bien que l’on comprenne tôt ou tard que les mots et les phrases que nous employons retardent encore sur la réalité ; en d’autres termes, que la distorsion et la maladresse dans notre façon de nous exprimer (ce qu’un homme de goût appelle, non sans vérité, un « terrorisme hermétique assez agaçant ») tient à ce que, là aussi, nous sommes au centre, à la frontière confuse où se livre le combat infiniment complexe du langage séquestré par le pouvoir (conditionnement) et du langage libéré (poésie). À celui qui nous suit avec un pas de retard, nous préférons celui qui nous rejette par impatience, parce que notre langage n’est pas encore l’authentique poésie, c’est-à-dire la construction libre de la vie quotidienne.
Tout ce qui touche à la pensée touche au spectacle. La plupart des hommes vivent dans la terreur, savamment entretenue par le pouvoir, d’un réveil à eux-mêmes. Le conditionnement, qui est la poésie spéciale du pouvoir, pousse si loin son emprise (tout l’équipement matériel est là qui lui appartient : presse, TV, stéréotype, magie, tradition, économie, technique — ce que nous appelons le langage séquestré) qu’il parvient presque à dissoudre ce que Marx appelait secteur non-dominé, pour le remplacer par un autre (voir plus loin le portrait robot du « survivant »). Mais le vécu ne se laisse pas réduire si facilement à une succession de figurations vides. La résistance à l’organisation extérieure de la vie, c’est-à-dire à l’organisation de la vie comme survie, contient plus de poésie que ce qui s’est jamais publié de vers ou de prose, et le poète, au sens littéraire du terme, est celui qui a au moins compris ou ressenti cela. Mais pareille poésie est sous le coup d’une lourde menace. Certes, dans l’acception situationniste, cette poésie est irréductible et non récupérable par le pouvoir (dès qu’un geste est récupéré, il devient stéréotype, conditionnement, langage du pouvoir). Il n’empêche qu’elle se trouve encerclée par le pouvoir. C’est par l’isolement que le pouvoir encercle et tient l’irréductible ; et cependant l’isolement est inviable. Les deux becs de la tenaille sont, d’une part, la menace de désintégration (folie, maladie, clochardisation, suicide), de l’autre, les thérapeutiques télécommandées ; celles-là qui permettent la mort, celles-ci qui permettent la survie sans plus (communication vide, cohésion familiale ou amicale, psychanalyse au service de l’aliénation, soins médicaux, ergothérapie). L’I.S. devra se définir tôt ou tard comme thérapeutique : nous sommes prêts à protéger la poésie faite par tous contre la fausse poésie agencée par le pouvoir seul (conditionnement). Il importe que médecins et psychanalystes le comprennent aussi, sous peine de subir un jour, avec les architectes et les autres apôtres de la survie, les conséquences de leurs actes.
18 Tous les antagonismes non-résolus, non-dépassés, s’affaiblissent. Ces antagonismes ne peuvent évoluer qu’en restant prisonniers des formes anciennes non dépassées (par exemple l’art anti-culturel dans le spectacle culturel). Toute opposition radicale non-victorieuse ou partiellement victorieuse — ce qui est la même chose — s’étiole peu à peu en opposition réformiste. Les oppositions parcellaires sont comme les dents des roues dentées, elles s’épousent et font tourner la machine, du spectacle, du pouvoir.
Le mythe maintenait tous les antagonismes dans l’archétype du manichéisme. Où trouver l’archétype du manichéisme dans une société parcellaire ? En vérité, le souvenir des antagonismes anciens, saisis sous leur forme évidemment dévalorisée et non-agressive, apparaît aujourd’hui comme le dernier effort de cohérence dans l’organisation de l’apparence, tant le spectacle est devenu spectacle de la confusion et des équivalences. Nous sommes prêts à effacer toute trace de ces souvenirs en ramassant dans une lutte radicale proche toute l’énergie contenue dans les antagonismes anciens. De toutes les sources murées par le pouvoir peut jaillir un fleuve qui va modifier le relief du monde.
Caricature des antagonismes, le pouvoir presse chacun d’être pour ou contre B.B., le nouveau roman, la 4 chevaux Citroën, les spaghetti, le mescal, les jupes courtes, l’O.N.U., les humanités anciennes, la nationalisation, la guerre thermo-nucléaire et l’auto-stop. On demande à tous leur avis sur tous les détails pour mieux leur interdire d’en avoir un sur la totalité. La manœuvre, si lourde qu’elle soit, réussirait si les commis-voyageurs qui sont chargés de la présenter de porte à porte ne s’avisaient, eux aussi, de leur aliénation. À la passivité imposée aux masses dépossédées s’ajoute la passivité croissante des dirigeants et des acteurs soumis aux lois abstraites du marché et du spectacle, et jouissant d’un pouvoir de moins en moins effectif sur le monde. Déjà, les signes d’une révolte se manifestent chez les acteurs, vedettes qui essaient d’échapper à la publicité ou dirigeants qui critiquent leur propre pouvoir, B.B. ou Fidel Castro. Les instruments du pouvoir s’usent, il faut compter avec eux, dans la mesure où, d’instruments, ils revendiquent leur statut d’être libre.
19 À l’instant où la révolte des esclaves menaçait de bouleverser la structure du pouvoir, et de dévoiler ce qui unissait les transcendances au mécanisme d’appropriation privative, le christianisme s’est trouvé là pour développer un réformisme de grand style dont la revendication démocratique centrale consistait à faire accéder les esclaves, non à la réalité d’une vie humaine — ce qui eût été impossible sans dénoncer l’appropriation dans son mouvement d’exclusion — mais bien à l’irréalité d’une existence dont la source du bonheur est mythique (l’imitation de Jésus-Christ pour prix de l’au-delà). Qu’y a-t-il de changé ? L’attente de l’au-delà est devenue l’attente des lendemains qui chantent ; le sacrifice de la vie réelle, et immédiate, est le prix d’achat payé pour la liberté illusoire d’une vie apparente. Le spectacle est le lieu où le travail forcé se transforme en sacrifice consenti. Rien de plus suspect que la formule « à chacun selon son travail » dans un monde où le travail est le chantage à la survie ; sans parler de la formule « à chacun selon ses besoins » dans un monde où les besoins sont déterminés par le pouvoir. Entre dans le projet réformiste toute construction qui entend se définir de façon autonome, donc partielle, et ne tient pas compte de ce qu’elle est définie en fait par la négativité dans laquelle toute chose est en suspens. Elle prétend se poser sur les sables mouvants comme s’il s’agissait d’une piste de béton. Le mépris et la méconnaissance du contexte fixé par le pouvoir hiérarchisé n’aboutit qu’à renforcer ce contexte. Par contre, les gestes spontanés que nous voyons partout s’esquisser contre le pouvoir et son spectacle doivent être avertis de tous les obstacles et trouver une tactique tenant compte de la force de l’adversaire et de ses moyens de récupération. Cette tactique que nous allons populariser, c’est le détournement.
20 Le sacrifice ne se conçoit pas sans récompense. En échange de leur sacrifice réel, les travailleurs reçoivent les instruments de leur libération (confort, gadgets) mais c’est là une libération purement fictive puisque le pouvoir détient le mode d’emploi de tout l’équipement matériel ; puisque le pouvoir utilise à ses propres fins et les instruments et ceux qui en usent. Les révolutions chrétienne et bourgeoise ont démocratisé le sacrifice mythique ou « sacrifice du maître ». Aujourd’hui, les initiés sont légion, qui recueillent des miettes de pouvoir en mettant au service de tous la totalité de leur savoir partiel. On ne les nomme plus « initiés », on ne les nomme pas encore « prêtres du Logos », mais spécialistes, sans plus.
Au niveau du spectacle, leur pouvoir est incontestable : le candidat au « Quitte ou double » et l’employé aux P. et T., détaillant à longueur de journée les raffinements mécaniques de sa 2 CV, s’identifient l’un et l’autre au spécialiste, et l’on sait le parti que les chefs de production tirent de pareilles identifications pour domestiquer les O.S. La véritable mission des technocrates consisterait surtout à unifier le Logos si, par une des contradictions du pouvoir parcellaire, ils ne restaient cantonnés dans un isolement dérisoire. Aliénés qu’ils sont par leurs mutuelles interférences, ils connaissent le tout d’une parcelle et toute réalisation leur échappe. Quel contrôle réel le technicien atomiste, le stratège, le spécialiste politique, etc., peuvent-ils exercer sur une arme nucléaire ? Quel contrôle absolu le pouvoir peut-il espérer imposer à tous les gestes qui s’ébauchent contre lui ? Les acteurs sont si nombreux à paraître sur scène que seul le chaos règne en maître. « L’ordre règne et ne gouverne pas » (Notes éditoriales d’I.S. 6).
Dans la mesure où le spécialiste participe à l’élaboration des instruments qui conditionnent et transforment le monde, il amorce la révolte des privilégiés. Jusqu’à présent, pareille révolte s’est appelée fascisme. C’est essentiellement une révolte d’opéra — Nietzsche n’avait-il pas vu en Wagner un précurseur ? — où les acteurs, longtemps tenus à l’écart ou s’estimant de moins en moins libres, revendiquent soudain les premiers rôles. Cliniquement parlant, le fascisme est l’hystérie du monde spectaculaire, poussée au paroxysme. C’est dans ce paroxysme que le spectacle assure momentanément son unité, tout en dévoilant, par la même occasion, son inhumanité radicale. À travers le fascisme et le stalinisme, qui constituent ses crises romantiques, le spectacle révèle sa vraie nature : il est une maladie.
Nous sommes intoxiqués par le spectacle. Or, tous les éléments conduisant à une cure de désintoxication (traduisez : à construire nous-mêmes notre vie quotidienne) sont aux mains des spécialistes. Ceux-ci nous intéressent donc tous au plus haut point, à des titres différents toutefois. Ainsi, il y a des cas désespérés : nous n’essaierons pas de montrer aux spécialistes du pouvoir, aux dirigeants, l’étendue de leur délire. Par contre, nous sommes prêts à tenir compte de la rancœur des spécialistes prisonniers d’un rôle étroit, ridicule ou infâmant. On admettra néanmoins que notre indulgence ne soit pas sans limite. Si, malgré nos efforts, ils s’obstinent, en fabriquant le conditionnement qui colonise leur propre vie quotidienne, à mettre leur mauvaise conscience et leur amertume au service du pouvoir ; s’ils préfèrent à la réalisation vraie une représentation illusoire dans la hiérarchie ; s’ils brandissent avec ostentation leur spécialité (leur peinture, leurs romans, leurs équations, leur sociométrie, leur psychanalyse, leurs connaissances en balistique) ; enfin si, sachant bien — et sous peu, ils seront censés ne plus l’ignorer — que la spécialisation qui est leur, seuls l’I.S. et le pouvoir en possèdent le mode d’emploi, ils choisissent tout de même de servir le pouvoir, parce que le pouvoir, fort de leur inertie, les a, jusqu’à présent, choisis pour le servir, alors qu’ils crèvent ! On ne saurait se montrer plus généreux. Puissent-ils le comprendre et puissent-ils comprendre par-dessus tout que, désormais, la révolte des acteurs non-dirigeants est liée à la révolte contre le spectacle (voir l’I.S. et le pouvoir).
21 L’anathème généralisé jeté sur le lumpenprolétariat tient à l’usage qu’en faisait la bourgeoisie, à qui il fournissait, en plus d’un régulateur pour le pouvoir, les forces douteuses de l’ordre : flics, mouchards, hommes de mains, artistes… Cependant, la critique de la société du travail y est latente à un degré de radicalisme remarquable. Le mépris qu’on y professe pour les larbins et les patrons contient une critique valable du travail comme aliénation, critique qui n’a pas été prise en considération jusqu’à présent, parce que le lumpenprolétariat était le lieu des ambiguïtés, mais aussi parce que la lutte contre l’aliénation naturelle, et la production du bien-être, apparaissent encore au XIXe et au début du XXe siècle comme des prétextes valables.
Une fois connu que l’abondance de biens de consommation n’était que l’autre face de l’aliénation dans la production, le lumpenprolétariat acquiert une dimension nouvelle : il libère son mépris du travail organisé qui prend peu à peu, à l’âge du Welfare State, le poids d’une revendication que seuls les dirigeants refusent encore d’admettre. Malgré les tentatives de récupération dont l’accable le pouvoir, toute expérience effectuée sur la vie quotidienne, c’est-à-dire pour la construire (démarche illégale depuis la destruction du pouvoir féodal, où elle s’était trouvée limitée et réservée à quelques-uns) se concrétise actuellement par la critique du travail aliénant et le refus de se soumettre au travail forcé. Si bien que le prolétariat nouveau tend à se définir négativement comme un « Front contre le travail forcé » dans lequel se trouvent réunis tous ceux qui résistent à la récupération par le pouvoir. C’est là ce qui définit notre champ d’action, le lieu où nous jouons la ruse de l’histoire contre la ruse du pouvoir, le ring où nous misons sur le travailleur (métallo ou artiste) qui – conscient ou non – refuse le travail et la vie organisés, et contre celui qui – conscient ou non – accepte de travailler aux ordres du pouvoir. Dans cette perspective, il n’est pas arbitraire de prévoir une période transitoire où l’automation et la volonté du nouveau prolétariat abandonneront le travail aux seuls spécialistes, réduisant managers et bureaucrates au rang d’esclaves momentanés. Dans une automation généralisée, les « ouvriers », au lieu de surveiller les machines, pourraient entourer de leur sollicitude les spécialistes cybernéticiens réduits au simple rôle d’accroître une production qui aura cessé d’être le secteur prioritaire pour obéir, par un renversement de force et de perspective, à la primauté de la vie sur la survie.
22 Le pouvoir unitaire s’efforçait de dissoudre l’existence individuelle dans une conscience collective, en sorte que chaque unité sociale se définît subjectivement comme une particule de poids bien déterminé en suspens dans un liquide huileux. Il fallait que chacun se sentît plongé dans cette évidence que seule la main de Dieu, secouant le récipient, usait du tout pour ses desseins qui, dépassant naturellement la compréhension de chaque être humain particulier, s’imposaient comme émanations d’une volonté suprême et donnaient son sens au moindre changement. (Tout remous n’était d’ailleurs qu’une voie ascendante et descendante vers l’harmonie : les Quatre Règnes, la Roue de la Fortune, les épreuves envoyées par les dieux.) On peut parler d’une conscience collective en ce sens qu’elle est à la fois pour chaque individu et pour tous : conscience du mythe et conscience de l’existence-particulière-dans-le-mythe. La force de l’illusion est telle que la vie authentiquement vécue puise sa signification dans ce qui n’est pas elle ; de là cette condamnation cléricale de la vie, réduite à la pure contingence, à la matérialité sordide, à la vaine apparence et à l’état le plus bas d’une transcendance qui se dégrade à mesure qu’elle échappe à l’organisation mythique.
Dieu se portait garant de l’espace et du temps, dont les coordonnées définissaient la société unitaire. Il était le point de référence commun à tous les hommes ; en lui l’espace et le temps se réunissaient, comme en lui les êtres s’unissaient à leur destin. Dans l’ère parcellaire, l’homme reste écartelé entre un temps et un espace qu’aucune transcendance ne vient unifier par la médiation d’un pouvoir centralisé. Nous vivons dans un espace-temps dissocié. privé de tout point de référence et de toute coordonnée, comme si nous ne devions jamais entrer en contact avec nous-mêmes, bien que tout nous y convie.
Il y a un lieu où l’on se fait et un temps où l’on se joue. L’espace de la vie quotidienne, où l’on se réalise réellement, est encerclé par tous les conditionnements. L’espace étroit de notre réalisation effective nous définit, et cependant nous nous définissons dans le temps du spectacle. Ou encore : notre conscience n’est plus conscience du mythe et de l’être-particulier-dans-le-mythe, mais bien conscience du spectacle et conscience du rôle-particulier-dans-le-spectacle (j’ai signalé plus haut les liens de toute ontologie avec un pouvoir unitaire, on pourrait rappeler ici que la crise de l’ontologie apparaît avec la tendance parcellaire). Ou, pour l’exprimer en d’autres termes encore : dans la relation espace-temps, où se situent tout être et toute chose, le temps est devenu l’imaginaire (le champ des identifications) ; l’espace nous définit, bien que nous nous définissions dans l’imaginaire et bien que l’imaginaire nous définisse en tant que subjectivité.
Notre liberté est celle d’une temporalité abstraite où nous sommes nommés dans le langage du pouvoir (ces noms, ce sont les rôles qui nous sont assignés) avec un choix qui nous est laissé de nous trouver des synonymes officiellement reconnus comme tels. Par contre, l’espace de notre réalisation authentique (l’espace de notre vie quotidienne) est sous l’empire du silence. Il n’y a pas de nom pour nommer l’espace du vécu, sinon dans la poésie, dans le langage qui se libère de la domination du pouvoir.
23 En désacralisant et en parcellarisant le mythe, la bourgeoisie a mis au premier chef de ses revendications l’indépendance de la conscience (cf. les revendications de liberté de pensée, liberté de presse, liberté de recherche, le refus des dogmes). La conscience cesse donc d’être plus ou moins conscience-reflet du mythe. Elle devient conscience des rôles successifs tenus dans le spectacle. Ce que la bourgeoisie a exigé par-dessus tout, c’est la liberté des acteurs et des figurants dans un spectacle organisé, non plus par Dieu, ses flics et ses prêtres, mais par les lois naturelles et économiques, « lois capricieuses et inexorables » au service desquelles nous trouvons encore une fois des flics et des spécialistes.
Dieu a été arraché comme un bandage inutile et la plaie est restée béante. Certes, le bandage empêchait la plaie de se cicatriser mais il justifiait la souffrance, il lui donnait un sens qui valait bien quelques doses de morphine. Maintenant la souffrance ne se justifie plus et la morphine coûte cher. La séparation est devenue concrète. N’importe qui peut y mettre le doigt et, en fait de remède, tout ce que la société cybernéticienne trouve à nous proposer, c’est de devenir spectateurs de la gangrène et du pourrissement, spectateurs de la survie.
Le drame de la conscience dont parle Hegel est bien davantage la conscience du drame. Le Romantisme résonne comme le cri de l’âme arrachée au corps, une souffrance d’autant plus aiguë que chacun se retrouve isolé pour affronter la chute de la totalité sacrée et de toutes les maisons Usher.
24 La totalité, c’est la réalité objective dans le mouvement de laquelle la subjectivité ne peut s’insérer que sous forme de réalisation. Tout ce qui n’est pas réalisation de la vie quotidienne rejoint le spectacle où la survie est congelée (l’hibernation) et débitée en tranches. Il n’y a de réalisation authentique que dans la réalité objective, dans la totalité. Tout le reste est caricature. La réalisation objective qui s’opère dans le mécanisme du spectacle n’est qu’une réussite d’objets manipulés par le pouvoir (c’est la « réalisation objective dans la subjectivité » des artistes connus, des vedettes, des personnages du Who’s who). Au niveau de l’organisation de l’apparence, tout succès — et de même tout échec — est gonflé jusqu’à devenir stéréotype, et vulgarisé par l’information comme s’il s’agissait de la seule réussite ou du seul échec possibles. Jusqu’à présent, le pouvoir s’est trouvé seul juge, bien que son jugement soit soumis à des pressions. Ses critères sont seuls valables pour ceux qui acceptent le spectacle et se contentent d’y tenir un rôle. Sur cette scène-là, il n’y a plus d’artistes, il n’y a que des figurants.
25 L’espace-temps de la vie privée s’harmonisait dans l’espace-temps du mythe. À cette harmonie pervertie répond l’harmonie universelle de Fourier. Des l’instant où le mythe cesse d’englober l’individuel et le partiel dans une totalité dominée par le sacré, chaque fragment s’érige en totalité. En fait, le fragment érigé en totalité, c’est le totalitaire. Dans l’espace-temps dissocié qui fait la vie privée, le temps, absolutisé sur le mode de la liberté abstraite, qui est celle du spectacle, consolide par sa dissociation même l’absolu spatial de la vie privée, son isolement, son étroitesse. Le mécanisme du spectacle aliénant déploie une force telle que la vie privée en arrive à être définie comme ce qui est privé de spectacle, le fait d’échapper aux catégories spectaculaires et aux rôles étant ressenti comme une privation supplémentaire, comme un malaise dont le pouvoir tire prétexte pour réduire la vie quotidienne à des gestes sans importance (s’asseoir, se laver, ouvrir une porte).
26 Le spectacle qui impose ses normes au vécu prend sa source dans le vécu. Le temps du spectacle, vécu sous forme de rôles successifs, fait de l’espace du vécu authentique le lieu de l’impuissance objective alors que, simultanément, l’impuissance objective, celle qui tient au conditionnement de l’appropriation privative, fait du spectacle l’absolu de la liberté virtuelle.
Les éléments nés dans le vécu ne sont reconnus qu’au niveau du spectacle, où ils s’expriment sous forme de stéréotypes, cependant que pareille expression est à chaque instant contestée et démentie dans le vécu et par le vécu authentique. Le portrait-robot des survivants — que Nietzsche appelait les « petits » ou les « derniers hommes » — ne peut se concevoir que dans la dialectique du possible-impossible comprise comme suit :
a) le possible au niveau du spectacle (la variété des rôles abstraits) renforce l’impossible au niveau du vécu authentique ;
b) l’impossible (c’est-à-dire les limites imposées au vécu réel par l’appropriation privative) détermine le champ des possibles abstraits.
La survie est à deux dimensions. Contre une telle réduction, quelles sont les forces qui peuvent mettre l’accent sur ce qui constitue le problème quotidien de tous les êtres humains : la dialectique de la survie et de la vie ? Ou bien les forces précises sur lesquelles l’I.S. a misé rendront possible le dépassement de ces contraires, et réuniront l’espace et le temps dans la construction de la vie quotidienne ; ou bien vie et survie vont se scléroser dans un antagonisme atténué jusqu’à l’ultime confusion et l’ultime pauvreté.
27 La réalité vécue est parcellarisée et étiquetée spectaculairement en catégories, qu’elles soient biologiques, sociologiques ou autres, qui relèvent du communicable mais ne communiquent jamais que des faits vidés de leur contenu authentiquement vécu. C’est en quoi le pouvoir hiérarchisé, qui emprisonne chacun dans le mécanisme objectif de l’appropriation privative (admission-exclusion, voir paragraphe 3), est aussi dictature sur la subjectivité. C’est en tant que dictateur sur la subjectivité qu’il contraint, avec des chances limitées de succès, chaque subjectivité individuelle à s’objectiver, c’est-à-dire à devenir un objet qu’il manipule. Il y a là une dialectique extrêmement intéressante, qu’il conviendrait d’analyser de plus près (cf. la réalisation objective dans la subjectivité — qui est celle du pouvoir — et la réalisation objective dans l’objectivité — qui entre dans la praxis de construction de la vie quotidienne et de destruction du pouvoir).
Or les faits sont privés de contenu au nom du communicable, au nom dune universalité abstraite, au nom d’une harmonie pervertie où chacun se réalise en sens inverse. Dans une telle perspective, l’I.S. se situe dans la ligne de contestation qui passe par Sade, Fourier, Lewis Caroll, Lautréamont, le surréalisme, le lettrisme — du moins dans ses courants les moins connus, qui furent les plus extrêmes.
Dans un fragment érigé en totalité, chaque parcelle est elle-même totalitaire. L’individualisme a traité la sensibilité, le désir, la volonté, l’intelligence, le bon goût, le subconscient et toutes les catégories du moi, comme des absolus. La sociologie vient enrichir aujourd’hui les catégories psychologiques mais la variété introduite dans les rôles ne fait qu’accentuer davantage encore la monotonie du réflexe d’identification. La liberté du « survivant » sera d’assumer le constituant abstrait auquel il aura « choisi » de se réduire. Une fois écartée toute réalisation réelle, il ne reste qu’une dramaturgie psychosociologique où l’intériorité sert de trop-plein pour évacuer les dépouilles dont on s’est revêtu dans l’exhibition quotidienne. La survie devient le stade le plus achevé de la vie organisée sur le mode du souvenir reproduit mécaniquement.
28 Jusqu’à présent, l’approche de la totalité a été falsifiée. Le pouvoir s’intercale parasitairement comme une médiation indispensable entre les hommes et la nature. Or, seule la praxis fonde le rapport entre les hommes et la nature. C’est elle qui brise sans arrêt la couche de mensonge dont le mythe et ses succédanés tentent d’exprimer la cohérence. La praxis, même aliénée, est ce qui maintient le contact avec la totalité. En révélant son caractère fragmentaire, la praxis révèle du même coup la totalité réelle (la réalité), elle est la totalité qui se réalise à travers son contraire, le fragment.
Dans la perspective de la praxis, tout fragment est totalité. Dans la perspective du pouvoir, qui aliène la praxis, tout fragment est totalitaire. Ceci doit suffire pour torpiller les efforts que le pouvoir cybernéticien va déployer pour englober la praxis dans une mystique, encore qu’il ne faille pas sous-estimer le sérieux de ces efforts.
Tout ce qui est praxis entre dans notre projet, il y entre avec sa part d’aliénation, avec les impuretés du pouvoir : mais nous sommes à même de filtrer. Nous mettrons en lumière la force et la pureté des gestes de refus aussi bien que des manœuvres d’assujettissement, non dans une vision manichéenne, mais en faisant évoluer, par notre propre stratégie, ce combat où, partout, à chaque instant, les adversaires cherchent le contact et se heurtent sans méthode, dans une nuit et une incertitude sans remède.
29 La vie quotidienne a toujours été vidée au profit de la vie apparente, mais l’apparence, dans sa cohésion mythique, avait suffisamment de force pour que jamais il ne soit parlé de vie quotidienne. La pauvreté, le vide du spectacle, qui transparaît à travers toutes les variétés de capitalisme et toutes les variétés bourgeoises, a révélé à la fois l’existence d’une vie quotidienne (une vie refuge mais refuge de quoi et contre quoi ?) et la pauvreté de la vie quotidienne. À mesure que se renforcent la réiflcation et la bureaucratisation, le caractère débile du spectacle et de la vie quotidienne devient la seule évidence. Le conflit de l’humain et de l’inhumain est passé lui aussi sur le plan de l’apparence. Dès l’instant où le marxisme devient une idéologie, la lutte que Marx poursuit contre l’idéologie au nom de la richesse de la vie se transforme en une anti-idéologie idéologique, un spectacle de l’anti-spectacle (de même que, dans la culture d’avant-garde, le malheur du spectacle anti-spectaculaire est de rester entre les seuls acteurs, l’art anti-artistique n’étant fait et compris que par des artistes ; il faut considérer les rapports de cette anti-idéologie idéologique avec la fonction du révolutionnaire professionnel dans le léninisme). Ainsi, le manichéisme s’est-il trouvé revivifié pour un temps. Pourquoi Saint-Augustin combat-il les manichéens avec tant d’âpreté ? C’est qu’il a mesuré le danger d’un mythe qui n’offre qu’une solution, la victoire du bon sur le mauvais ; il sait qu’une pareille impossibilité risque de provoquer l’effondrement des structures mythiques tout entières et de remettre au premier plan la contradiction entre vie mythique et vie authentique. Le christianisme offre la troisième voie, celle de la confusion sacrée. Ce que le christianisme a accompli par la force du mythe, s’accomplit aujourd’hui par la force des choses. Il n’y a plus d’antagonisme possible entre les travailleurs soviétisés et les travailleurs capitalisés, il n’y a plus d’antagonisme possible entre la bombe des bureaucrates staliniens et celle des bureaucrates non-staliniens, il n’y a plus qu’une unité dans la confusion des êtres réifiés.
Où sont les responsables, les hommes à abattre ? C’est un système qui nous domine, une forme abstraite. Les degrés d’humanité et de non-humanité se mesurent selon des variations purement quantitatives de passivité. La qualité est partout la même : nous sommes tous prolétarisés ou en passe de l’être. Que font les « révolutionnaires » traditionnels ? Ils réduisent les paliers, ils font en sorte que certains prolétaires ne le soient pas plus que d’autres. Quel parti a mis à son programme la fin du prolétariat ?
La perspective de survie est devenue insupportable. Ce que nous subissons, c’est le poids des choses dans le vide. C’est cela, la réiflcation : chaque être et chaque chose tombant d’une égale vitesse, chaque être et chaque chose portant sa valeur égale comme une tare. Le règne des équivalences a réalisé le projet chrétien, mais il l’a réalisé en dehors du christianisme (comme Pascal le supposait) et surtout, il l’a réalisé sur le cadavre de Dieu contrairement aux prévisions pascaliennes.
Spectacle et vie quotidienne coexistent dans le règne des équivalences. Les êtres et les choses sont interchangeables. Le monde de la réiflcation est le monde privé de centre, comme les villes nouvelles, qui en sont le décor. Le présent s’efface devant la promesse d’un futur perpétuel qui n’est que l’extension mécanique du passé. La temporalité elle-même est privée de centre. Dans cet univers concentrationnaire où victimes et tortionnaires portent le même masque, la réalité des tortures est seule authentique. Ces tortures, aucune idéologie nouvelle ne peut les alléger, ni celle de la totalité (Logos), ni celle du nihilisme, qui seront les béquilles de la société cybernéticienne. Elles condamnent tout pouvoir hiérarchisé ; si dissimulé et si organisé soit-il. L’antagonisme que l’I.S. va renouveler est le plus ancien qui soit, il est l’antagonisme radical et c’est pourquoi il reprend en charge tout ce que les mouvements insurrectionnels ou les grandes individualités ont abandonné au cours de l’histoire.
30 Il y aurait beaucoup d’autres banalités à reprendre et à retourner. Les meilleures choses n’ont jamais de fin. Avant de relire ce qui précède, et qu’un esprit médiocre peut comprendre à la troisième tentative, il est bon de consacrer au texte suivant une attention d’autant plus soutenue que ces notes fragmentaires comme les autres, appellent des discussions et des mises au point. Il s’agit d’une question centrale : l’I.S. et le pouvoir révolutionnaire.
L’I.S., considérant conjointement la crise des partis de masse et la crise des « élites », devra se définir comme dépassement du C.C. bolchévik (dépassement du parti de masse) et du projet nietzschéen (dépassement de l’intelligentsia).
a) Chaque fois qu’un pouvoir s’est présenté comme dirigeant d’une volonté révolutionnaire, il a sapé a priori le pouvoir de la révolution. Le C.C. bolchévik se définissait simultanément comme concentration et représentation. Concentration d’un pouvoir antagoniste au pouvoir bourgeois et représentation de la volonté des masses. Cette double caractéristique le déterminait à n’être bientôt plus qu’un pouvoir évidé, un pouvoir à représentation vide et, par suite, à rejoindre dans une forme commune (la bureaucratie) le pouvoir bourgeois, soumis sur sa pression à une évolution similaire. Virtuellement, les conditions d’un pouvoir concentré et d’une représentation de masse existent dans l’I.S. lorsqu’elle rappelle qu’elle détient le qualitatif et que ses idées sont dans la tête de tous. Cependant, nous refusons à la fois la concentration d’un pouvoir et le droit de représenter, conscients que nous prenons dès cet instant la seule attitude publique (car nous ne pouvons éviter de nous faire connaître, jusqu’à un certain point, sur le mode spectaculaire) qui puisse donner à ceux qui se découvrent sur nos positions théoriques et pratiques le pouvoir révolutionnaire, le pouvoir sans médiation, le pouvoir contenant l’action directe de tous. L’image-pilote serait la colonne Durutti passant de ville en village, liquidant les éléments bourgeois et laissant aux travailleurs le soin de s’organiser.
b) L’intelligentsia est la galerie des glaces du pouvoir. Contestant le pouvoir, elle n’offre jamais que des identifications cathartiques à la passivité de ceux dont chaque geste ébauche une contestation réelle. Le radicalisme — du geste, non de la théorie évidemment — que l’on a pu voir dans la déclaration « des 121 » a cependant montré quelques possibilités différentes. Nous sommes capables de précipiter cette crise mais nous ne pouvons le faire qu’en entrant comme pouvoir dans l’intelligentsia (et contre elle). Cette phase — qui doit précéder celle décrite dans le point a) et être englobée par elle — va nous placer dans la perspective du projet nietzschéen. Nous allons en effet constituer un petit groupe expérimental, quasi alchimique, où s’amorce la réalisation de l’homme total. Pareille entreprise n’est conçue par Nietzsche que dans le cadre du principe hiérarchique. Or c’est dans ce cadre que nous nous trouverons de fait. Il importera donc au plus haut point que nous nous présentions sans la moindre ambiguïté (au niveau du groupe, la purification du noyau et l’élimination des résidus semble maintenant accomplie). Nous n’acceptons le cadre hiérarchique dans lequel nous nous trouvons placés que dans l’impatience d’exterminer ceux que nous dominons, et que nous ne pouvons que dominer sur la base de nos critères de reconnaissance.
c) Sur le plan tactique, notre communication doit être un rayonnement au départ d’un centre plus ou moins occulte. Nous établirons des réseaux non matérialisés (rapports directs, épisodiques, contacts non contraignants, développement de rapports vagues de sympathie et de compréhension, à la manière des agitateurs rouges avant l’arrivée des armées révolutionnaires). Nous revendiquons comme nôtres, en les analysant, les gestes radicaux (actions, écrits, attitudes politiques, œuvres) et nous considérons nos gestes ou nos analyses comme revendiqués par le plus grand nombre.
De même que Dieu constituait le point de référence de la société unitaire passée, de même nous nous préparons à fournir à une société unitaire maintenant possible son point de référence central. Mais ce point ne saurait être fixe. Il représente, contre la confusion toujours répétée que la société cybernéticienne puise dans le passé de l’inhumanité, le jeu de tous les hommes, « l’ordre mouvant de l’avenir ».
RAOUL VANEIGEM
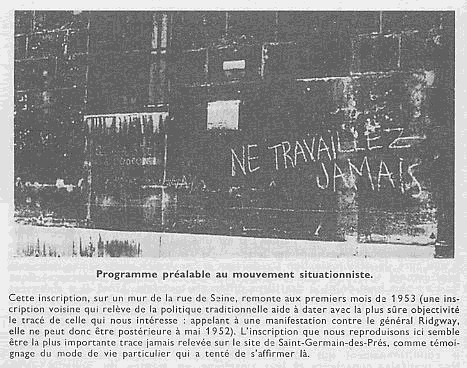
ù
YOU ARE in agreement with the S.l.!
You want to join the S.l.!We oniy ask of you a little preliminary work, to verify objectively (in your own interest as well as ours) how near you come to our problems, and your ability to play a full role in our undertaking (the S.l. does not want mère disciples):
1. Choose for yourself a point which you consider important, in the theses published by the S.l., and develop several arguments and possible expansions of thus theses (a minimum of one page of typescript — we impose no maximum).
2. Choose for yourself, in the same texts published by the S.l., a point which can be criticized, and destroy this position (the conditions are the same).
N.B.—This is not a meaningless game. The S.l. proceeds like this very often, to reexamine and advance on its own basic ideas. Perhaps you will chance on a point already criticized. But you might also start a correct criticism from a position insuficiently raised by us to now. Your criticism, therefore, if it is well done, will be well argued in any case; and perhaps even will be useful as putting forward something new!
* INTERNATIONALE SITUATIONNISTE
service des anti-public-relationsVOUS ÊTES d’accord avec l’I.S. !
Vous voulez adhérer à l’I.S. !Nous vous demandons seulement un petit travail préalable, pour contrôler objectivement (dans votre intérêt comme dans le nôtre), votre approche réelle de nos problèmes, et votre capacité de participation complète à notre entreprise (L’I.S. ne veut pas de disciples) :
1. Choisissez vous-même un point que vous considérez comme important, dans les thèses publiées par l’I.S., et développez quelques arguments et suites possibles. (Minimum : une page dactylographiée, aucun maximum imposé.)
2. Choisissez vous-même, dans les mêmes textes publiés par l’I.S., un point critiquable, et détruisez cette position (mêmes conditions).
N.B. — Ceci n’est pas un jeu arbitraire. L’I.S. procède couramment ainsi comme réexamen et dépassement de ses propres bases. Vous pouvez tomber sur un point déjà critiqué. Mais aussi bien commencer la juste critique d’une position insuffisamment remise en question par nous jusqu’ici. Votre critique donc, si elle est bien faite, sera en tout cas juste ; et peut-être même utile comme nouveauté !
ù
« La place me manque pour expliquer ici ce qu’est le situationnisme. Il suffit, pour l’instant, de savoir qu’il s’agit d’une démarche de la pensée contemporaine, au même titre que le surréalisme, le dadaïsme, l’existentialisme, etc. »
PIERRE PUTTEMANS, La Gauche, 12-10-62.
« Ce mouvement, appelé à révolutionner notre époque, est né en 1959 dans une cave de Schwabing… Leurs “idées” (?) ont fait des adeptes en dehors des frontières et des groupes situationnistes vont être créés bientôt à Paris, à Zurich, à Bruxelles et à Tel-Aviv. »
M. SCH., Germinal, 3-6-62.
« Leur activité principale est un dérangement mental qui monte en flèche… Dans le maximum de langues possibles, l’Internationale situationniste diffuse à partir de l’étranger des lettres bourrées des expressions les plus ordurières. À notre avis, la justice munichoise leur a fait trop d’honneur en les condamnant à la prison et à l’amende. »
Vernissage n° 9-10, mai-juin 1962.
« À l’étranger, (Debord) continue à vendre sa salade comme Bernard Buffet… »
Cahiers du Lettrisme n° 1, décembre 1962.
« Avec la même intransigeance, Trocchi suicide son talent… Il y a sans doute beaucoup d’hallucinations et de délires sur ce radeau de la Méduse où se cramponnent tous ces fils de Caïn ; mais si l’humanisme survit à la barbarie conditionnée ce sera peut-être grâce à eux… il y a quelque chose de pathétique et de respectable dans l’effort maladroit mais authentique des jeunes écrivains américains pour préserver malgré tout la vigilance surréaliste. »
JACQUES CABAU, L’Express, 7-6-62.
Ces citations, sélectionnées en vue d’un Oscar du Confusionnisme Fantastique, que l’I.S. décernera quelque jour, sont issues de contextes fort éloignés de tout humour volontaire.
ù
DANS le dernier chapitre de L’avant-garde culturelle parisienne depuis 1945 (éd. Guy Le Prat, 1962), Robert Estivals présente une interprétation des théories situationnistes à laquelle aucun de nous certainement ne peut adhérer, parce que la compréhension de la spécialisation sociologique, que l’auteur applique ici à un terrain où l’I.S. est effectivement observable, doit être elle-même jugée en se référant à l’ensemble de nos thèses, et ne peut être tenue pour un instrument de mesure extérieur et indépendant. Il y a visiblement entre Estivals et nous quelques oppositions de base, quant au maniement des concepts et quant à l’évaluation historique de la société globale. Cependant, à un tout autre niveau, nous nous bornerons ici à noter que, sur quarante-neuf citations qui prétendent rendre compte de la théorie situationniste, cinq seulement émanent de textes postérieurs à la formation de l’I.S., et encore aucune de celles-ci n’est-elle plus récente que le milieu de 1960. Ainsi, par cette valorisation systématique de la recherche des origines historiques d’un ensemble lui-même resté nébuleux, Estivals s’expose à mal comprendre cela même qu’il étudie, dont il serait plus sûr de chercher le sens véritable à la lumière du développement supérieur, plus complexe, qui en est issu. Du fait de cette insolite sélection des informations — et en laissant de côté nos divergences méthodologiques — il nous faut dire que, malgré les apparences, l’I.S. n’est pas le sujet du dernier chapitre du livre d’Estivals.
* Dans les conclusions de son livre Introduction à la modernité (Éditions de Minuit, 1962), Henri Lefebvre fait de l’I.S. quelques éloges hâtifs avec lesquels nous ne sommes pas d’accord. Premièrement, nous refusons d’être assimilés à la jeunesse. C’est une manière élégante de neutraliser les problèmes en leur donnant quelque chose de la force irrésistible des saisons ou de capricieuses mutations sociologiques dont il faut suivre le développement. Pour notre part, nous ne prétendons pas représenter l’avenir (ne représente un avenir calculable que le personnel jeune formé dans le but de gérer la suite d’un certain présent, par exemple une promotion de Saint-Cyr ou de l’école des cadres du parti communiste russe). Et nous n’entendons pas non plus nous contenter de ce droit abstrait sur le futur. La question est : par suite de quelles inintelligences, veuleries, prudences, petites amitiés, certaines recherches et affirmations présentes sont-elles fuies, cachées, remplacées par d’autres ? Et aussi : qui est complice de la médiocrité présente, qui s’y oppose, qui tente une conciliation ? — Celle-ci, au reste, étant d’autant plus vaine que sa réussite voudrait seulement dire qu’il faut attendre de voir venir d’ailleurs la réelle « jeunesse » de la contestation : comment pourrait-elle, en effet, se mêler aux organisateurs de la longue et malhonnête bêtise d’hier, qui tentent encore de se dédouaner par un vernis de modernisation ? « Le degré de l’opposition et de la réconciliation dont une époque est capable, est chose contingente », dit Hegel. Ce n’est pas ce degré qui serait en train de varier notablement dans les années [19]60, c’est le degré d’intelligence et de courage subjectifs qu’il faut pour ne pas épouser les fausses réconciliations, sans rien se dissimuler de la réalité de l’opposition. En cette matière, il n’y a pas de mûrissement des conditions objectives, il n’y a pas d’ultra-gauche. On peut trouver tout de suite ses adversaires, c’est-à-dire sa vérité.
Le deuxième point inacceptable illustre admirablement ce qui précède : c’est un parallèle entre l’I.S. et un groupe de jeunesse oppositionnelle du parti communiste, si clandestin qu’il n’aurait jamais rien fait ni rien publié. Ici nous avons le doigt sur la plaie. Cette belle jeunesse, à l’image de ses aînés, doute, se cherche, et ménage la chèvre et le chou. Voilà exactement comment on ne trouve rien, et comment on accepte la totalité de la boue du présent, avec l’impatience de la jeunesse, en effet, que le temps calmera. D’ailleurs, Lefebvre les oppose à nous en disant qu’eux n’ont pas désespéré de l’U.R.S.S. Nous non plus. L’avenir d’une société révolutionnaire en U.R.S.S. (et aussi, bien sûr, en Angleterre) paraît plus vite réalisable qu’en Mauritanie, quoi qu’en pensent peut-être les fanonistes. Mais ce groupe qui « se tait en attendant son heure » (à qui appartient-il donc de marquer notre heure dans l’histoire ?) serait moins bien caché dans le P.C.F. s’il avait un peu plus étudié la réalité « désespérante » du pouvoir actuel en Russie (et aussi, bien sûr, en Angleterre).
* Plusieurs personnes nous ont signalé récemment que des gens, qui ont quelque petit rôle culturel ici ou là, prétendent connaître ou avoir connu personnellement tel ou tel situationniste, et d’ailleurs mêlent l’éloge au blâme dans leurs « souvenirs » sur nous. Nous devons prévenir les lecteurs de cette revue que, le plus souvent, c’est faux. Et nous pouvons même suggérer un assez bon test pour détecter les imposteurs : ceux qui ont réellement eu affaire à nous n’en disent que du mal — exceptés quelques-uns qui nous ressemblaient — et même se portent facilement aux calomnies les plus excessives. Quel est donc le sens de ces faux souvenirs sur des contacts avec l’I.S. ? C’est simple. On ne nous rencontre pas facilement. Nous avons une idée assez favorable du dialogue pour commencer par sa base élémentaire : en refuser immédiatement les apparences à ceux avec qui il sera sûrement impossible. Nous ne mériterions d’être pris au sérieux par personne si nous nous étions mêlés aux politesses, discussions ou échanges minuscules du milieu artistique et culturel de ces dernières années (surtout de sa misérable fraction moderniste, celle qui est encore en train d’y assurer son trou). Ce milieu a normalement répondu à ce boycott de notre part en ignorant officiellement notre existence. Maintenant que l’I.S. est déjà un peu trop connue pour une affectation d’ignorance totale, et comme ces gens ont toujours aussi peu de chances de nous approcher, et aucune envie d’avouer ce détail, il est utile pour eux de prétendre l’avoir déjà fait. Donc se méfier des contrefaçons : tout le monde n’a quand même pas eu la chance de se faire exclure de l’I.S. !
* La publication de la revue de l’I.S. en langue allemande, retardée par de nombreuses difficultés, ne commencera que dans le premier trimestre de 1963. Son adresse est Der Deutsche Gedanke, PF 866, München 1, Allemagne. Le « dictionnaire de poche des concepts situationnistes », dont la parution avait été décidée par le C.C. en février 1962, subira pour sa part un retard encore plus lourd, mais sera probablement modifié dans le sens d’un agrandissement. L’adresse de la revue Situationistisk Revolution est : Kristinelyst, à Helsted-Randers, Danemark. La nouvelle adresse d’Internationale Situationniste est : B.P. 75-06, Paris. Pour les publications en néerlandais de l’I.S., on peut joindre Jan Strijbosch au café Tienpont, 2 Paardenmarkt à Anvers. Et pour l’Angleterre : Alexander Trocchi, 32 Heath Street, London N.W.3.
* Plusieurs textes situationnistes ont été reproduits par Notes Critiques, « bulletin de recherche et d’orientation révolutionnaires » (25, cours Pasteur, à Bordeaux) dans son troisième numéro. Ce numéro est, dans l’ensemble, en net progrès sur certaines des options débattues dans les précédents (les conceptions organisationnelles de Lefort, etc.). Un progrès décisif serait marqué par la publication plus autonome et cohérente des conceptions de cette équipe elle-même, qui fait encore la part trop belle aux tendances extérieures, dont certaines sont difficilement conciliables.
* Le fragile gang nashiste, dont les seules bases publiques étaient en Suède, mais qui essayait d’y instruire quelques émigrés pour les renvoyer ensuite soutenir le confusionnisme dans leur pays, s’est aggloméré et soutenu quelques temps à coups de mensonges, certains seulement ridicules, d’autres ignobles. Parmi ceux-ci relevons, dans la déclaration de Stockholm, en août, le reproche lancé à l’I.S. d’avoir affirmé sa solidarité avec les Allemands jugés à Munich « seulement après que le verdict ait été annoncé… geste sans signification, plutôt tard dans la journée », alors que notre intervention à l’audience avait même été rapportée par la presse scandinave ; et alors que ces nashistes « solidaires » au procès de certains exclus allemands au point de faire croire partout que Nash en personne était co-accusé, ont ensuite exercé le maximum de pressions en Scandinavie pour empêcher des gens de seulement parler du procès, réel celui-là, de Lausen, impliqué plus gravement dans le même délit de presse, parce que Lausen était encore dans l’I.S. Puis ces mensonges sont apparus si gros que les nashistes, qui aiment tant les journaux et la foule, se sont retrouvés isolés. Les nashistes ont fait le maximum pour compromettre autant de gens que possible en mélangeant leurs noms à leur action, et se sont attirés de cruels démentis publics. Ils ont éclaté en tous sens, les accords entre eux s’effritant et se reformant sur un rythme épuisant, et suivant des combinaisons purement probabilistes, selon les occasions du commerce. Et la porte qu’ils tenaient ouverte à n’importe qui en vertu de leur seul principe original (exclus, ils se sont découverts ennemis de l’exclusion), servait aussi l’instant d’après, pour les fuir en courant. Plusieurs de ces transfuges sont venus se présenter à l’I.S., qui a rejeté, sans aucune discussion ni exception possibles, ceux qui ont passé par le nashisme.
Finalement, dans la déroute, les nashistes ont été obligés de faire un éclat en sortant leurs propres idées, celles de l’I.S. devenant trop dangereusement connues, surtout après le nouveau style de conférence inauguré par J.V. Martin à la fin de novembre, à l’Université d’Aarhus. Ils ont abandonné même la référence de bluff à une « Deuxième Internationale Situationniste », dans la manifestation du dernier carré nashiste à Copenhague en décembre 1962. Et ces idées nashistes pures répandues par voie d’affiches se sont trouvées être — très au-delà du réformisme et d’une certaine tradition auxquels ils se ralliaient déjà en août — l’attaque contre les situations ludiques en faveur des rites cultuels ; plus la reprise de thèmes messianiques sur l’individu unique devenant Dieu, et toute la suite de cet air bien connu.
Ce premier nashisme — il y en aura d’autres ! — sort donc, sous forme de poussière, de sa tentative d’opposition spectaculaire contre l’I.S. On ne compte plus qu’un faible degré de retombées nashistes en Suède, en Hollande, et surtout en Allemagne où la revue du nashisme-idéaliste Unverbindliche Richtlinien mélange très discrètement des souvenirs situationnistes à son retour à la divagation eschatologique et à la « mystique des chefs ». Signalons, pour conclure, qu’à notre connaissance la durée moyenne d’un nashiste a été de onze semaines.
* À la suite des procès engagés contre les situationnistes à Munich, dont nous avons parlé dans I.S. 7, page 51, les quatre qui avaient entretemps été exclus de l’I.S., pour leur modération sur d’autres points, ont été condamnés le 4 mai, avec sursis, à cinq mois et demi de prison. En appel, vers la fin de l’année le jugement a été confirmé, mais en réduisant le temps de prison, toujours assorti du sursis. Cette deuxième instance avait d’ailleurs fourni l’occasion à deux d’entre eux, devenus crypto-nashistes, de publier le 4 novembre une déclaration malencontreuse. Cette déclaration, renversant les positions précédentes de leur défense en groupe — et de ceux qui se sont solidarisés avec eux — admet un des points de l’imbécile accusation selon laquelle ils seraient des pornographes ; et, se piquant au jeu, les auteurs affirment que c’est bien leur droit de l’être, en se référant à l’Arétin, Sade, Miller, Genêt et les classiques. Ce qui est d’autant plus consternant que même sans comparer si loin, il est patent qu’ils ne sont rigoureusement rien dans le genre en question.
Uwe Lausen, jugé le 5 juillet, est le seul a avoir été effectivement emprisonné trois semaines. L’I.S., après avoir protesté à l’audience du 4 mai, a diffusé deux tracts, le 25 juin à propos de l’ensemble de cette affaire, et le 16 juillet (Das Unbehagen in der Kultur) sur la condamnation de Lausen.
* Le lettrisme existe encore. Comme dernier événement, l’éternel Lemaître s’est dédoublé. De plus en plus semblable au héros de Chesterton, « le nommé Dimanche », il organise sa propre opposition, et discute âprement avec lui-même en deux petites feuilles ronéotypées où s’étalent des comptes de bouts de chandelles (lequel doit à l’autre 400 anciens francs pour son labeur de mise sous enveloppe de leurs œuvres et se fait encore tirer l’oreille, etc.) Il y a quand même de la place pour attaquer l’I.S., dont il suppute qu’elle a perdu un tiers exactement de son détestable programme, en abandonnant la méthode du détournement. Où a-t-il pris ses informations ? Mystère d’autant plus impénétrable que Lemaître reconnaît dans le même papier, d’un air pas content, que nous affectionnons toujours la dérive. Or, selon les formules de G. Keller : « Notre méthode exposée par l’image de l’appareil de Galton nous a permis de mettre en perspective le détournement comme un détail précis du processus général des dérives. Il ne s’agit pas en ce cas d’une réduction mais d’un dépassement, parce qu’il ne saurait y avoir de dérive qui n’implique pas de nombreux détournements. Le détournement est lui-même divisible selon deux positions qu’il faut distinguer dans le cours de la dérive, suivant que l’on rencontre une opposition passive ou active au mouvement : résistance ou réaction. Le détournement est l’effet nécessaire qu’impose un obstacle. Cet obstacle peut être psychique ou physique, mais le moment du détournement vainqueur est nécessairement celui d’une rencontre surprenante, étrange, déjà définie par Rimbaud. Dans le mouvement mental, le détournement est immédiatement le renversement d’une chaîne d’associations normales, par le déplacement complet du concept possible attaché à l’objet imposé (impossibilité d’identification précise) ; c’est ainsi que le détournement permet de lire des textes dont l’habitude dominante interdisait la compréhension élémentaire. Le champ de la dérive est un complexe, ou un réseau, de multiples détournements en action — qu’il s’agisse d’un poème, de Finnegan’s Wake, d’une ville, d’un paysage, d’une maison, d’un labyrinthe, etc. Une dérive n’est même pas possible sans un minimum de détournement de l’inertie, c’est-à-dire du mouvement en ligne droite. Ceci est tellement évident que la possibilité d’une dérive sans détournement est à considérer comme un éclatant non-sens, qui ne mérite certainement pas d’être discuté. »
* Pour la mort de Marilyn Monroë, Goldmann, dans France-Observateur du 6 septembre 1962, a écrit un article qui est bien meilleur que tout ce qu’il avait depuis quelque temps pris l’habitude de consacrer à la dissolution culturelle. Les notions qu’il avait avancées en 1961 comme simples hypothèses (voir la critique d’I.S. 7, page 52) sont maintenant données comme des certitudes établies, qui fondent sa démonstration. La thématique de l’absence et la destruction de l’objet dans l’art sont maintenant explicitement liées par lui au travail parcellaire et à la consommation des loisirs passifs. Il va jusqu’à suspendre l’apparition d’une autre culture à la domination libre par les hommes de l’emploi de leur travail, constituant seule une alternative avec une société réifiée des exécutants et du conditionnement confortable. Ainsi donc, que ceci soit le fruit d’une intensification du rythme de ses recherches ou d’un vide heureusement comblé dans ses lectures, nous le comprenons beaucoup mieux.
* Après les interdictions et arrestations qui lui ont paru nécessaires, Ben Bella, parlant au début de janvier au correspondant de l’agence Italia, a tiré argument d’un vote unanime de l’Assemblée Constituante algérienne, dont il a désigné lui-même tous les membres, pour conclure : « Il n’y a pas d’opposition en Algérie, ou pour le moins il n’y en a plus ». Comme personne quand même n’est assez idéologue pour croire que l’Algérie indépendante a réalisé par décrets-lois l’abolition des classes, l’abondance, l’autonomie des masses et la transparence des rapports humains, on est obligé de conclure que la révolution algérienne est glacée, pour longtemps peut-être.
Les masses révolutionnaires d’Algérie, qui ont tant combattu, ont gagné contre tous les ennemis redoutables qu’elles connaissaient. Elles ont été vaincues facilement par les forces adverses incertaines qu’elles n’attendaient pas, que rien ne les avait préparées à affronter. La direction du F.L.N. avait certes organisé de longue date une idéologie terroriste du monolithisme, derrière laquelle se heurtaient rudement, au sommet, des équipes aux mobiles insaisissables. Les conditions extrêmement dures et la longueur de la lutte isolée des Algériens a facilité ce sous-développement du projet explicite de la révolution, sans lequel le courage de la lutte immédiate, qui contient en lui-même la totalité de l’espoir, mène à des victoires grandement décevantes. Presque aucun Français n’a aidé les Algériens, si l’on n’entend pas seulement par là porter les valises du Front mais soutenir la part de critique et de théorie réalistes pour la compréhension des principaux problèmes : ceux qui devaient inévitablement se poser à la défaite des troupes françaises et de la minorité raciste. Au contraire, ce goût de l’approbation en bloc d’un appareil, qui caractérise le chrétien gauchiste ou le stalinien déçu, reporté sur « le parti algérien » a favorisé une illusion ultra-frontiste, qui peut-être aujourd’hui se déchire en exagération inverse : la stupeur et la consternation devant des résultats si imprévus.
Pourtant, les seuls côtés imprévus dans la crise de l’été 1962 ont été d’abord la vitesse et la confusion exagérées des coteries armées luttant pour saisir le pouvoir au nom du même programme, encore qu’il fût très sommaire ; ensuite la faiblesse de la tendance spontanée qui a essayé de rejeter en même temps les fractions rivales, en s’opposant à l’affrontement armé (menace d’une grève générale, etc.).
Tout a été joué en septembre, avec la manière dont le Bureau Politique a pris le pouvoir. Sans disculper pour autant les brouillons de la willaya 4, qui s’étaient étrangement conduits dans la liquidation de la « zone autonome » d’Alger, et qui n’ont rien fait pour reculer une épreuve de force — barrant la route d’Alger — qui non seulement s’est traduite par leur effondrement rapide mais encore a été la modification irréversible pour tout le mouvement de libération algérien. Les combats autour d’Orléansville et de Boghari ont signifié que désormais, dans le camp de la révolution algérienne, les discussions pourraient être tranchées par l’armement lourd.
Plus que le désenchantement des militants algériens qui reviennent travailler comme ouvriers en France, ou qui sont en partance pour continuer la lutte anticolonialiste en Angola, plus que les signes d’islamisation dans les lois ou règlements, plus que les premières jacqueries des paysans à qui l’on promet une réforme agraire prudente et même la franche prise en mains du congrès syndical par des nervis du gouvernement, un fait privilégié, selon nous, révèle combien le mouvement révolutionnaire d’Algérie a raté sa mainmise sur la société : le 2 janvier, dans son premier bulletin l’agence Algérie Presse Service a révélé que les combats de septembre avaient fait « plus d’un millier de morts ». Deux ou trois jours après, la même agence rectifiait l’erreur commise à ce propos, et comptait dix morts environ. La succession de ces deux chiffres suffit à montrer qu’un État moderne est désormais installé en Algérie.
* Au mois d’octobre 1962, le dernier concile de l’Église Catholique a commencé à Rome.
* La crise autour de Cuba a illustré deux affirmations de cette revue en avril 1962, dans « Géopolitique de l’hibernation ». D’abord la décision commune russo-américaine de ne jamais faire la guerre thermonucléaire, mais en s’élevant « toujours plus haut dans le spectacle de la guerre possible » ; et aux U.S.A. à ce moment on a bâti des abris anti-atomiques supplémentaires à coefficient de « protection » encore moindre. D’autre part, l’entreprise de liquidation de la révolution cubaine largement avancée par le choix idéologique néo-léniniste. Si les dirigeants cubains de la première phase ont montré (discours de Castro le 26 mars) qu’ils ne se laisseraient pas facilement arracher le contrôle du parti unique par des bureaucrates parachutés, ils ont montré aussi qu’ils s’en remettaient aveuglément pour leur défense aux soldats et aux missiles atomiques russes. Comme la Russie les a abandonnés, parce que son mauvais calcul sur la stratégie planétaire théâtrale l’obligeait sur ce point à une débandade complète — qui ouvre une nouvelle période dans l’équilibre du partage mondial — et comme l’administration Kennedy n’a d’autre souci « stratégique » que la destruction politique du régime castriste par tous les moyens, on peut dire que le sort de la révolution cubaine, très compromis, est uniquement dans les mains des masses d’Amérique Latine. Seule cette menace virtuelle de soulèvement protège encore Cuba d’un débarquement de l’armée américaine, et nulle garantie de Khrouchtchev ou de personne d’autre. Tout tient finalement à l’exemple que Cuba donnera : de quelle société nouvelle ? À cet égard il faut dire que la conjonction du néo-léninisme autoritaire (livret de travail ouvrier) et des pressions économico-militaires de l’encerclement américain va vers la dégradation d’un tel exemple.
* La VIe Conférencede l’Internationale situationniste s’est tenue à Anvers du 12 au 16 novembre 1962, dans d’excellentes conditions architecturales et ludiques. Elle a débattu de l’ensemble des problèmes de la radicalisation de l’I.S. depuis Göteborg : la cohérence situationniste ; la définition précise de nos rapports avec les tendances extérieures favorables, ou ennemies (lutte anti-nashiste) ; la clandestinité et l’expérimentation dans l’immédiat.
La Conférence a décidé la réorganisation de l’I.S., considérée comme un seul centre uni, en supprimant les divisions par sections nationales. Ce centre ne sera plus constitué de délégués de groupes locaux (nous encouragerons de tels groupes dès qu’ils se forment à rester autonomes, hors de l’I.S.) mais se considérera lui-même comme représentant globalement les intérêts de la nouvelle théorie de la contestation, sans en déduire aucun rôle dirigeant sur des forces subordonnées (« notre mandat… nous ne le tenons que de nous-mêmes »). Le dernier C.C. désigné à Anvers, qui aura aussi la tâche d’élire dans l’année qui suit ceux des candidats qui seront admis comme participants d’une I.S. devenue dans sa totalité ce centre (à un niveau égal de participation théorique et pratique de tous) comprend Michèle Bernstein, Debord, Kotányi, U. Lausen, J.V. Martin, Jan Strijbosch, A. Trocchi et Vaneigem.
Le travail pratique de l’I.S. a été divisé en régions, correspondant à des ensembles de conditions culturelles et linguistiques, les situationnistes se partageant d’après leur origine et position géographique les fonctions de correspondants de notre centre pour ces zones d’un anti-N.A.T.O. La première Région (Nord-Europe) comprend les pays scandinaves et l’Islande. La deuxième (Centre-Europe) englobe les deux Allemagnes, l’Autriche, la Suisse ; et doit développer nos contacts vers l’Est. La Région Atlantique comprend les îles britanniques et les U.S.A. La quatrième Région (Ouest-Europe) s’occupera de la France, des trois pays du Benelux, de l’Italie et, discrètement, de la péninsule ibérique. Enfin, une cinquième Région (Afrique-Asie), seulement virtuelle, servira à grouper toutes nos liaisons actuellement éparses dans cette moitié du monde. La quatrième Région s’occupera momentanément de coordonner ces relations. Les quatre régions effectives de l’I.S. devront avoir aussitôt que possible une revue chacune, et la revue Internationale Situationniste, à partir de son numéro 9, sera réservée a l’expression situationniste pour la Région Ouest-Europe.
Il a été décidé à Anvers que la VIIe Conférence de l’I.S. aura lieu à Vienne.
ù PRINTED IN FRANCE
Imp. CH-BERNARD. 27, rue des Cloys — Paris (18e)
Tirage : 4 000 exemplaires
Prix : 3 francs. Trimestriel (abonnement annuel : 10 francs)
Distribution N.M.P.P. — Dép. lég. 1/3/63 — 1787ù CORRESPONDANCE • MÉTAGRAPHIES • REVUES • FILMOGRAPHIE • ÉPIGRAPHIE • CONFÉRENCES INDUSTRIELLES • PLANS PSYCHOGÉOGRAPHIQUES DE PARIS • CHANSONS • KRIEGSPIEL • MISCELLANÉES • RÉPONSES AUX POLICES